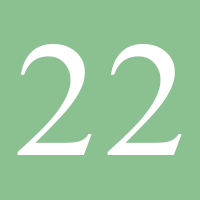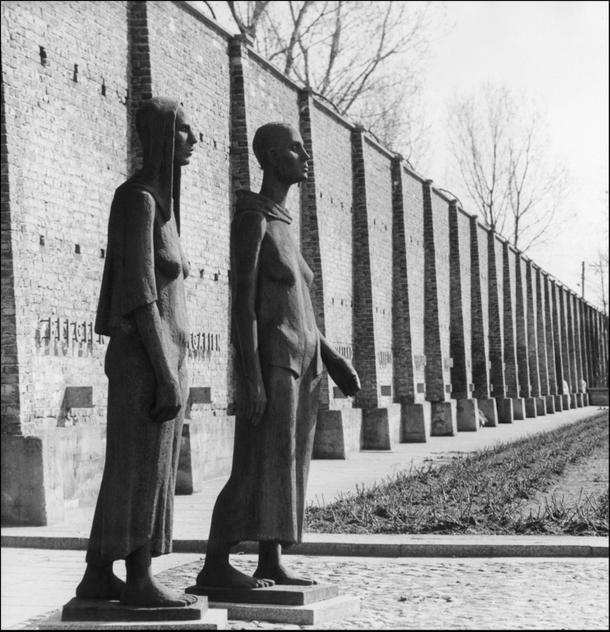| Ils sont nés un 15 avril |
| Jos� Anigo, Jeffrey Archer, Josiane Balasko, Alice Braga, Dolores Cannon, Agn�s Capri, Claudia Cardinale, Olivier Debr�, Lydie Denier, Georges Descrieres, �mile Durkheim, Luke Evans, |
Mardi 15 avril :
Demain :
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26e degré du Bélier
Symbole Sabian :
On voit un homme brûler jusqu'à une chaleur incandescente avec la richesse de ce qu'il a à donner.
24e degré du Scorpion
Symbole Sabian :
Un flux constant de personnes descendant le flanc d'une montagne témoigne de la puissance de l'homme qui s'est adressé à elles.
30e degré des Poissons
Symbole Sabian :
La conception du Grand Visage de Pierre de Nathaniel Hawthorne a été concrétisée dans une immense sculpture de montagne.
25th Degree of Pisces
Sabian Symbol:
Ecclesiastical reform of drastic nature is in progress and a purged and purified priestcraft opens a new ministry.
29e degré du Cancer
Symbole Sabian :
Une allégorie pastorale grecque est vue ; une paysanne est mère de jumeaux et ceux-ci sont maintenant pesés par une Muse dans une balance en or.
19th Degree of Gemini
Sabian Symbol:
In the somber archives of a sedate museum a large archaic volume is somewhat conspicuously displayed.
27e Degré des Poissons
Symbole Sabian :
La lune des moissons se lève superbement à l'est et la lumière du jour est obscurcie par les couleurs d'une soirée d'automne.
26th Degree of Taurus
Sabian Symbol:
A Spanish gallant stands at the window grill of his love, serenading her with the softer melodies of night.
1er Degré du Bélier
Symbole Sabian :
Une femme est sortie de l'eau ; un phoque est également sorti et l'embrasse.
4th Degree of Aquarius
Sabian Symbol:
A Hindu pundit emerging from the sleepy and idle warmth of his hut suddenly glows with a mystic healing power.
3ème Degré du Bélier
Symbole Sabian :
Un camée montre le profil d'un homme qui suggère les contours de son pays.
28e degré du Taureau
Symbole Sabian :
Une femme d'âge mûr se tient dans une soudaine prise de conscience ravie de charmes oubliés, dans une récupération inattendue de romance.
5ème Degré de la Vierge
Symbole Sabian :
Un homme est allongé en train de rêver à l'ombre d'une campagne irlandaise ; ses rêves lui amènent les petites gens espiègles.
| Sun | 25 | 50'26" | ||
| Moon | 23 | 38'50" | ||
| Mercury | 29 | 32'44" | ||
| Venus | 24 | 45' 2" | ||
| Mars | 28 | 56'24" | ||
| Jupiter | 18 | 25'37" | ||
| Saturn | 26 | 11'27" | ||
| Uranus | 25 | 28'27" | ||
| Neptune | 0 | 35' 8" | ||
| Pluto | 3 | 43'57" | ||
| TrueNode | 27 | 9'29"r | ||
| Chiron | 23 | 9'52" | ||
| Mardi 15 Avril 2025 15h41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
Paris
Mar, Avr 15, 2025
| Sunrise 06:57 |
| Sunset 20:41 |
| Twilight ends 22:41 begins 04:59 |
94%
17 days old
17th Lunar Day  23:56
23:56
This Lunar Day is propitious to good business deals, salary increase, reaping, but also ruse, deceit, intemperance.
Waning Gibbous
This period is intended to summarize and analyze errors. It is better not to begin new affairs at this time.
Moon in Scorpio  11:19
11:19
Suitable energy for cleansing, getting rid of the old, spring cleaning, rubbish removal, recycling, nursing, practical and emotional support, midwifery, partnership in business, profound talks, sharing secrets, healing old wounds, cultivating psychic powers, studying occult subjects. Purchase of insurance policies, underwear, hygiene articles, medicines, medical equipment, payment of bills, fees and taxes, collecting debts. Unfavorable time to start a new business.
- Scorpion : signe d'Eau, fixe.
Correspond au gros intestin, aux organes sexuels, au nez.
- DL 17 : Moment propice pour accéder à une position responsable. Défavorable au mariage.
- DL 18 : Favorable à la découverte des ennemis et en temps de guerre. Défavorable à tout le reste.
- ML 18 : Favorable à toutes sortes d'entreprises.
- ML 19 : Les maladies se déclenchant à ce moment peuvent être graves.
Jour lunaire 17
C'est un jour propice au mariage, à la naissance d'un enfant, aux vacances en famille et aux tâches ménagères. Il favorise toutes les activités liées à la maison, au foyer et à la terre. La consommation d'alcool, de médicaments ou de drogues doit être strictement limitée ce jour-là. Seul Albert le Grand décrit ce jour comme particulièrement négatif.
Vronsky :
Ce jour est propice à de nouveaux et importants départs. Un enfant né ce jour-là sera heureux et prospère. Cependant, si ce jour tombe un samedi, cela pourrait s'avérer dangereux.
Celui qui tombe malade ce jour-là a de mauvaises perspectives, car sa maladie pourrait s'avérer incurable. Ne prenez aucun médicament ce jour-là, ni boissons alcoolisées. Évitez les drogues, car les conséquences peuvent être très négatives. Les rêves se réalisent généralement le troisième jour.
Globa :
Symbole : la cloche. Journée de la liberté intérieure, de l'accumulation, de la fertilité, de la joie d'être et de la recherche de l'amour idéal. Idéale pour le mariage (fondé sur l'amour), les relations conjugales, la joie, la détente et la sublimation de l'énergie sexuelle. Cette journée est associée à la transformation de l'énergie féminine. Il est recommandé de boire un vin sec et frais, ou du vin de Cahors chaud, symbole de la connaissance de l'éternité et de l'extase. Cependant, il est déconseillé de boire de l'alcool et de se laisser emporter.
Jour lunaire 18
Une journée plutôt positive. Elle favorise le lancement de projets à long terme, notamment ceux visant à gagner de l'argent. C'est une journée propice pour consulter un médecin et prendre soin de sa santé, mais les maladies chroniques peuvent également s'aggraver ce jour-là.
Vronsky :
Ce jour exige prudence et tempérance. Un enfant né ce jour-là se montrera travailleur et assidu ; avec les années, il deviendra prospère et riche.
Celui qui tombe malade peut le rester longtemps et ne jamais s'en remettre. Les rêves, en règle générale, sont légitimes.
Globa :
Symbole — le miroir. Une journée passive qui peut devenir difficile et conduire au péché par refus de lutter contre les instincts et les tentations. Il est conseillé de se défaire de ses mauvaises pensées, de renoncer à la vanité et à l'égoïsme. Il est permis de prendre des bains, de se purifier les intestins, de se faire masser. Ce jour-là, la réalité environnante semble refléter notre essence profonde. Il est déconseillé de boire du vin, de fumer, de trop dormir et de manger de la viande. Privilégiez les noix et les huiles végétales. Les maladies de peau et les plaies ouvertes sont des signes de violation de la loi de l'évolution cosmique.
Manoir Lunaire 19, Al-Shaulah (L'Arnaque)
21° 25' 43'' Scorpion – 4° 17' 09'' Sagittaire
Bon pour
Agriculture et jardinage. Actions agressives. Chasse.
Pas bon pour
Affaires et commerce. Amitié. Affaires familiales. Voyages en mer.
Essence
Bataille et siège. Perte et tristesse.
Avis
Warnock : Al-Shaulah est propice au déploiement des armées hors des villes et à leur progression, ainsi qu'à l'augmentation des récoltes. Elle est néfaste à la libération et aux navires.
Warnock : Présage de bataille et de siège, ce manoir indique que nous devons être constants et sûrs de nous pour atteindre nos objectifs, et que nous devrons peut-être recourir à la confrontation. Il peut également signaler le début de disputes et de conflits, et nous avertir que nous nous comportons de manière trop agressive ou conflictuelle.
Warnock : Al-Shaulah est également associé à Mars et au sang, et au Scorpion et aux organes génitaux. En cas de grossesse ou d'accouchement, cette Demeure est une indication négative. Mais, à l'inverse, elle pourrait indiquer une résolution positive des problèmes d'aménorrhée.
Warnock : À un niveau plus subtil, ce manoir peut indiquer la nécessité de reconnaître les cycles naturels de notre vie, de ne pas bloquer le flux et le reflux des événements. Ce manoir évoque des sentiments de perte et de tristesse, inévitables dans la vie, mais que nous éviterions si nous avions le choix. Lorsque ce manoir apparaît, nous pouvons nous préparer à la douleur et au chagrin qu'il annonce, confiants qu'il existe un but et un ordre, et que nos souffrances actuelles passeront.
Warnock : ...Pour que les hommes puissent mieux voyager sur les routes et dans les villages, augmenter les récoltes, ...pour accélérer les règles des femmes.
Volguine : Il faut se garder des liquides ; il est préférable de ne rien entreprendre pour le moment.
Volguine : Favorable à la chasse et aux idées personnelles, mais défavorable au commerce et à la fixité de résidence.
Volguine : Favorise ceux qui travaillent pour les autres plutôt que les employeurs et les travailleurs indépendants ; c'est aussi un bon présage pour les revenus vers la fin de la vie.
Volguine : Défavorable aux amitiés et aux enfants et provoquant la séparation du natif de ses enfants ou de ses parents.
Agrippa : Il aide à assiéger les villes et à prendre les villages, à chasser les hommes de leurs places, à détruire les marins et à perditionner les captifs.
Ashmole 396 : Quand la Lune est dans ce Manoir, assiégez des châteaux, plaidez avec votre adversaire. Partez. Ne vous laissez pas intimider. Semez et plantez. Qui prend une femme ne trouvera pas de servante. N'achetez pas de serviteurs. Ne montez pas à bord d'un navire, car il risque d'être brisé. Ne prenez pas de nouvelle compagnie. Prenez garde de ne pas être capturé.
| Rise | Set | |
| Mercury | 06:19 | 18:09 |
| Venus | 05:37 | 17:58 |
| Moon | 22:46 | 07:23 |
| Mars | 12:19 | 04:17 |
| Jupiter | 09:24 | 01:20 |
| Saturn | 06:15 | 17:50 |
Day Ruler
 |  |  |  |  |  |  |
Hours of the Day
| 7:01 | 8:09 | 4 | 20:42 | 21:33 | 2 | ||
| 8:09 | 9:17 | 7 | 21:33 | 22:24 | -5 | ||
| 9:17 | 10:26 | 4 | 22:24 | 23:16 | 4 | ||
| 10:26 | 11:34 | -9 | 23:16 | 0:07 | 4 | ||
| 11:34 | 12:43 | -4 | 0:07 | 0:59 | 4 | ||
| 12:43 | 13:51 | 2 | 0:59 | 1:50 | -9 | ||
| 13:51 | 14:59 | -5 | 1:50 | 2:41 | -4 | ||
| 14:59 | 16:08 | 4 | 2:41 | 3:33 | 2 | ||
| 16:08 | 17:16 | 7 | 3:33 | 4:24 | -5 | ||
| 17:16 | 18:25 | 4 | 4:24 | 5:16 | 4 | ||
| 18:25 | 19:33 | -9 | 5:16 | 6:07 | 4 | ||
| 19:33 | 20:42 | -4 | 6:07 | 6:59 | 4 |
Mardi 15 avril 2025
Lune d'aujourd'hui : La Lune est en Scorpion jusqu'à 22h36, puis en Sagittaire. Une période de Lune vide se produit aujourd'hui de 22h23 à 22h36. La Lune est décroissante et en pleine lune… [En savoir plus...]
April 15 2025
3:49 PM Time Zone is CEDT
Paris,FR
Applying Moon Trine Venus
Interactions with others, especially females, feel natural and balanced now. It’s a time of warm feelings and affections, cooperation, and emotional comforts. Public events are positive.
Mercury void in Pisces
Nervous energy is high, schedules fall apart, communications fail, and things break. Changes or unusual conditions in the weather occur. High winds (mental and actual) blow through any thickness that resists movement. Matters connected with transportation will make news now. Disruptions may occur, making scheduling difficult. Weather changes may have a significant impact on certain areas of the world. It’s best now to cease initiating and get down to finishing what’s already been started. Seek closures and completions.
Applying Venus Sextile Uranus
Unusual events and “firsts” may occur now. Group activities and behaviors seem erratic and unstable, but prove productive.
Mars void in Cancer
Individual actions stimulate progressive movement or panic. Risks are run that favor the one over the many. Personal survival comes before group cooperation. This is a time for collective ventilation through sports or through some other kind of competition. A good fight is what’s needed. Leaders take actions, make decisions, and implement repairs. Constructive activities become more focused and detailed.
Applying Jupiter Square Venus
Things get big, over-inflated, and windy. Obligatory expressions of good feelings and demonstrations of generosity occur now. Meetings, weddings and other obligatory, excessive, and expansive social events may be prominent now.
Saturn void in Pisces
Formalities are the rule; traditions are maintained. Groups of old friends, family, and comrades assemble to remember the past. Conservatism rules; experiments fail. At this time leaders are under pressure and laws are put into effect. It’s a time for staying with tradition and not experimenting with new forms of social behaviors. The past triumphs.
Uranus void in Taurus
Actions are unconventional, radical, or surprising. Not everyone agrees on how things should go, therefore there is discord within groups. Others, who have a specific agenda, persevere to make their point despite fierce opposition. Social conditions are volatile now. The bottom could fall out. It’s a time for experimentation and deviant behaviors. Sudden, unusual, and disruptive conditions occur now that reveal deep inequalities in society and culture.
Applying Neptune Sextile Pluto
This is a time of important developments on an international and trans-cultural level. Typical events include challenges to governments and the beginnings of new cultural movements.
Pluto void in Aquarius
There is movement toward displaying outright power. Tolerance and patience are pushed aside in favor of drastic actions. Old wounds are reopened and confrontations forced. Power plays occur. Secret forces make their presence known. Some seek to act on their urges, others attempt to stop them. Deep secrets are revealed. A collective cleansing is in order.
*Conjonctions aux étoiles fixes le 15 avril 2025.**
Aspects à la Lune 24°Sc43 -23°12′
conjonction 24°Sc09 AGENA La douleur d'apprendre
Aspects à Mercure 29°Pi36 -01°45′
conjonction 29°Pi43 SCHEAT Être un penseur, un intellect
Aspects à Uranus 25°Ta28 +18°54′
conjonction 24°Ta32 CAPULUS — Mâle, sexuel et/ou agressif
Aspects à Neptune 00°Ar35 -00°55′
conjonction 29°Pi43 SCHEAT Être un penseur, un intellect
Aspects à Vesta 15°Sc54 -05°17′
conjonction 15°Sc26 ZUBEN ELGENUBI Réforme sociale positive
Aspects à Pallas 17°Aq51 +10°53′
conjonction 17°Aq43 SUALOCIN Alléchant mais naïf.
Aspects à Junon 29°Sc56 -05°12′
conjonction 29°Sc48 TOLIMAN L'apprentissage, les leçons de la vie.
Mardi 15 avril 2025
La Lune d'aujourd'hui :
- La Lune est en Scorpion jusqu'à 22h36, après quoi la Lune est en Sagittaire.
- Une période de Lune vide se produit de 22h23 à 22h36 aujourd'hui.
- La Lune est décroissante et dans sa phase de pleine lune.
- La Pleine Lune a eu lieu le 12 dans le signe de la Balance.
Rétrogrades :
- Vénus n'est plus rétrograde, mais elle est dans son ombre post-rétrograde jusqu'au 16 mai.
- Mercure n'est plus rétrograde, mais il est dans son ombre post-rétrograde jusqu'au 26 avril.
- Mars n’est plus rétrograde et se trouve dans son ombre post-rétrograde jusqu’au 2 mai.
**Les heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (HAE).
Date et heure : 15 avril 2025, 22 h 36
Événement : La Lune entre en Sagittaire
Description : La Lune en Sagittaire
C'est le moment d'élargir notre esprit et nos expériences, d'explorer de nouvelles voies, de viser haut et d'élargir nos horizons. Le souci du détail et le travail routinier sont moins présents. On peut y trouver de l'agitation, du courage et de la spontanéité.
Date et heure : 15 avril 2025, 22 h 23
Événement : La Lune devient vide de cours
Date et heure : 14 avril 2025, 23 h 42
Événement : Tr-Tr Mon Tri Cer
Description : Transit de la Lune en trigone Transit de Cérès
Nous pouvons ressentir un attachement agréable à nos proches ou à notre famille, ou être soutenus par eux. Nous recherchons la sécurité, l'attention et la chaleur, et nous sommes plus susceptibles d'exprimer ces sentiments envers les autres.
Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 11
Événement : Tr-Tr Mon Cpl Mar
Description : Lune en transit contraparallèle Mars en transit
Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 17
Événement : Tr-Tr Mon Cpl Jup
Description : Lune en transit contraparallèle Jupiter en transit
Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 37
Événement : Tr-Tr Mon Pll Plu
Description : Transit de la Lune parallèle au transit de Pluton
Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 49
Événement : Tr-Tr Mon Qnx Chi
Description : Transit Lune Quinconce Transit Chiron
Les sentiments blessés peuvent être des occasions de guérison. Il est temps de construire des ponts, et non de les détruire.
Date et heure : 15 avril 2025, 11 h 03
Événement : Tr-Tr Mon Tri Ven
Description : Transit Lune Trigone Transit Vénus
Nous sommes moins inhibés et plus disposés à nous faire plaisir. L'amour et le romantisme peuvent être propices. Décoration, soins de beauté, arts, activités créatives, fêtes, rendez-vous et loisirs sont généralement privilégiés maintenant. La sensibilité, l'affection et la chaleur sont accrues. L'amour est grandiose ! Affection, amour et romantisme sont dans l'air.
Date et heure : 15 avril 2025, 12 h 30
Événement : Tr-Tr Mon Opp Ura
Description : Lune en transit Opposition Uranus en transit
La vie est peut-être un peu tendue en ce moment. Évitez les comportements volontaires si la situation ne l'exige pas. Restez ouvert à de nouvelles possibilités et tout se révélera. Il pourrait y avoir une révélation surprenante ou un tournant. Des réactions imprévisibles de la part des autres (et de nous-mêmes) sont possibles. Des éruptions émotionnelles sont possibles. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions définitives, surtout en matière de relations.
Date et heure : 15 avril 2025, 13 h 38
Événement : Tr-Tr Lun Qnx Dim
Description : Transit Lune Quinconce Transit Soleil
Nos sentiments et nos pensées peuvent être en contradiction en ce moment. Nous pouvons agir selon notre volonté au détriment de nos émotions, ou agir selon nos émotions au détriment de notre volonté ou de notre ego. Dans les deux cas, nous pouvons être insatisfaits.
Date et heure : 15 avril 2025, 13 h 59
Événement : Tr-Tr Mon Tri Sam
Description : Transit Lune Trigone Transit Saturne
Une période propice à tout projet exigeant endurance ou tolérance. C'est également propice à l'instauration de nouvelles habitudes et de nouveaux rituels.
Date et heure : 15 avril 2025, 15 h 50
Événement : Tr-Tr Mon Tri Nod
Description : Lune en transit trigone Nœud Nord en transit
C'est une période propice aux échanges avec le public, à la création de liens et à la réalisation d'objectifs personnels ou professionnels. Vous êtes capable d'opérer des changements. C'est une période propice à la découverte de nouvelles opportunités.
Date et heure : 15 avril 2025, 19 h 51
Événement : Tr-Tr Mon Tri Mar
Description : Lune en transit trigone Mars en transit
Nous sommes plus courageux et capables de prendre les devants. Nous sommes à l'écoute de nos désirs et de nos instincts naturels. Nous exprimons nos sentiments avec honnêteté. Nous sommes indépendants, inventifs et courageux.
Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 22
Événement : Tr-Tr Mon Cnj Jun
Description : Conjonction Lune Transit Junon Transit
Le désir ou le besoin de se connecter avec quelqu'un est désormais fort. Nous sommes sensibles à ce que les autres pensent, désirent et ressentent.
Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 23
Événement : Tr-Tr Mon Tri Mer
Description : Lune en transit trigone Mercure en transit
Les idées fusent. Nous exprimons nos sentiments avec clarté et nos pensées avec sensibilité. C'est un moment idéal pour les projets collaboratifs. C'est un bon moment pour passer des examens, écrire, promouvoir, parler en public et étudier. Nous sommes alertes, observateurs et avons une bonne mémoire.
Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 36
Événement : Tr-Tr Mon Cnj Sag
Description : Lune en transit entrant en Sagittaire
C'est le moment d'élargir notre esprit et nos expériences, d'explorer de nouvelles voies, de viser haut et d'élargir nos horizons. Le souci du détail et le travail routinier sont moins présents. On peut y trouver de l'agitation, du courage et de la spontanéité.
Date et heure : 15 avril 2025, 22 h 50
Événement : Tr-Tr Mon Tri Nep
Description : Transit Lune Trigone Transit Neptune
C'est une période de bien-être si nous nous permettons de nous détendre et de nous connecter aux aspects subtils de la vie : l'art, la nature, la beauté, les rêves et les sphères spirituelles. Nous assimilons les choses facilement, nos sens sont en pleine forme et nous acceptons plus naturellement les choses et les gens tels qu'ils sont. Il n'est pas nécessaire de chercher des réponses définitives pour l'instant.
Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 08
Événement : Tr-Tr Mer Tri Jun
Description : Mercure en transit trigone Junon en transit
C'est le moment idéal pour collaborer avec quelqu'un afin de générer des idées, de résoudre des problèmes ou simplement d'écouter et d'être entendu. Un bon accord mental peut être établi dès maintenant.
Date et heure : 15 avril 2025, 3 h 54
Événement : Tr-Tr Mar Pll Jup
Description : Mars en transit parallèle à Jupiter en transit
Date et heure : 15 avril 2025, 1 h 28
Événement : Tr-Tr Jun Cnj Sco
Description : Junon en transit entrant dans le Scorpion
BÉLIER FORT
Énergie initiatique et pionnière. Indépendant, audacieux, courageux, affirmé, fougueux, inspirant, direct, décisif. Peut être égocentrique, impulsif, impatient, agressif et manquer de subtilité.
SCORPION FORT
Perception intense, magnétique et pénétrante, le pouvoir de confronter. Peut être destructeur, vengeur, jaloux, dramatique.
POISSONS FORT
Compatissant, sensible, altruiste, doux, intuitif. Peut être fuyant, peu pratique, hypersensible, crédule.
L'équilibre élémentaire d'aujourd'hui
TERRE FAIBLE
Il peut y avoir un manque de désir, d'intérêt ou de compétences concernant les questions pratiques. Nous pouvons être déconnectés de la réalité. Nous éprouvons des difficultés à nous concentrer et à nous ancrer.
AIR FAIBLE
Nous pouvons avoir du mal à être objectifs ou détachés. Nous pouvons ne pas être particulièrement communicatifs.
EAU FORTE
Les signes d'Eau sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Nous sommes plus compatissants, émotifs et intuitifs que d'habitude, et nous pouvons réagir émotionnellement aux situations, parfois au détriment de la logique ou du pragmatisme.
Bilan modal d'aujourd'hui
Les modes sont aujourd'hui équilibrés.
Phase lunaire d'aujourd'hui
PHASE LUNAIRE : PLEINE LUNE
La Lune est à 180 à 135 degrés derrière le Soleil.
Nous nous intéressons principalement à la nature des relations et sommes conscients des déséquilibres récents. Un changement peut se produire. Notre préoccupation ne se limite pas aux relations personnelles, mais aux relations de toutes sortes. Cartes sur table.
LA LUNE EN SCORPION
Qu'il s'agisse de passion, d'exaltation, de tristesse ou de désir, les émotions se ressentent à un niveau profondément personnel. La Lune en Scorpion nous pousse à découvrir notre propre pouvoir, et c'est le moment idéal pour nous débarrasser de nos vieilles peurs et de nos habitudes limitantes. Ce peut être une période intime et passionnée. Évitez les manipulations, les ruminations et la suspicion.
25E DEGRÉ DU SCORPION
Partie du corps : Coccyx, trompes de Fallope
Symbole Sabian : Une radiographie.
ASPECTS DE LA LUNE
QUINCUNX LE SOLEIL Orbe 1°11′ Appliquant
Nous pouvons avoir du mal à intégrer nos besoins émotionnels ou nos sentiments à ce que nous pensons devoir faire maintenant, ce qui conduit à une certaine indécision. Résistance.
TRINE MERCURE Orbe 4°52′ Appliquant
Nos cœurs, nos besoins émotionnels et notre esprit semblent coopérer, et nous sommes capables de communiquer efficacement. C'est une période propice à la publicité, au marketing, à l'écriture et aux études.
TRINE VÉNUS Orbe 0°01′ Appliquant
Nous avons tendance à rechercher l'harmonie, l'équilibre et la beauté. Amour, romance, décoration, soins de beauté, arts, activités créatives, fêtes, rendez-vous et loisirs sont généralement privilégiés en ce moment. On observe une sensibilité, une affection et une chaleur accrues, mais on pourrait aussi faire preuve d'apaisement, de tact et de diplomatie.
TRINE MARS Orbe 4°14′ Appliquant
Sentiments et désirs semblent en harmonie, ce qui en fait le moment idéal pour agir avec détermination. Compétition saine, ingéniosité, courage.
TRINE SATURNE Orbe 1°28′ Appliquant
Nous sommes plus à même de trouver un équilibre entre nos besoins émotionnels et nos responsabilités. C'est le moment idéal pour prendre de bonnes habitudes. Nous sommes plus tolérants, réfléchis et déterminés.
OPPOSITION URANUS Orbe 0°44′ Appliquant
Nous pouvons être de mauvaise humeur, oscillant entre le désir d'appartenance et le désir d'être différent ou indépendant. Nous pouvons nous sentir un peu déséquilibrés si les horaires et les personnes qui nous entourent sont imprévisibles ou changeants ; ou encore, nous sommes perturbés par la routine et souhaitons créer l'événement.
TRINE NEPTUNE Orbe 5°51′ Appliquant
Nous nous tournons vers les aspects subtils de la vie : l’art, la nature, la beauté, les rêves et les sphères spirituelles. Nous acceptons plus naturellement les situations et les gens tels qu’ils sont. Sensibilité, compassion.
QUINCUNX CHIRON Orbe 1°33′ Séparant
Nous pourrions mal évaluer notre sensibilité et faire de mauvais choix. Les décisions prises aujourd'hui pourraient ne pas refléter notre cœur et être regrettables plus tard.
LE SOLEIL
LE SOLEIL EN BÉLIER
Vous êtes une personne affirmée et épris de liberté. Vous avez un fort besoin d'indépendance et pouvez avoir tendance à afficher votre égo avec assurance.
26E DEGRÉ DU BÉLIER
Partie du corps : Crâne
Symbole Sabian : Un homme possédant plus de dons qu'il ne peut en contenir.
ASPECTS DU SOLEIL
CARRÉ MARS Orbe 3°02′ Appliquant
Les circonstances nous poussent à l'action. L'agressivité et les conflits sont possibles en ce moment, et nous pouvons paraître plus agressifs ou combatifs que nous ne le pensons. En canalisant notre énergie excédentaire de manière constructive, au lieu de perdre notre temps à nous disputer, nous pouvons accomplir beaucoup. Méfiez-vous de l'impulsivité et des actions prématurées. Nous sommes plus compétitifs que coopératifs en ce moment.
CONJONCTION CHIRON Orbe 2°45′ Séparant
Vous êtes blessé, physiquement ou émotionnellement. Vous avez peur de vous exprimer, car vous êtes très sensible à la douleur. Vous avez souffert à un moment de votre vie, ce qui contribue à votre peur de la douleur à l'âge adulte. Vous êtes d'une nature compatissante, car vous comprenez la souffrance des autres.
MERCURE
MERCURE EN POISSONS
Nos processus de pensée sont visuels, intuitifs et imaginatifs. Nous sommes particulièrement sensibles au monde des émotions, qui influencent à la fois nos pensées et notre style de communication. Nous devinons bien, nous exprimons par l'image et prenons des décisions intuitivement. Nous sommes davantage attirés par les informations qui stimulent la conscience.
30E DEGRÉ DES POISSONS
Partie du corps : Ongles du pied gauche
Symbole Sabian : Le grand visage de pierre (étant la projection d'un idéal).
ASPECTS DU MERCURE
CONJONCTION VÉNUS Orbe 4°50′ Séparant
Nous sommes plus agréables, sociables et soucieux de l'équilibre et de l'harmonie. Les conversations sont fluides.
TRINE MARS Orbe 0°37′ Séparation
Vous saisissez rapidement les nouvelles idées. Vous êtes un excellent communicateur et appréciez les échanges constructifs.
CONJONCTION SATURNE Orbe 3°24′ Séparant
Vous avez un esprit logique. Enfant, vous étiez timide et incapable d'exprimer vos opinions. Adulte, vous deviendrez une voix d'autorité.
CONJONCTION NEPTUNE Orbe 0°59′ Appliquant
Vous avez un esprit imaginatif, même si vous parlez parfois de manière vague. Vous êtes sensible aux pensées et aux idées des autres. Vous êtes créatif.
CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 2°27′ Séparant
Nous pouvons nouer des contacts importants avec des personnes qui partagent nos intérêts intellectuels ou qui nous font découvrir de nouvelles idées qui nous aident à grandir, à nous améliorer et à nous développer. Les projets portent actuellement leurs fruits, notamment ceux qui impliquent le travail en équipe. Apprendre, enseigner, communiquer et nouer des contacts sont des priorités, ou nous rencontrons des situations qui nous encouragent à améliorer nos compétences dans ces domaines.
VÉNUS
VÉNUS EN POISSONS
Vous aspirez à fusionner et à ne faire qu'un avec votre partenaire. En fait, vous souhaitez être en harmonie avec l'univers. Vous aimez également partager des activités inspirantes avec votre partenaire, comme écouter de la belle musique ou visiter une galerie d'art.
25E DEGRÉ DES POISSONS
Partie du corps : articulation tibio-fibulaire distale gauche
Symbole sabien : La purification du sacerdoce.
ASPECTS DE VÉNUS
TRINE MARS Orbe 4°13′ Séparation
Vous avez un don pour les relations humaines. Vous êtes un partenaire loyal et enjoué, capable de concilier intimité et indépendance. Cependant, vous pouvez considérer vos propres talents créatifs comme acquis et ne pas les exploiter pleinement.
CONJONCTION SATURNE Orbe 1°26′ Séparant
Vous êtes timide et inhibé dans vos relations personnelles. Vous craignez l'engagement et avez tendance à vouloir tout contrôler ou à choisir un partenaire qui essaie de vous contrôler. L'un de vos parents a peut-être été trop strict, ce qui vous empêche de vous exprimer. Une fois ce sentiment d'inadéquation surmonté, vous serez capable de nouer des relations stables et durables, fondées sur des fondations solides. Vous êtes fidèle et loyal.
SEXTILE URANUS Orbe 0°43′ Appliquant
Vous aimez les relations qui vous offrent l’opportunité d’exprimer votre individualité.
CONJONCTION NEPTUNE Orbe 5°49′ Appliquant
Vous aspirez au romantisme dans vos relations personnelles. Vous recherchez le partenaire idéal et parfait, qui n'existe que dans les contes de fées. Les imperfections des relations vous déçoivent et vous cherchez du réconfort dans un monde imaginaire. Vous devez affronter vos réalités et vos imperfections, celles des autres. Vous pourrez alors partager la beauté, l'art et la créativité avec vos partenaires.
CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 2°23′ Appliquant
Votre destin est lié au besoin de développer des relations harmonieuses et équilibrées. Ces relations joueront un rôle important dans vos réussites. Veillez à ce que votre besoin de paix n'entrave pas vos actions décisives.
MARS
MARS DANS LE CANCER
Nous sommes moins enclins à aller droit au but. Nos émotions influencent particulièrement la poursuite de nos objectifs. Sous cette influence, nous devenons un peu plus prudents et conservateurs, mais nous nous battrons pour, à propos ou au nom des personnes et des choses qui nous sont chères.
29E DEGRÉ DE CANCER
Partie du corps : la rate
Symbole sabien : Une muse grecque pèse dans une balance dorée des jumeaux qui viennent de naître.
ASPECTS DE MARS
TRINE SATURNE Orbe 2°46′ Séparation
Nous pouvons être réservés, mais faire preuve de maîtrise de soi. Nous sommes mieux à même de nous concentrer sur les priorités ou les questions pratiques. C'est le moment idéal pour soigner les détails, s'organiser et travailler dur.
TRINE NEPTUNE Orbe 1°36′ Appliquant
L'inspiration pourrait être présente dès maintenant, et notre intuition est forte. On peut s'attendre à un apaisement de la colère ou à un adoucissement de l'humeur. Les arts créatifs, notamment physiques, sont privilégiés.
OPPOSITION PLUTON Orbe 4°45′ Appliquant
Nous cherchons peut-être à prendre le dessus et à résister au contrôle des autres. Le ressentiment fait surface, tout comme l'esprit de compétition.
JUPITER
JUPITER EN GÉMEAUX
Vous recherchez un échange constant d'informations. Vous êtes un étudiant et un enseignant polyvalent.
19E DEGRÉ DES GÉMEAUX
Partie du corps : muscles laryngés
Symbole Sabian : Un grand volume archaïque.
SATURNE
SATURNE EN POISSONS
Travailleur bienveillant et intuitif, bien que parfois anxieux et craintif. Un karma important à gérer. Un moment pour évaluer nos rêves, notre santé mentale et notre sens de la compassion et de l'empathie. (Saturne est en Poissons du 7 mars 2023 au 24 mai 2025, puis du 1er septembre 2025 au 13 février 2026).
27E DEGRÉ DES POISSONS
Partie du corps : Phalanges du pied droit
Symbole Sabian : Une lune de moisson.
ASPECTS DE SATURNE
SEXTILE URANUS Orbe 0°43′ Séparant
Vous avez la capacité d'apporter de nouvelles idées aux structures existantes. Vous structurez également les nouvelles organisations et possédez un talent pour l'administration.
CONJONCTION NEPTUNE Orbe 4°23′ Appliquant
Vous avez un talent à la fois pratique et créatif. Si vous avez un talent musical ou artistique, vous pouvez lui donner forme et créer quelque chose de durable. Vous êtes prêt à vous entraîner pour perfectionner vos talents créatifs. Vous pourriez être artiste.
CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 0°56′ Appliquant
Vous êtes mis au défi d'assumer un rôle responsable au sein d'un groupe. Vous préférez peut-être être seul, mais cette vie exige une collaboration constante avec les autres pour atteindre vos objectifs. Vous pourriez souffrir de maladies physiques qui vous obligeraient à réévaluer votre vie.
URANUS
URANUS EN TAUREAU
(1934 – 1942) Nous abordons l'argent et les biens personnels de manières nouvelles et apprenons à nous libérer de certaines contraintes matérielles. Des façons innovantes de nous sentir bien apparaissent. Nous sommes moins inhibés dans l'expression de la sensualité, de l'amour de soi, de l'amour de notre corps et du bien-être. Nous remettons en question ce que nous valorisions auparavant. Des changements brusques peuvent survenir concernant l'argent, les objets de valeur, les biens et les revenus, entraînant une redistribution des priorités ou des valeurs. Les revenus peuvent provenir de sources ou d'entreprises non traditionnelles. Nous apportons des idées progressistes au monde des affaires. De nouvelles façons de faire des affaires, ainsi que de gagner, de percevoir et de gérer l'argent, sont probables. Les revenus et l'énergie que nous consacrons à gagner de l'argent peuvent varier. (Du 15 mai 2018 au 6 novembre 2018, puis du 6 mars 2019 au 7 juillet 2025, puis du 7 novembre 2025 au 25 avril 2026).
26E DEGRÉ DU TAUREAU
Partie du corps : os nasal
Symbole Sabian : Un Espagnol faisant la sérénade à sa senorita.
NEPTUNE
NEPTUNE EN BÉLIER
(1861/62 – 1874/75) Il est important de noter que Neptune met environ 164 ans pour effectuer un cycle complet, passant environ treize ans dans chaque signe. Par conséquent, l'interprétation de Neptune dans le signe s'applique à une génération plutôt qu'à un individu. Pour une interprétation plus individuelle, examinez la position de la maison. Cette génération a le potentiel d'être des pionniers spirituels. Ils prennent des risques en explorant les royaumes mystiques. Cette génération peut également se vanter d'avoir de nombreux pionniers dans les arts.
1ER DEGRÉ DU BÉLIER
Partie du corps : cerveau
Symbole Sabian : Une femme est sortie de l'océan ; un phoque l'embrasse.
ASPECTS DE NEPTUNE
SEXTILE PLUTON Orbe 3°08′ Appliquant
Vous appartenez à une génération capable d'induire des changements sociaux. Vous contribuez aux changements de gouvernement et à l'évolution des droits de l'homme. La spiritualité et l'occultisme gagnent en crédibilité et en pouvoir. Par ailleurs, certains membres de votre génération choisiront de se retirer du système.
CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 3°26′ Séparant
Vous êtes en quête spirituelle et votre destin est lié à l'expression de vos talents artistiques et créatifs. Votre défi est de découvrir votre potentiel et votre intuition les plus élevés. Vous pouvez exprimer vos talents au sein de groupes spirituels ou artistiques.
PLUTON
PLUTON EN VERSEAU
(1777 – 1799) Il est important de noter que Pluton met environ 248 ans pour effectuer un cycle complet, passant de 12 à 32 ans dans chaque signe. Par conséquent, l'interprétation de Pluton dans son signe s'applique à une génération plutôt qu'à un individu. C'est la génération de la coopération mondiale. Les personnes de cette génération ont la capacité de réaliser des avancées scientifiques au bénéfice de l'humanité et pourraient être amenées à changer la vision de la science. (Pluton est en Verseau du 23 mars au 11 juin 2023, du 20 janvier au 1er septembre 2024 ; du 19 novembre 2024 au 8 mars 2043 et du 31 août 2043 au 19 janvier 2044).
4E DEGRÉ DU VERSEAU
Partie du corps : péroné gauche
Symbole Sabian : un guérisseur hindou.
CHIRON EN BÉLIER
Votre sentiment d'être a été violé d'une manière ou d'une autre et vous pourriez craindre de vous affirmer. Vous pourriez aussi surcompenser en essayant d'être le premier en tout. Physiquement, vous pourriez souffrir de blessures à la tête. Vous pourriez devenir un pionnier au service de l'humanité.
24E DEGRÉ DU BÉLIER
Partie du corps : Muscle zygomatique
Symbole sabien : une fenêtre ouverte et un rideau en filet soufflant dans une corne d'abondance.
VESTA EN SCORPION
Vous êtes profondément investi dans votre travail. Dévouement et capacité de concentration sont essentiels. La morale sexuelle peut être une préoccupation majeure, car vous cherchez soit à briser les mœurs sexuelles existantes, soit à réprimer vos pulsions sexuelles derrière un code d'éthique strict.
16E DEGRÉ DU SCORPION
Partie du corps : ovaire droit, cochlée de l'oreille interne
Symbole Sabian : Le visage d'une fille esquissant un sourire.
PALLAS EN VERSEAU
Votre esprit peut être brillant, original et perspicace. Vous êtes capable de saisir rapidement de nouvelles idées et de les appliquer à l'avenir. Vous défendez vos idéaux et des causes humanitaires ou politiques.
18E DEGRÉ DU VERSEAU
Partie du corps : Système nerveux spinal
Symbole Sabian : Un homme démasqué.
JUNO EN SCORPION
Vous souhaitez une relation intense et sensuelle. Vous recherchez l'attention totale de votre partenaire et exigez une grande sensualité.
30E DEGRÉ DU SCORPION
Partie du corps : muscles nasaux
Symbole Sabian : Le bouffon d'Halloween.
CÉRÈS EN POISSONS
C'est en étant en harmonie avec le monde que l'on se sent le plus aimé. Vous prenez soin des autres en soulageant leur douleur. Vous éprouvez de la compassion pour vos proches.
20E DEGRÉ DES POISSONS
Partie du corps : muscle péroné droit
Symbole Sabian : Une table dressée pour un repas du soir.
LA LUNE NOIRE EN SCORPION
3E DEGRÉ DU SCORPION
Partie du corps : prostate, utérus
Symbole Sabian : Une élévation de maison.
ÉRIS EN BÉLIER
26E DEGRÉ DU BÉLIER
Partie du corps : Crâne
Symbole Sabian : Un homme possédant plus de dons qu'il ne peut en contenir.
LE NŒUD NORD
LE NŒUD NORD EN POISSONS
Il s'agit d'une quête de compassion et de foi. Vous avez tendance à imposer une structure rigide, de l'ordre et de la propreté à votre monde personnel et à juger les autres. Cela vous empêche de comprendre votre unité avec l'univers. Vous devez développer votre compréhension spirituelle et apprendre à vous fier à votre intuition.
28E DEGRÉ DES POISSONS
Partie du corps : Phalanges du pied gauche
Symbole Sabian : Un jardin fertile sous la pleine lune .
LE NŒUD SUD
LE NŒUD SUD EN VIERGE
Il s'agit d'une quête de compassion et de foi. Vous avez tendance à imposer une structure rigide, de l'ordre et de la propreté à votre monde personnel et à juger les autres. Cela vous empêche de comprendre votre unité avec l'univers. Vous devez développer votre compréhension spirituelle et apprendre à vous fier à votre intuition.
28E DEGRÉ DE LA VIERGE
Partie du corps : Plexus hépatique
Symbole sabien : Un homme chauve domine un rassemblement de personnalités nationales.
Moon Phase

Waning
Next phase: 3:35 Apr 21, 2025
The waning Moon is most beneficial for matters at a stage of consolidation, conservation and completion. It hampers growth and helps to remove anything not desirable. Cutting hair now will make it grow slower. Plant or replant plants which have fruits under the ground.
Moon Sign

Scorpio
Until 4:37 Apr 16, 2025
An emotionally difficult time. There is increased jealousy, greediness, envy and other negative feelings. The colours of the world turn black and white. Sexuality and sensuality go up and strong, powerful emotions run high, whilst diplomacy and tact will noticeably decline. However, it is a good time for any occupation which needs intensity and total devotion.
Moon Void-of-Course

Later
At 4:23 Apr 16, 2025
Last aspect: ![]()
![]()
It is believed that anything undertaken when the Moon is void-of-course will bring no result. However, this period of time has its positive sides too.
Learn more: Void-of-Course Moon: A Complete Guide
Planets
| 25.51 | |||
| 23.41 | |||
| 29.33 | |||
| 24.45 | |||
| 28.56 | |||
| 18.26 | |||
| 26.11 | |||
| 25.28 | |||
| 0.35 | |||
| 3.44 | |||
| 23.10 | |||
| 27.09 | R |
Declinations
| 9.59 | N | ||
| 22.54 | S | ||
| 1.46 | S | ||
| 1.40 | N | ||
| 22.38 | N | ||
| 22.40 | N | ||
| 3.19 | S | ||
| 18.55 | N | ||
| 0.56 | S | ||
| 22.43 | S | ||
| 9.43 | N | ||
| 1.08 | S |
Aspects
| ❤️ | |||
| 🏆 | |||
| 🍀 💰 ❤️ 💋 | |||
| 🏆 | |||
| 💋 🏆 | |||
| 🍀 💰 🏆 | |||
| 🍀 | A Super Aspect |
| ❤️ | A Romance Aspect |
| 💋 | A Sexual or Seduction Aspect |
| 💰 | A Golden or Silver aspect |
| 💎 | A Cinderella Aspect |
| ⛲ | A Fountain of Youth Aspect |
| 🏆 | A Sports Champions' Aspect |
These symbols mark aspects that are deemed especially meaningful in Magi Astrology.
Eclipses
| Moon | 20:11 Sep 7, 2025 |
| Sun | 21:41 Sep 21, 2025 |
| Sun | 13:11 Feb 17, 2026 |
| Moon | 12:33 Mar 3, 2026 |
| Sun | 19:45 Aug 12, 2026 |
Retrogrades
Mercury
1.03 - 15.03 - 7.04 - 26.04
Venus
28.01 - 2.03 - 13.04 - 16.05
Mars
5.10 - 7.12 - 24.02 - 2.05
 |
Aujourd'hui9° / 17° Risque de pluie : 100% - Humi. : 94% Vent :Sud-Sud-Ouest - 24 km/h Lever : 07:00 - Coucher : 20:43 Averses de pluie dans les alentours |
Horoscope du mardi 15 avril 2025
| |||
| Belier Si votre libido vous titille, pourquoi ne pas en parler � votre partenaire? D'autant que vous saurez mettre en avant vos qualit�s, votre savoir faire et... votre ardeur! | Balance En ce moment, vous avez tendance � vous projeter dans les valeurs de votre partenaire. Cherchez l� o� vous �tes compl�mentaires, et pas forc�ment semblables... | ||
| Taureau Bien que vous ayez tendance � vous isoler, votre partenaire ne vous laisse pas souvent ruminer tranquille! Et si vous lui parliez de ce qui vous passe par la t�te? | Scorpion Vous n'�tes gu�re � prendre avec des pincettes, aujourd'hui ! Il faut dire qu'avec le boulot qui vous attend... mais sachez le prendre avec humour, �a passe plus vite! | ||
| Gemeaux Aujourd'hui, vous n'avez gu�re l'esprit au labeur et vous avez tendance � vous �vader dans des projets plus ou moins r�alistes. Faites le point, en toute lucidit�. | Sagittaire Vous semblez privil�gier l'amour, mais vous pr�f�rez garder pour vous seuls ces beaux moments d'intimit�, profiter du calme et du silence pour vous ressourcer. | ||
| Cancer Vous avez beaucoup d'ambition, mais votre coeur est tout de m�me �pris de beaut� et de joie int�rieure. Exprimez tout cela de fa�on artistique. | Capricorne Comment concilier amiti� et vie familiale? Tout simplement en invitant vos amis � la maison ou autour d'un bon repas dans un restaurant. A vous de l'organiser! | ||
| Lion Les �tudes ou les d�marches en vue de rebondir sont d'actualit�. Pourtant, les affaires familiales vous retiennent � la maison alors que vous auriez plut�t envie de voyager. | Verseau Voil� une journ�e prometteuse sur le plan social. Les bonnes id�es semblent se former dans votre esprit plus ais�ment et, de ce fait, vous n'avez pas de mal � les formuler. | ||
| Vierge Vos pens�es vont en ce moment � l'un de vos fr�res ou soeurs, qui a peut-�tre des soucis d'ordre financier. Si cela est possible pour vous, tendez-lui la main... | Poissons Aujourd'hui, vous r�vez d'aventure ou de voyage, loin des vicissitudes du quotidien. Soyez r�aliste : en avez-vous vraiment les moyens? Si c'est le cas, n'h�sitez pas! | ||
Né(e) le 15 avril – Cette année est une année de coopération et de relations enrichissantes. Vos relations peuvent être agréablement orientées vers le développement personnel cette année. Vous explorez votre créativité et créez des liens grâce à des échanges dynamiques ou à des idées et des causes partagées…suite
Votre anniversaire tombe peu après une Pleine Lune cette année, ce qui suggère une période propice à la communication et à l'enseignement. On vous demande souvent conseil, et vous êtes toujours prêt à offrir votre aide. C'est une année propice à la publicité et à toute autre activité impliquant de faire passer le message. De plus, votre capacité à être objectif – ou à voir les choses dans leur ensemble – est mise en avant et gratifiante cette année.
C'est une année où vous semblez réagir plus intensément à la vie, ou où vous êtes plus enclin à explorer vos sentiments et désirs les plus profonds. C'est le moment idéal pour vous spécialiser ou vous concentrer sur un projet, une relation ou une activité en particulier. Vous êtes enclin à explorer, observer et analyser. C'est un moment privilégié pour entrer en contact avec votre intuition.
Cette année pourrait également être propice à une meilleure connexion mentale ou à une plus grande attention portée à la communication et au partage d'idées. Vous exposez vos idées avec plus d'assurance et êtes plus enclin que d'habitude à les mettre en pratique.
Votre magnétisme personnel est exceptionnel cette année. Vous êtes un compétiteur enjoué et pourriez remporter une compétition majeure, le cas échéant. C'est une période propice aux projets créatifs et à la collaboration pour atteindre un objectif commun.
Vous pourriez vous concentrer agréablement sur une relation ou un projet particulier. Vous êtes responsable et loyal. Ce pourrait être une excellente période pour concrétiser ou monétiser une activité créative, ou pour collaborer avec succès.
La période à venir sera également propice à la danse, à la natation, à la photographie, aux arts et au divertissement. Si vous êtes artiste, cette année pourrait être particulièrement inspirante, imaginative et productive. Vous semblez avoir un sens aigu des tendances, ce qui peut vous donner un sentiment de contrôle et de confiance dans vos décisions.
C'est une excellente période pour mieux se comprendre dans vos relations et pour vous sentir bien en accordant aux autres le bénéfice du doute. Vos qualités charitables peuvent vous dynamiser. C'est une année potentiellement formidable pour aider les autres, enseigner et grandir grâce à vos relations. Une relation pourrait se développer, comme une connexion d'âme.
Cette période peut être importante pour nouer des relations encourageantes, agréables ou affectueuses. Votre popularité augmente et vos efforts pour aplanir les difficultés dans vos partenariats ont plus de chances de réussir. Vous êtes mieux préparé pour les négociations et les partenariats.
Des explosions de créativité et d'énergie surgissent à des moments apparemment parfaits et vous aident à atteindre vos objectifs. Cette année, vous prendrez probablement des risques sains, car vous serez plus à même de repérer les opportunités lorsqu'elles se présentent. Il est plus facile que d'habitude de se libérer des habitudes qui vous empêchaient d'atteindre vos objectifs.
Le travail d'équipe et la collaboration peuvent être au cœur de l'année. Le début d'une relation significative ou l'intensification d'une histoire d'amour existante peuvent également être des thèmes importants. Des projets intenses et enrichissants sont au programme.
C'est une année propice à l'amitié et à la bonne humeur. L'essentiel est de nouer des liens et de communiquer, ce que vous ferez probablement plus que d'habitude. Les relations amoureuses se nouent ou se renforcent grâce à la communication. Vous pourrez être agréablement occupé pendant cette période, profitant pleinement de vos activités ou découvrant de nouveaux passe-temps amusants. La diplomatie peut vous mener partout cette année.
Un alignement Vénus-Saturne dans votre thème de Révolution Solaire cette année apporte une dimension sérieuse à au moins une relation clé. Vous êtes peut-être en train de finaliser un accord ou de revoir et d'affiner vos objectifs relationnels.
Cette année, vous êtes plus créatif et vous vous exprimez souvent avec plus de sensibilité, de compassion et de chaleur. Il peut arriver que vous vous sentiez dépassé mentalement, et c'est dans ces moments-là que vous chercherez à minimiser les distractions.
Durant cette période, la spontanéité amoureuse et la créativité peuvent être plus présentes. Coups de foudre, attirances soudaines, extravagances occasionnelles et impulsivité sont des thèmes récurrents. Votre créativité est plus originale ou inhabituelle, ou vous attirez des personnes surprenantes et originales. Vous avez besoin de plus d'espace, d'espace pour explorer, ou d'indépendance dans vos relations.
Heureusement, votre thème astral est influencé par une influence pratique remarquable, qui vous aide à organiser, ordonner et ranger une grande partie de votre vie. L'effort et le plaisir que vous prenez à travailler ou à accomplir vos tâches peuvent être au cœur de vos préoccupations pour la période à venir. La plupart du temps, les méthodes traditionnelles fonctionnent, et la rigueur est récompensée à ce stade de votre vie. Pratiquer ou perfectionner une technique est privilégié cette année. Des ambitions modestes et l'appréciation des progrès lents mais réguliers peuvent vous mener loin.
Résumé:
Cette année sera une année de coopération et de relations enrichissantes. Vos relations pourraient être agréablement orientées vers le développement. Vous explorerez votre créativité et tisserez des liens grâce à des échanges dynamiques ou à des idées et des causes partagées.
 2025 est une année exceptionnelle pour vous. Gouvernée par le Soleil, c'est une année d'action. Les graines que vous semez maintenant, vous les récolterez plus tard. On pourrait vous trouver moins sociable, car vous êtes plus occupé que jamais et vous vous concentrez sur vos activités et vos besoins. Pourtant, vous êtes extraverti et votre esprit d'initiative est plus fort que jamais. Conseil : Soyez autonome, agissez, prenez un nouveau départ, exprimez votre indépendance.
2025 est une année exceptionnelle pour vous. Gouvernée par le Soleil, c'est une année d'action. Les graines que vous semez maintenant, vous les récolterez plus tard. On pourrait vous trouver moins sociable, car vous êtes plus occupé que jamais et vous vous concentrez sur vos activités et vos besoins. Pourtant, vous êtes extraverti et votre esprit d'initiative est plus fort que jamais. Conseil : Soyez autonome, agissez, prenez un nouveau départ, exprimez votre indépendance.
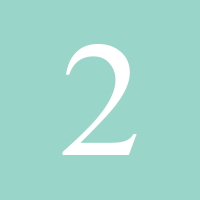 2026 sera une année numéro deux pour vous. Gouvernée par la Lune, c'est une année propice aux rencontres. C'est une année calme, douce et généralement harmonieuse, moins active que les autres. Au contraire, vous serez plus à l'écoute des besoins des autres. Si vous êtes patient et ouvert avec douceur, vous attirerez les choses et les gens. C'est une excellente année pour construire et développer l'avenir. Conseil : soyez patient, réceptif, savourez la paix et recueillez les pensées.
2026 sera une année numéro deux pour vous. Gouvernée par la Lune, c'est une année propice aux rencontres. C'est une année calme, douce et généralement harmonieuse, moins active que les autres. Au contraire, vous serez plus à l'écoute des besoins des autres. Si vous êtes patient et ouvert avec douceur, vous attirerez les choses et les gens. C'est une excellente année pour construire et développer l'avenir. Conseil : soyez patient, réceptif, savourez la paix et recueillez les pensées.
Si vous êtes né aujourd'hui, le 15 avril
Vous cherchez toujours à être juste avec les autres, en essayant de trouver un équilibre. Cependant, malgré votre souci de sécurité, vous avez tendance à suivre votre cœur plutôt que la voix de la raison, et il vous arrive d'être très impulsif.
Votre intelligence vient souvent davantage de votre perspicacité et de votre compréhension innée du monde qui vous entoure que des études.
Parmi les personnes célèbres nées aujourd'hui figurent Léonard de Vinci, Samira Wiley, Emma Thompson, Paula Pell, Emma Watson, Seth Rogen, Jeffrey Archer, Alice Braga, Maisie Williams, Ester Dean, Flex Alexander, Luke Evans, Elizabeth Montgomery, Thomas F. Wilson, Julia Butters, Cody Christian, Bessie Smith, Frank Vincent, Omar Tyree, China Chow, Arian Moayed et Toheeb Jimoh.
15 AVRIL
Le Soleil est en semi-sextile avec Uranus en début de journée et forme le même aspect avec Saturne ce soir. Il peut être difficile de profiter pleinement de la vie sans avoir le vague sentiment de négliger une responsabilité. Cependant, nous pouvons nous sentir prêts à tout. Un parallèle Mars-Jupiter laisse entrevoir un enthousiasme débordant, peut-être excessif, mais certainement inspirant et stimulant. Le changement est dans l'air, et nous nous sentons suffisamment forts pour l'accueillir. C'est une forte influence pour les idées novatrices, car nous nous imprégnons de l'esprit des choses. Nous pouvons être particulièrement inventifs. Avec un trigone Mercure-Junon ce soir, nous voulons apprendre, raisonner et acquérir des connaissances pour nous autonomiser. Des sentiments peuvent naître pour quelqu'un suite à des paroles ou à une connexion mentale. La Lune poursuit son transit en Scorpion jusqu'à 22h38 HAE, heure à laquelle elle entre en Sagittaire.
La Lune est vide à partir de 22h24 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un trigone à Mercure), jusqu'à ce que la Lune entre en Sagittaire à 22h38 HAE.
Cette semaine : Le Soleil est en Bélier jusqu'au 19, date à laquelle il entre en Taureau ; Mercure est en Poissons jusqu'au 16, date à laquelle il entre en Bélier ; Vénus est en Poissons ; Mars est en Cancer jusqu'au 18, date à laquelle il entre en Lion.
Le Soleil est en Bélier du 20 mars au 19 avril. En Bélier, le Soleil est enthousiaste et spontané. Nous sommes motivés par le désir de conquête. Nous sommes plus impulsifs et ressentons le besoin d'entreprendre, d'innover et d'être les premiers.
Le Bélier est un signe qui rebondit vite ; il n'a guère honte. Il est courageux, pionnier et quelque peu innocent. Nous sommes directs et assez simples dans nos besoins, mais nous pouvons aussi être myopes et manquer d'envie d'anticiper.
Le Soleil est en Taureau du 19 avril au 20 mai. En Taureau, le Soleil est méthodique, sensuel et réceptif. Le Soleil en Taureau est plus actif lorsqu'il défend ou résiste ! Lorsque le Soleil traverse le Taureau, lorsque les plantes prennent racine, notre détermination et notre besoin de sécurité sont forts. Le Taureau est fidèle à tout ce qui lui est familier et valorise la longévité. Son côté obscur est la possessivité et l'obstination.
Le Soleil en Taureau est un connaisseur et un sensuel. Il est patient, obstiné, terre-à-terre, stable et enraciné. Le cycle Soleil-Taureau est propice à l'entretien ou à la construction, ainsi qu'à la jouissance et à l'appréciation de l'existant. Si le Soleil en Taureau met du temps à se réchauffer, il est stable et persévérant une fois qu'il l'a fait. Durant cette phase, nous valorisons ce qui est durable, fort et durable.
Mercure est en Poissons du 29 mars au 16 avril. Lorsque Mercure est en Poissons, nos processus de pensée sont plus visuels, intuitifs et imaginatifs. Nous sommes particulièrement sensibles au monde des émotions, qui influencent à la fois nos pensées et notre style de communication.
Nous devinons bien, nous nous exprimons par l'image et prenons des décisions intuitivement. Nous sommes davantage attirés par les informations qui suscitent la conscience.
Il n'est pas toujours facile d'exprimer nos impressions pendant ce cycle. Nous n'aimons pas fixer, étiqueter ou définir strictement les choses. Nous reconnaissons que la vie n'est pas toujours logique et préférons ne pas penser en noir et blanc. Nous sommes sensibles et influençables, ce qui signifie que nous pouvons absorber plus que d'habitude, et cela peut parfois nous submerger. Les Poissons ont besoin de temps en temps de solitude ou de recueillement pour se régénérer et se détoxifier.
Mercure est en Bélier du 16 avril au 10 mai. Lorsque Mercure est en Bélier, nous nous soucions moins des points de vue et des explications objectifs, et davantage de prendre une décision… rapidement ! Nos pensées et nos idées sont novatrices, et nous avons tendance à parler plus spontanément et directement, la planète de la communication étant le Bélier, un signe audacieux et affirmé.
Durant ce cycle, des décisions rapides, parfois impatientes ou précipitées, peuvent être prises, et nos réactions sont similaires : rapides et parfois défensives ou combatives. Nous valorisons la pensée indépendante et pouvons être mentalement compétitifs. Nous préférons apprendre par l'expérience personnelle plutôt que par l'enseignement.
Vénus est en Poissons du 27 mars au 30 avril. Tendre et affectueuse, Vénus en Poissons est difficile à atteindre, car elle exprime un désir difficile à définir et à satisfaire. Les frontières et les limites s'estompent sous Vénus en Poissons. Le côté obscur de cette position est la possibilité de se laisser tromper par nos désirs de croire, ainsi que l'évitement. Il faut se méfier de tomber amoureux d'une image idéalisée de quelque chose ou de quelqu'un. Il est également important de surveiller les comportements d'évitement ou indirects.
Vénus est exaltée en Poissons et prospère dans ce signe. Dévouée, compatissante, exceptionnellement généreuse et capable de sacrifices, elle pourrait se fier fortement à son intuition pour nos finances et notre vie amoureuse durant ce cycle. Nous gravitons autour d'objets, de situations et de personnes insolites, oubliés, poétiques et artistiques, et nous les apprécions. Nous recherchons des activités qui nous touchent, nous inspirent ou nous touchent.
L'argent peut nous filer entre les doigts, ou nous pouvons ignorer ou négliger certains aspects pratiques de notre vie actuelle. Cependant, nos finances s'améliorent si nous nous connectons à nos talents surnaturels, à notre imagination, à notre désir de guérir et de servir, ou à notre sens de la mission.
Ce transit n'est pas particulièrement fort pour la résolution ou la détermination, mais il est bon pour l'adaptabilité et une meilleure compréhension ou acceptation.
Mars est en Cancer du 6 janvier au 18 avril. [Alors que Mars rétrograde est retourné en Cancer le 6 janvier, Mars est redevenu direct le 23 février et poursuit son transit en Cancer jusqu'au 18 avril.] Nous poursuivons nos intérêts avec ardeur, mais évitons d'aller droit au but pendant le transit de Mars en Cancer. De plus, nos objectifs et nos projets sont sujets à des sautes d'humeur et à des hésitations. Nous sommes sur la défensive plutôt qu'ouvertement agressifs. Une grande partie de nos actions dépend de notre humeur du moment.
Nous sommes également très intuitifs et pouvons être amenés à agir pour apporter paix, réconfort et sécurité à notre vie pendant cette période. Nous nous battons pour nos proches. En fait, nous sommes farouchement protecteurs. C'est une période propice pour mettre nos égos de côté afin de faire avancer nos projets. La satisfaction intérieure et l'amour sont généralement plus importants pour nous que les réalisations extérieures en ce moment. Les objectifs personnels et familiaux sont notre priorité durant cette phase.
Mars est en Lion du 18 avril au 17 juin. En Lion, Mars est fier, sûr de lui et ambitieux. Nous sommes dynamiques et avons de grands objectifs. Nous poursuivons nos désirs avec franchise et assurance, en espérant des résultats spectaculaires. Nous préférons ignorer les détails et emprunter la voie la plus simple pour atteindre nos objectifs. Notre libido est forte et notre passion pour la vie est intense.
Mars en Lion peut éveiller un esprit de compétition ou une motivation. Nous sommes plus enclins à prendre des risques pour obtenir ce que nous voulons. Nous avons aussi tendance à faire sensation et à vouloir être aux commandes. Ce transit est passionné, ardent et théâtral. Nous cherchons à paraître forts et préférons être en tête ou au centre de l'attention. Nous pouvons être particulièrement en colère si nous nous sentons méprisés ou placés dans une position indigne.
 Jupiter est en Gémeaux.
Jupiter est en Gémeaux.
Jupiter a commencé son transit des Gémeaux le 24 mai 2024 et continue son transit du signe jusqu'au 9 juin 2025. En savoir plus sur le transit des Gémeaux par Jupiter .
![]()

Saturne transite les Poissons du 7 mars 2023 au 24 mai 2025, puis du 1er septembre 2025 au 13 février 2026. Découvrez le transit de Saturne en Poissons . Saturne entrera en Bélier le 24 mai 2025 .

Uranus est en Taureau.
Uranus transite le Taureau du 15 mai 2018 au 6 novembre 2018, puis du 6 mars 2019 jusqu'en 2025/2026. Nous abordons l'argent et les biens personnels sous un nouvel angle et apprenons à nous libérer de certaines contraintes matérielles. Des façons innovantes de nous sentir bien apparaissent. Nous sommes moins inhibés dans l'expression de la sensualité, de l'amour de soi, de l'amour du corps et des soins. Surtout, nous remettons en question ce que nous valorisions auparavant durant ce cycle.
Des changements brusques peuvent survenir concernant l'argent, les objets de valeur, les possessions et les revenus, entraînant une redistribution des priorités ou des valeurs. Les revenus peuvent provenir de sources ou d'entreprises non traditionnelles. De manière générale, nous apportons des idées progressistes au monde des affaires. De nouvelles façons de faire des affaires, ainsi que de gagner, de percevoir et de gérer l'argent, sont probables. Nos revenus et l'énergie que nous y consacrons peuvent varier. Pluton est en Verseau. Découvrez son transit en Verseau . Notez que Pluton a finalement terminé son voyage en Capricorne le 19 novembre 2024, date à laquelle il restera en Verseau pendant de nombreuses années.
Pluton est en Verseau. Découvrez son transit en Verseau . Notez que Pluton a finalement terminé son voyage en Capricorne le 19 novembre 2024, date à laquelle il restera en Verseau pendant de nombreuses années.
Romance et relations
Vénus est en Poissons du 27 mars au 30 avril. Comme le Verseau, l'amour des Poissons est universel. Cependant, les Poissons ne connaissent aucune limite en amour. Avec Vénus en Poissons, nous éprouvons de la compassion (et peut-être de l'attirance) pour ceux qui sont laissés pour compte, négligés ou victimes. Nous sommes pleins d'abnégation et avons du mal à fixer des limites. Les murs tombent, nous avons du mal à dire non (surtout si notre compassion est engagée), mais nous avons aussi tendance à éviter tout ce qui nous met mal à l'aise.
Les vœux pieux sont une expression de Vénus en Poissons. Nous avons trop facilement tendance à croire ce que nous voulons croire. Les gens peuvent être difficiles à cerner, et l'amour est difficile à définir sous cette influence. Les Poissons ne voient jamais le monde en noir et blanc. Au contraire, ils voient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Avec la déesse de l'amour en Poissons, notre amour est universel, nous sommes capables de pardonner et de comprendre, nous sommes séduisants et nous faisons preuve de compassion envers nos partenaires.
Vénus en Poissons est tendre et affectueuse, bien que difficile à atteindre, car elle aspire à quelque chose d'indéfinissable et difficile à satisfaire. Les frontières et les limites s'estompent sous Vénus en Poissons. Le côté obscur de cette position est celui de la tromperie et de l'évasion.
Cette semaine : Dimanche , lundi et vendredi , nous avons tendance à exprimer nos sentiments ou à les analyser, mais veillons à ne pas trop intellectualiser nos émotions. Nous avons tendance à analyser nos sentiments et nos relations, et nos interactions suscitent plus de questions que de réponses.
Vénus, la déesse de l'amour : les temps forts de la semaine à venir :
![]() Vénus en Poissons : un complexe de martyre, un amour pour les opprimés, la quête de l'âme sœur : telles sont les expériences associées au nouveau cycle que vous entamez. Un penchant pour les romances touchantes, un faible pour les faibles et une tendance à idéaliser les gens et les relations… très esthétique, très surnaturel.
Vénus en Poissons : un complexe de martyre, un amour pour les opprimés, la quête de l'âme sœur : telles sont les expériences associées au nouveau cycle que vous entamez. Un penchant pour les romances touchantes, un faible pour les faibles et une tendance à idéaliser les gens et les relations… très esthétique, très surnaturel.
Vénus en semi-sextile avec le Soleil les 13 et 14 avril. Nous pouvons avoir l'impression que notre quête de plaisir, d'affection, d'amour ou de confort est en contradiction avec ce que nous pensons devoir faire, ce qui peut engendrer une légère tension, un sentiment de culpabilité et peut-être une certaine indécision. Chercher à satisfaire ces deux besoins sans le faire au détriment de l'autre est logique, mais ce n'est pas évident en ce moment.
Vénus en opposition à Mercure les 13-14 avril et 18 avril. Nous exprimons nos sentiments, mais veillons à ne pas trop intellectualiser nos affections. Nous avons tendance à analyser nos sentiments et nos relations. Les interactions suscitent des questions.
Vénus sextile Uranus le 20 avril. Nous perdons notre peur du risque et accueillons avec joie tout ce qui est nouveau, inhabituel et hors du commun en matière d'engagement amoureux. Nous sommes prêts à expérimenter, mais pas forcément prêts à nous engager.
![]()
![]()
![]() Mercure en conjonction avec Neptune. Notre créativité intuitive est stimulée sous cette influence. Un transit très positif pour les activités artistiques et littéraires. Nous acquérons une meilleure compréhension de notre propre esprit. Le raisonnement conscient peut être faussé par le subconscient, ce qui rend difficile la concentration sur des faits concrets. La rêverie, la visualisation et la prophétie sont stimulées. Les communications peuvent être floues, vagues ou carrément confuses. Nous pouvons être sujets à la tromperie. Évitez de signer des contrats sous cette influence.
Mercure en conjonction avec Neptune. Notre créativité intuitive est stimulée sous cette influence. Un transit très positif pour les activités artistiques et littéraires. Nous acquérons une meilleure compréhension de notre propre esprit. Le raisonnement conscient peut être faussé par le subconscient, ce qui rend difficile la concentration sur des faits concrets. La rêverie, la visualisation et la prophétie sont stimulées. Les communications peuvent être floues, vagues ou carrément confuses. Nous pouvons être sujets à la tromperie. Évitez de signer des contrats sous cette influence.
![]()
![]()
![]() Jupiter sesquicarré Pluton. Sous cette influence, nous risquons d'avoir trop d'intérêts, d'activités ou de désirs. Il est donc conseillé d'éviter d'exagérer notre importance ou notre pouvoir, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres.
Jupiter sesquicarré Pluton. Sous cette influence, nous risquons d'avoir trop d'intérêts, d'activités ou de désirs. Il est donc conseillé d'éviter d'exagérer notre importance ou notre pouvoir, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres.
![]()
![]()
![]() Mars trigone Neptune. Nous suivons désormais notre intuition, nos fantasmes sexuels sont intenses, nous aspirons à l'infini et nos impulsions créatives sont puissantes. Nous sommes moins tendus et déterminés, et plus détendus. « Ce qui doit arriver arrivera » est notre attitude actuelle. L'inspiration est là. Ce transit favorise la danse, la natation, la photographie, les arts et le divertissement.
Mars trigone Neptune. Nous suivons désormais notre intuition, nos fantasmes sexuels sont intenses, nous aspirons à l'infini et nos impulsions créatives sont puissantes. Nous sommes moins tendus et déterminés, et plus détendus. « Ce qui doit arriver arrivera » est notre attitude actuelle. L'inspiration est là. Ce transit favorise la danse, la natation, la photographie, les arts et le divertissement.
Avril
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Lune sans cours le dimanche 13 avril, à partir de 6h01 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un carré à Mars), jusqu'à ce que la Lune entre en Scorpion à 9h54 HAE.
Lune VOC le mardi 15 avril, à partir de 22h24 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un trigone à Mercure), jusqu'à ce que la Lune entre en Sagittaire à 22h38 HAE.
Lune VOC le vendredi 18 avril, à partir de 7h39 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un trigone au Soleil), jusqu'à ce que la Lune entre en Capricorne à 10h13 HAE.
Avril 2025
H en CET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
 Jour = Lever de Lune en XII = ASC
Jour = Lever de Lune en XII = ASC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| Aspects and Ingress – April 2025 |
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re: |
Re:
Re:
Re:
Re:
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none |
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none |
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none
Re: none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soleil en Bélier. Une nouvelle perception de soi, un style personnel plus affirmé, une approche plus dynamique de la vie : tels sont les signes distinctifs du cycle qui commence pour vous. Les doutes s'estompent et la réserve appartient de plus en plus au passé. Il est temps d'agir ; votre destin est entre vos mains, et non entre vos mains. « À toute vitesse » (« et tant pis pour les torpilles ») est votre devise, pour le meilleur et pour le pire !
Mercure en Poissons. Connaître des choses sans savoir comment on les connaît est typique dans une période comme celle-ci. Le mystique, l'universel, l'éternel : voilà ce qui éveille votre curiosité. Appelez cela psychique, appelez cela du déjà-vu… cela peut être là quand vous l'invoquez, quel que soit le nom que vous lui donnez. (Se souvenir des petites choses pourrait cependant devenir plus difficile : il est difficile de se rappeler si on a payé sa facture d'électricité quand on s'intéresse davantage aux vérités éternelles.)
Vénus en Poissons : un complexe de martyre, un amour pour les opprimés, la quête de l'âme sœur : telles sont les expériences associées au nouveau cycle que vous entamez. Un penchant pour les romances touchantes, un faible pour les faibles et une tendance à idéaliser les gens et les relations… très esthétique, très surnaturel.
Mars en Cancer : sur la défensive, n'est-ce pas ? Avec ce nouveau cycle qui s'amorce, vous protéger et préserver les vôtres devient une priorité plus importante que d'habitude. Une sensibilité aux besoins et aux désirs des autres et une appréciation de leurs faiblesses (ainsi que des vôtres) vous rendent plus prudent et conservateur… vous choisissez vos batailles avec soin.
Jupiter en Gémeaux : faciliter la transmission d'idées et d'informations devient une priorité pour vous. L'écriture, les études et la communication jouent donc un rôle plus important dans votre vie. Croire que des personnes bien informées prendront les bonnes décisions devient un article de foi. N'oubliez pas : il arrive que certaines personnes sachent ce qu'il faut faire et qu'elles agissent quand même différemment !
Saturne en Poissons. Faire la paix avec le passé, assumer ses dettes karmiques : voilà quelques-uns des défis auxquels vous êtes confrontés à l'aube d'une nouvelle étape de votre vie. Ne pas les affronter peut engendrer des revers et créer des obstacles. Apprenez à voir au-delà du personnel et de l'égoïsme, sinon vous vous retrouverez dépassé.
Uranus en Taureau. Sens pratique et ingéniosité se combinent pour devenir de puissants moteurs dans votre vie, maintenant que vous avez entamé un nouveau cycle. Votre point fort est de concrétiser des concepts innovants et de les concrétiser ; il faut éviter à tout prix de s'enliser. Sens des affaires, inventivité, génie mondain.
Neptune en Poissons. Les aspects spirituels et psychiques prennent le contrôle de votre imagination alors que vous entamez un nouveau cycle. Les beaux-arts et toutes sortes de fantasmes prennent une importance démesurée. S'abandonner au destin, au karma et à d'autres pouvoirs plus grands que ceux des simples mortels peut être perçu comme la libération ultime. Si tout est Maya (illusion), quelle est la réalité qui donne naissance au monde des apparences ?
Pluton en Verseau. Réforme, révolution, rejet du passé et focalisation sur l'avenir : tels sont les signes distinctifs de la nouvelle phase qui s'ouvre dans votre vie. La tradition perd de sa pertinence et les idées reçues se révèlent être des dogmes ou des absurdités pures et simples. Et quelle est la différence, au juste ? Des changements radicaux dans tous les domaines sociaux et intellectuels.
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 4 avril | 12h20 | Saturne sextile Uranus | Sam 24 Pis 56' sextile Ura 24 Tau 56' |
| 4 avril | 22h14 | Premier quartier de lune | 15 canettes 33' |
| 7 avril | 7h07 | Mercure direct à 26 Pis 49 | Mer 26 Pis 49'D |
| 12 avril | 20h22 | Pleine Lune en Balance | 23 Lib 20' |
| 12 avril | 21h02 | Vénus Direct | Ven 24 Pis 38'D |
| 15 avril | 2h29 | Juno Rx entre en Scorpion | Jun Sco Rx |
| 16 avril | 2h25 | Mercure entre en Bélier | Mer 0 Ari 00' |
| 17 avril | 4h14 | Jupiter sesquadrature Pluton | Jup 18 Gem 45' sesquadrate Plu 3 Aqu 45' |
| 18 avril | 00h21 | Mars entre en Lion | Mars 0 Lion 00' |
| 19 avril | 15h56 | Le Soleil entre en Taureau | Soleil 0 Tau 00' |
| 20 avril | 21h35 | Dernier quartier de lune | 1 Aqu 13' |
| 21 avril | 7h31 | Saturne en conjonction avec le Nœud Vrai | Sam 26 Pis 51' conjonction Nod 26 Pis 51' |
| 27 avril | 15h31 | Nouvelle Lune en Taureau | 7 Tau 47' |
| 30 avril | 13h16 | Vénus entre en Bélier | Ven 0 Ari 00' |
| Date | Moon Aspects and Ingresses | Chart | |
| Apr 1, 13:55 | chart | ||
| Apr 1, 22:25 | Enters 0° Gemini | chart | |
| Apr 3, 01:25 | chart | ||
| Apr 4, 00:49 | Enters 0° Cancer | chart | |
| Apr 5, 21:48 | chart | ||
| Apr 6, 06:33 | Enters 0° Leo | chart | |
| Apr 8, 15:39 | Enters 0° Virgo | chart | |
| Apr 11, 03:11 | Enters 0° Libra | chart | |
| Apr 13, 02:21 | chart | ||
| Apr 13, 15:53 | Enters 0° Scorpio | chart | |
| Apr 16, 04:36 | Enters 0° Sagittarius | chart | |
| Apr 18, 16:11 | Enters 0° Capricorn | chart | |
| Apr 21, 01:21 | Enters 0° Aquarius | chart | |
| Apr 21, 08:19 | chart | ||
| Apr 23, 07:06 | Enters 0° Pisces | chart | |
| Apr 25, 04:53 | chart | ||
| Apr 25, 04:57 | chart | ||
| Apr 25, 09:23 | Enters 0° Aries | chart | |
| Apr 25, 10:53 | chart | ||
| Apr 26, 00:04 | chart | ||
| Apr 27, 09:16 | Enters 0° Taurus | chart | |
| Apr 27, 21:30 | chart | ||
| Apr 29, 02:32 | chart | ||
| Apr 29, 08:34 | Enters 0° Gemini | chart | |
| Apr 30, 18:57 | chart | ||
Calendrier Lunaire Avril 2025
QUELQUES RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE EN CE DÉBUT DE PRINTEMPS…
- Jardiner avec la Lune : Planter des pommes de terre: les jours les plus favorables selon les influences lunaires pour planter des pommes de terre seront le 1er (après-midi), le 13 (après-midi), le 14(matin), le 21 et le 22. Le début de la floraison du lilas est un bon indicateur pour planter les pommes de terre selon votre région.
- Tondre le gazon : Pour que le gazon soit plus beau et plus épais avec une croissance lente, tondre le 4, 5, 15, 16, 17, 18 ou 19. Pensez à conserver une zone vierge dans votre jardin pour favoriser la biodiversité, afin que les abeilles et autres insectes utiles au jardin puissent profiter des fleurs de printemps.
- Faucher avec la Lune : Pour favoriser la repousse, faucher le 1er, 2, 3(matin), 28, 29 ou 30. Retrouvez toutes les meilleures dates pour faucher selon la finalité (qualité, précocité, repousse rapide…) dans la page des foins du Calendrier Lunaire.
- Purin de plantes : Pour une meilleure efficacité, commencer la fabrication d’un purin de plante dans la période du 8 au 12 (en évitant le 10 après-midi).
- La viniculture avec la Lune : Soutirer dans la période du 4 au 12 avril afin de stabiliser le vin (en évitant le matin du 7 et l’après-midi du 10).
- Les arbres en fonction de la Lune : Pour une meilleure reprise, greffer les arbres fruitiers (greffe en couronne) par exemple le 19 ou le 28 avril
- La Lune et les animaux : Pour une meilleure efficacité, traiter contre les vers le 25 après-midi ou le 26 matin.
- Notre bien être avec la Lune : Meilleur jour pour se faire couper les cheveux en avril: le 16 ou le 17.
Quand la Lune est en Balance
![]()
![]() L'accent est mis sur l'ordre, non pas nécessairement par le rangement ou l'organisation, comme c'était le cas lorsque la Lune était en Vierge, mais plutôt par des interactions agréables avec les autres et par l'esthétique de notre environnement. Nous avons tendance à résoudre les problèmes par la diplomatie et sommes plus à même de mettre de côté nos émotions pour atteindre la paix à laquelle nous aspirons. La tendance actuelle est d'éviter les confrontations directes. Les décisions ne sont pas faciles à prendre. Voir les deux côtés d'une situation donnée est la principale raison de l'hésitation. La peur de perdre l'approbation des autres en est une autre.
L'accent est mis sur l'ordre, non pas nécessairement par le rangement ou l'organisation, comme c'était le cas lorsque la Lune était en Vierge, mais plutôt par des interactions agréables avec les autres et par l'esthétique de notre environnement. Nous avons tendance à résoudre les problèmes par la diplomatie et sommes plus à même de mettre de côté nos émotions pour atteindre la paix à laquelle nous aspirons. La tendance actuelle est d'éviter les confrontations directes. Les décisions ne sont pas faciles à prendre. Voir les deux côtés d'une situation donnée est la principale raison de l'hésitation. La peur de perdre l'approbation des autres en est une autre.
La Lune en Balance favorise généralement les activités suivantes : problèmes relationnels et de partenariat, activités impliquant le travail d'équipe et la coopération, activités impliquant un examen de soi, activités liées à la beauté.
Quand la Lune est en Scorpion
![]()
![]() L'intensité est au cœur de la Lune en Scorpion. Passion, exaltation, tristesse ou désir, les émotions se ressentent à un niveau profondément personnel. Nous sommes motivés par le désir d'aller au fond des choses et nous lisons instinctivement entre les lignes. La superficialité ne nous convient pas maintenant. La Lune en Scorpion nous pousse à découvrir notre propre pouvoir, et c'est le moment idéal pour nous débarrasser de nos vieilles peurs et de nos habitudes limitantes. Ce peut être une période intime et passionnée. Évitez les manipulations, les ruminations et la suspicion.
L'intensité est au cœur de la Lune en Scorpion. Passion, exaltation, tristesse ou désir, les émotions se ressentent à un niveau profondément personnel. Nous sommes motivés par le désir d'aller au fond des choses et nous lisons instinctivement entre les lignes. La superficialité ne nous convient pas maintenant. La Lune en Scorpion nous pousse à découvrir notre propre pouvoir, et c'est le moment idéal pour nous débarrasser de nos vieilles peurs et de nos habitudes limitantes. Ce peut être une période intime et passionnée. Évitez les manipulations, les ruminations et la suspicion.
La Lune en Scorpion favorise généralement les activités suivantes : impôts, comptabilité, problèmes d'intimité, examens psychologiques, recherche, introspection, se débarrasser de vieilles choses.
Quand la Lune est en Sagittaire
![]()
![]() La Lune est à son apogée en Sagittaire. Nous sommes motivés par le besoin de rechercher la vérité et sommes prêts à poursuivre une nouvelle vision. Nous ne nous intéressons pas aux détails pour l'instant. Nous nous concentrons plutôt sur la situation dans son ensemble. Les nouvelles expériences et aventures satisfont un besoin émotionnel profond. La spontanéité est la clé. Nous pouvons aussi avoir tendance à en faire trop et à exagérer. Nous ne voulons pas planifier à l'avance et préférons improviser.
La Lune est à son apogée en Sagittaire. Nous sommes motivés par le besoin de rechercher la vérité et sommes prêts à poursuivre une nouvelle vision. Nous ne nous intéressons pas aux détails pour l'instant. Nous nous concentrons plutôt sur la situation dans son ensemble. Les nouvelles expériences et aventures satisfont un besoin émotionnel profond. La spontanéité est la clé. Nous pouvons aussi avoir tendance à en faire trop et à exagérer. Nous ne voulons pas planifier à l'avance et préférons improviser.
La Lune en Sagittaire favorise généralement les activités suivantes : Activités aventureuses qui impliquent de « l'improviser », voyages, études supérieures, démarrage de projets d'édition, publicité, sports, activité physique.
Quand la Lune est en Capricorne
![]()
![]() Nous prenons conscience de la nécessité de structurer et de planifier. Nous sommes aussi instinctivement conscients des limites du temps. Nous sommes motivés par le désir de réussir. Réussir et se réaliser sont nos priorités. Nous sommes ingénieux et ne voulons pas gaspiller de temps, d'énergie ou de ressources. Cela peut être une influence très positive, voire déprimante. Cependant, regarder la réalité en face peut aussi être une période productive.
Nous prenons conscience de la nécessité de structurer et de planifier. Nous sommes aussi instinctivement conscients des limites du temps. Nous sommes motivés par le désir de réussir. Réussir et se réaliser sont nos priorités. Nous sommes ingénieux et ne voulons pas gaspiller de temps, d'énergie ou de ressources. Cela peut être une influence très positive, voire déprimante. Cependant, regarder la réalité en face peut aussi être une période productive.
La Lune en Capricorne favorise généralement les activités suivantes : Activités à long terme qui donnent des résultats lents mais réguliers, entreprises pratiques, problèmes de carrière, élaboration d'un plan d'affaires, investissements pratiques.
La lune reflete la phase de l astre auquel elle est conjointe par rapport au soleil.
En Bélier , des actions rapides qui donnent des résultats immédiats. Des entreprises qui impliquent le soi et la personnalité. (Le pouvoir de rester peut faire défaut). S'affirmer, relever des défis, démarrer des projets à court terme.
En Taureau , des actions substantielles et matérielles qui donnent des résultats solides. Activités financières et celles impliquant des biens personnels, demande de prêt, début d'une relation potentiellement à long terme, musique, décoration intérieure.
En Gémeaux , actions mentales et communicatives, et plus d'une activité à la fois. Lecture, apprentissage, lettres et courriels, courses.
En Cancer , les activités domestiques, celles qui impliquent la prise de conscience des besoins personnels. Décoration d'intérieur, réunions de famille.
En Lion , les activités créatives, les activités impliquant les enfants, les entreprises généreuses, les entreprises dans lesquelles une reconnaissance personnelle est souhaitée et la prise de risques.
En Vierge , activités mentales, activités professionnelles, services et routines. Activités qui gagneraient à s’occuper des détails.
En Balance , problèmes relationnels, activités impliquant le travail d'équipe et la coopération, activités impliquant un examen de conscience, activités liées à la beauté.
En Scorpion , impôts, comptabilité, problèmes d'intimité, examens psychologiques, recherches, auto-examen, se débarrasser des vieilles choses.
En Sagittaire , activités aventureuses impliquant le « voler », les voyages, les études supérieures, la publicité, le sport, l'activité physique.
En Capricorne , des activités à long terme qui donnent des résultats lents mais réguliers, des entreprises pratiques, des problèmes de carrière, l'élaboration d'un plan d'affaires, des investissements pratiques.
En Verseau , entreprises inhabituelles ou radicales, activités sociales, projets de groupe, essayer quelque chose de nouveau, rejoindre un groupe.
En Poissons , entreprises imaginatives, activités mystiques ou spirituelles, développement intérieur, musique et théâtre, retraites, activités impliquant l'eau.
La plupart des gens connaissent le cycle de la lune qui constitue la base de nos mois. Durant le cycle d'environ 29 jours et demi, la Lune forme une conjonction avec le Soleil à la Nouvelle Lune, une opposition avec le Soleil à la Pleine Lune et un carré avec le Soleil aux quarts de phases. Mais elle forme également des aspects avec les autres planètes du ciel.
Ce graphique représente tous ces cycles lunaires avec une ligne distincte pour chacune des planètes que la Lune aspecte. Lorsque la Lune est conjointe à la planète (une ligne de Nouvelle Lune pour le Soleil), la ligne se trouve en bas du graphique. Lorsqu'elle forme une opposition (une Pleine Lune pour le Soleil), elle se trouve en haut du graphique.
Ceux-ci marquent les deux extrêmes ou pôles du cycle. Lorsque la ligne croise la ligne horizontale médiane, la Lune forme un carré avec la planète.
Les quatre positions peuvent être des moments forts et intenses , même si les conjonctions et les oppositions sont peut-être les plus fortes.
Notez que placer les oppositions en haut du graphique n’indique pas qu’il s’agit d’un pic ou d’un meilleur moment que les conjonctions en bas. En fait, le contraire est souvent vrai, et elles sont dessinées de cette façon uniquement pour correspondre à la méthode habituelle d’affichage des Nouvelles et Pleines Lunes.
Bas du graphique – Conjonctions Ceci marque le moment où la Lune est en conjonction avec la planète et c'est le début d'un nouveau cycle. Le moment est venu de lancer de nouvelles initiatives liées à la planète et d’apporter des changements à celles existantes. Les enjeux de la planète sont souvent soulignés et sont souvent les plus forts à ce stade.
Haut du graphique – Oppositions Ceci marque le moment où la Lune est à l'opposé de la planète, ou à 180 degrés. Cela correspond à la Pleine Lune dans le cycle Soleil/Lune. C’est une période de fruit, de révélation et de stress émotionnel. Les problèmes sont souvent clairs à ce moment-là, parfois douloureusement.
Axe du milieu – Carrés Ceci marque le moment où la Lune est carrée, ou à 90 degrés, de la planète. C'est une période de changement et parfois de stress. Une époque où les choses peuvent prendre une mauvaise tournure et s’égarer.
Les combinaisons planétaires de la Lune
Lune/Soleil Problèmes concernant le soi, l'esprit, les émotions, l'éducation et la vitalité. Fluctuations de vos besoins émotionnels et du soutien que vous attendez des autres et du soutien que vous apportez aux autres. Ces émotions peuvent s'attacher à de nombreuses situations et circonstances, mais fondamentalement, elles fonctionnent comme le besoin d'un nourrisson d'attention et d'amour de sa mère. Ainsi, lors des périodes lunaires fortes, vous pouvez vous retrouver déconcerté par une vague d'émotions enfantines lors de situations d'adulte.
Lune/Mercure Les pensées arrivent souvent sur les émotions et nous pensons aux choses que nous ressentons. De plus, les pensées seront généralement colorées par nos émotions lorsque la Lune est conjointe à Mercure, et nous penserons plus clairement et percevrons nos propres émotions de manière objective lorsque la Lune est opposée à Mercure. Pendant les carrés, nos pensées et nos émotions sont souvent en contradiction les unes avec les autres.
Lune/Vénus Vénus est la planète de l'amour et de l'appréciation. C'est la planète de la discrimination et filtre les émotions en goûts et dégoûts ou en amour et haine. Une grande partie de l’art consiste à reconnaître ce qui plaît ou déplaît à l’âme. En tant que tel, ce cycle marque des temps d’attachements, en amour, en art, en décoration, en musique et dans tout ce qui nous plaît dans le monde.
Lune/Mars Mars est un appel à l'action, un désir de faire quelque chose. Cela peut conduire à un travail productif ou à des périodes d’irritabilité et d’impulsivité. De plus, lorsque la Lune excite émotionnellement Mars et qu’il n’y a pas d’exutoire, elle peut se transformer en frustration, en colère ou en agressivité.
Lune/Jupiter L'optimisme, la générosité et l'expansion marquent l'envie de Jupiter – le sentiment que non seulement il y a de la place pour vous dans ce monde, mais qu'il y a aussi de la place pour grandir. Les temps de Jupiter peuvent être marqués par des rencontres, des fêtes et des actions spontanées.
Lune/Saturne La Lune et Saturne entraînent vos émotions entre possibilités et réalité, entre aspirations et déceptions. Bien que la discipline et le contrôle soient les clés pour réaliser les espoirs, la première réaction émotionnelle face à Saturne est généralement le découragement – comme un enfant réagissant à un père sévère qui dit « non ». Mais, comme la plupart des pères, le « non » est rarement définitif, et si vous utilisez ce cycle pour trier ce qui est vraiment irréaliste de ce qui est possible, vous pouvez réaliser la plupart de ce que vous voulez en laissant Saturne travailler pour vous.
Lune/Uranus Ce cycle se concentre sur le changement, à la fois sur l’aspiration au changement et sur l’absorption des chocs du changement. Émotionnellement, il peut s’agir d’une réaction à une surprise ou à un changement, ou d’une fascination pour les nouvelles technologies, ou pour l’inhabituel et l’excentrique.
Lune/Neptune Il s’agit de la montée et de la chute de la sensibilité au monde émotionnel qui vous entoure. Cela pourrait être marqué par l’émergence d’images subconscientes, une identification à la culture pop à travers la musique ou les films, ou un désir de se perdre dans l’évasion, l’alcool, la drogue ou la religion.
Lune/Pluton Il s'agit de gérer le passé, le karma, les morts et les choses que vous avez réprimées. Lorsque les émotions sont inhabituellement fortes ou puissantes, cela indique souvent que des problèmes du passé restent non résolus. Certains problèmes sont de nature mythique et ne peuvent être que reconnus et jamais entièrement résolus.
Lune/Nœud À la conjonction, la Lune est à son nœud nord, la tête du dragon, et c'est le moment d'absorber les leçons spirituelles et d'apprendre des autres. Pendant l'opposition, la Lune est au Nœud Sud, la queue du dragon, et c'est le moment d'enseigner, de créer ou d'utiliser ce que vous avez appris.
Lune/Ascendant Cette combinaison concerne ce que vous ressentez à propos de l’image que vous vous faites et comment vous apparaissez aux autres. C'est donc un cycle mêlant fierté et conscience de soi. Mettez-vous en avant lorsque la Lune est à votre Ascendant et retenez-vous lorsqu'elle est en opposition.
Lune/Milieu du Ciel Cette ligne parle de reconnaissance et de reconnaissance de la part du monde. En un mot, ne vous attendez pas à beaucoup d’éloges lorsque la Lune est en face de votre Milieu du Ciel et faites connaître vos sentiments lorsque la Lune est en conjonction avec elle.
| DateMar 2025 12:00 [UT/GMT] |
| Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 1 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 2 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 3 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 4 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 5 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 6 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 7 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 8 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 9 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 10 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 11 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 12 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 13 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 14 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 15 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 16 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 17 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 18 | chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 19 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 20 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 21 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 22 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 23 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 24 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 25 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 26 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 27 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 28 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 29 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 30 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar 31 |
| chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Change of course)sR ~ st->Retro
sD ~ st->Direct
Apr 7 (sD)
Jul 18 (sR)
Aug 11 (sD)
Nov 9 (sR)
Nov 29 (sD)
Apr 13 (sD)
Nov 11 (sR)
Nov 28 (sD)
Sep 6 (sR)
Dec 10 (sD)
Oct 14 (sD)
THE BEST AND WORST ASTROLOGICAL DAYS
FOR 2025
© This website is protected by copyright law and may not be reproduced, reprinted, or redistributed in any form
The Magi Society is pleased to announce that we have introduced improvements to our monthly Best and Worst Astrological Days Calendars.
Beginning in September 2024, our members will be able to have access to an extra month of this very valuable data.
More importantly, the criteria we will use for determining if a day is astrologically good or bad is being changed so that the data is more valuable to more of our fans.
In the past, especially during the last two months (July and August of 2024), there has been a very strong correlation between the US stock market and our best and worst astrological days – in other words US stocks went up during the days we predicted would be good astrological days, and US stocks went down during the days we predicted would be bad astrological days.
During July and August, this was the case over 85% of the time.
The reason for this is that especially for the July and August data, the Magi Society placed a lot of weight on the financial aspects of each day – this makes eminent sense because our Best and Worst Days were meant to help you make good Natalizations and you cannot have a successful natalization if you go broke. For the 17 categories for which we chose good and bad days, success for 13 of the 17 depended on making money – for example it is not possible to have a successful marriage if the marriage is always in poverty.
But most of our new fans who come to our site do not understand what “natalizations” are and these fans are much more interested in knowing if a day is going to be filled with land mines (star crossed) as opposed to a day that will be happy, smiley, sunny in mood, and maybe filled with potential good and opportunity.
For this reason, WE HAVE CHANGED THE PURPOSE of our Best and Worst Astrological Days column, and we are now providing you with the Magi Society’s opinions as to which days each month are the most star crossed, unlucky and filled with land mines, and which days each month are the friendliest, hopeful, sunny in mood and most filled with opportunity.
The contrast between whether a day is good or bad can be summed up as land mine days versus friendly days. Problems are much more likely to arise during land mine days and you should not natalize anything important during such days.
Good things are much more likely to come during friendly days and such days are much more likely to provide you with help from Angels. You are much more likely to meet someone new that will help you. And if you are with other people, you will all enjoy yourselves more. Memorable moments are much more likely to happen. If you know a day is a land mine day, you can avoid land mines by being super careful and vigilant, and taking no risks.
We will explain more each time we make a monthly posting.
Here now are the best and worst astrological days for January 2025 Friendly Days - January 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 29 Land Mine Days - January 6, 7, 13, 14, 27, 28 the best and worst astrological days for February 2025 Friendly Days - February 8, 9, 10, 11, 25, 27 Land Mine Days - February 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 Friendly Days - March 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26 Land Mine Days - March 1, 2, 9, 10, 11, 14, 24, 25, 28, 29
Our MagicalOracle Mobile Web App is the easiest way to know what kind of transits you have on any day and time, and you can check it anywhere in the world at any time by using your IPhone or Android, PC computer, or tablet. A great thing about the way the Divine Astrological System is that no matter how bad the stars get, when you know about bad stars ahead of time, things are not as bad because you are not caught off guard. And if you make sure you do not natalize important matters on bad days or during your bad transits, you will always make good progress in your life. Be sure to make important natalizations only when the daily stars are good and your personal transits are also good; this will help you to succeed. You can read more about natalizations by clicking here. This site was previously known as the Love & Money Calendar™ |
To see the Best (and Worst) Days in August 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in July 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in June 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in May 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in April 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in March 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in February 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in January 2024 click here
To see the Best (and Worst) Days in December 2023 click here
To see the Best (and Worst) Days in November 2023 click here
To see the Best (and Worst) Days in October 2023 click here
To see the Best (and Worst) Days in September 2023 click here
1. Best and Worst Astrological Days Calendar
Our Best and Worst Astrological Days Calendar is a day by day planner that informs you which are the best and worst days of each month for doing very important things such as buying a car, going out on a first date, meeting anyone for the first time, opening a bank account, carrying out a seduction, etc.
These best and worst days are selected based on the Eastern Time Zone in the United States. Because there are 24 standard time zones, a good day in New York may not be a good day in Hong Kong so we also provide you the following free service.
2. Cosmic Weather System
Our Cosmic Weather System is an hour by hour planner that helps you know which are the best and worst hours of each day in any time zone.
You may access our Best and Worst Astrological Days by clicking here.
3. Starcope
Click here to view Magi StarScope for today
We chose the above dates based on the Planetary Geometry of each day in the month . We explain how to do this in our third book. We also made some groundbreaking discoveries about astrology and revealed them in our third book, Magi Astrology: the Key to Success in Love and Money. The book is over 400 pages (you may download for free the first 300 pages by clicking here)..
We believe the LoveOracle™ is fun to use, and can be of help to you in your love life. But please remember that any matter of love or sex is serious business. You can get the most out of the LoveOracle™ if you learn all of the principles of Magi Astrology related to both love and sex, especially about TRANSITS.
Click here to download a free PDF copy of the Magi Society’s third book.
QU'EST-CE QUE LE MOUVEMENT RÉTROGRADE DES PLANÈTES ?
Si vous observez le ciel étoilé la nuit, vous remarquerez que tout — les étoiles, les planètes, la Lune — participe à un mouvement perpétuel. Elles se lèvent à l'Est, culminent au-dessus de nos têtes et se couchent à l'Ouest. Ce mouvement résulte de la rotation de la Terre autour de son axe, et il est relativement rapide : une rotation complète du ciel ne prend que 24 heures.
Mais il existe aussi un autre type de mouvement dans le ciel. Si vous prenez une photo du ciel à la même heure, disons à 2 heures du matin, nuit après nuit, vous remarquerez que le ciel ne reste pas le même. Les étoiles forment une sorte d'arrière-plan fixe, mais les lumières (enfin, vous avez la possibilité de ne voir que la Lune la nuit) et les planètes se déplacent sur le fond des étoiles. Ce mouvement est beaucoup plus lent : le plus rapide des voyageurs, la Lune, termine son parcours dans le ciel en un mois environ, tandis que le plus lent de ceux visibles à l'œil nu, Saturne, fait la même chose en 30 ans environ.
Les planètes se déplacent le long de l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire du Soleil sur fond d'étoiles. L'écliptique est donc utilisée comme une sorte de règle ou de mètre ruban qui nous aide à définir exactement où se trouve une planète dans le ciel à un moment donné. Si nous disons que Mercure est actuellement dans le 2e degré du Lion, cela signifie simplement que, par rapport à l'écliptique, Mercure se trouve quelque part entre ses points imaginaires qui pourraient être étiquetés comme « 1° Lion » et « 2° Lion ».
Par rapport à l'écliptique, les planètes se déplacent normalement d'ouest en est (à l'opposé du mouvement rapide qui résulte de la rotation de la Terre autour de son axe). Mais à un certain stade de leur mouvement, une planète ralentit progressivement puis commence à reculer, c'est-à-dire d'est en ouest. C'est exactement ce qu'on appelle le mouvement rétrograde . Sa durée varie selon les planètes : par exemple, Mercure recule pendant environ 3 semaines, puis reprend son mouvement normal vers l'avant, tandis que Vénus reste rétrograde pendant environ un mois et demi.
Il n'y a rien de mystique dans ce changement de direction. Il est décrit dans de nombreux manuels d'astronomie. Il s'agit bien sûr d'un phénomène visuel. En réalité, aucune planète ne change de direction, elles continuent simplement à tourner autour du Soleil. Il existe des schémas expliquant comment ce phénomène fonctionne, mais je ne veux pas vous ennuyer en vous montrant ces schémas. Si cela vous intéresse, vous devriez pouvoir les trouver facilement dans les manuels d'astrologie et d'astronomie.
Je vais vous proposer une analogie simple qui vous donnera une idée de la manière dont cela fonctionne. Imaginons que vous voyagez en train et qu'un autre train circule à côté du vôtre dans la même direction. Si cet autre train est légèrement plus lent que le vôtre, vous aurez l'impression qu'il recule, alors qu'en fait il avance. Le phénomène de mouvement rétrograde fonctionne de manière similaire : en fonction des vitesses relatives de la Terre et d'une autre planète, dans leur mouvement autour du Soleil, il peut sembler que cette planète recule.
Toutes ces explications relevaient jusqu'ici de l'astronomie pure, un peu ennuyeuses, mais nécessaires pour comprendre le fonctionnement des choses. Nous en arrivons maintenant à l'astrologie.
UN EXEMPLE DÉTAILLÉ
Alors que les astronomes expliquent simplement la mécanique du mouvement rétrograde, nous, astrologues, essayons de comprendre quelle signification ce phénomène pourrait nous transmettre.
Notons que par suite du mouvement rétrograde, une planète passe trois fois sur le même segment de l'écliptique. Par exemple, lors du mouvement rétrograde de Mercure en juillet 2006, Mercure s'est arrêté dans son mouvement apparent contre le ciel étoilé le 4 juillet alors qu'il se trouvait au 2e degré du Lion. Mercure est ensuite reparti en arrière et a continué de se déplacer de cette façon jusqu'à ce qu'il atteigne le 22e degré du Cancer. Le 29 juillet, il s'est arrêté et a repris son mouvement normal vers l'avant.
Ainsi, dans le processus de mouvement rétrograde, Mercure se déplaçait en arrière le long d'un segment de l'écliptique allant du 2e degré du Lion au 22e degré du Cancer. Cependant, pour atteindre le 2e degré du Lion, Mercure devait déjà passer le long du même segment de l'écliptique. Il a d'abord traversé le 22e degré du Cancer vers le 17 juin. Et après être revenu au même 22e degré du Cancer en mouvement rétrograde, Mercure a parcouru le même segment une troisième fois, jusqu'à ce qu'il atteigne à nouveau le 2e degré du Lion — cela s'est produit vers le 12 août.
L'histoire entière ressemble à ceci :
- 22ème degré du Cancer le 17 juin (point 1 sur la photo ci-dessous),
- 2ème degré du Lion le 4 juillet (point 2),
- 22ème degré du Cancer le 29 juillet (point 3),
- 2ème degré du Lion le 12 août (point 4).

Comme vous pouvez le voir, Mercure se déplace le long du même segment de l’écliptique (22 Cancer – 2 Lion) trois fois : du point 1 au point 2 (direct), du point 2 au point 3 (rétrograde) et du point 3 au point 4 (direct).
En tant qu'astrologues, nous devrions penser en termes de « comme en haut, ainsi en bas ». Alors, que pourrait signifier pour nous, les êtres terrestres, si Mercure céleste s'arrêtait, reculait puis avançait à nouveau, passant trois fois par le même segment de l'écliptique en cours de route ?
LE SYMBOLISME DU MOUVEMENT RÉTROGRADE
Mon professeur d'astrologie, la mathématicienne et ingénieure aéronautique russe Augustina Semenko, avait l'habitude de dire que toute l'histoire du mouvement rétrograde est une question de changement de stéréotype .
Un stéréotype ? Qu'est-ce que c'est ?
Que nous en soyons conscients ou non, nous avons dans notre vie des points de référence pour nos expériences, des modèles ou des schémas qui définissent exactement la manière dont nous exécutons telle ou telle activité. Nous avons tendance à communiquer d'une certaine manière qui nous est propre, nos préférences pour apprendre une nouvelle information peuvent être très différentes de celles des autres. Nous préférons lire certains types d'articles dans certains journaux, exprimer nos pensées d'une manière qui nous est propre. Tous ces détails de notre approche personnelle de la communication peuvent être perçus comme le stéréotype de Mercure .
Le stéréotype de Vénus concerne nos goûts et nos dégoûts, nos valeurs, nos attirances et nos modes. Nous préférons certains styles, certaines couleurs, nous pouvons ressentir des affinités avec certaines personnes mais pas avec d'autres. Nous avons des préférences spécifiques en matière de nourriture et de boissons.
Le stéréotype de Mars concerne la façon dont nous utilisons notre énergie pour atteindre nos objectifs. Il définit notre approche du travail, du sport, de l'exercice, notre capacité à poursuivre nos objectifs et à nous défendre, tant physiquement que psychologiquement. Mars est étroitement lié à l'énergie sexuelle et à la façon dont nous exprimons notre sexualité.
L’idée importante est que nos stéréotypes ne restent pas les mêmes tout au long de la vie. Ils ont tendance à changer, à évoluer et à se développer. Cependant, les changements dans nos attitudes peuvent être plus perceptibles pour les personnes qui ne sont pas très proches de nous. Et la dernière personne à remarquer un changement, c’est nous-mêmes.
Quoi qu’il en soit, l’idée est que les changements les plus importants dans nos stéréotypes se produisent pendant le mouvement rétrograde des planètes qui leur sont associées.
Avant le point 1 du graphique ci-dessus, nous sommes heureux d'utiliser l'ancien stéréotype. Cependant, au cours de la période allant du point 1 au point 2, l'ancien stéréotype devient de plus en plus faible jusqu'à disparaître complètement au point 2.
Nous nous retrouvons dans ce monde sans stéréotypes et nous avons l'impression d'avoir perdu quelque chose. Nous revenons en arrière pour essayer de retrouver ce que nous avons perdu, et la période du point 2 au point 3 est celle où nous n'avons plus aucun stéréotype du tout et en cherchons un. C'est une période étrange et intéressante où beaucoup de choses peuvent se produire, et certaines d'entre elles nous auraient semblé impossibles un peu plus tôt. Certaines actions habituelles et basiques peuvent cependant ne pas être très efficaces dans ces moments-là, car nous n'avons pas de base solide pour affronter le monde.
Nous acquérons un nouveau stéréotype vers le point 3, puis la période allant du point 3 au point 4 est celle où nous apprenons à l'utiliser, ce qui prend un certain temps.
PLANÈTES PERSONNELLES
Parmi les dix planètes utilisées dans l'astrologie traditionnelle, le Soleil et la Lune (on les appelle aussi « planètes », par commodité) ne sont jamais rétrogrades, nous n'en parlerons donc pas ici. Uranus, Neptune et Pluton sont des planètes dites supérieures. Elles se déplacent très lentement et leurs aspects et leurs entrées dans les signes du zodiaque sont généralement associés à des événements ou des transformations mondiaux, des processus qui échappent de loin à notre contrôle et à notre compréhension. Nous n'aborderons donc pas non plus les planètes supérieures dans cet article. Elles restent rétrogrades pendant environ six mois, puis directes pendant encore six mois.
Jupiter et Saturne sont des planètes sociales et jouent un rôle majeur dans l'étude astrologique de l'économie et de la politique, mais pas tant dans notre vie personnelle, du moins pas directement. Jupiter rétrograde pendant environ quatre mois chaque année, tandis que Saturne — pendant environ cinq mois.
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les planètes personnelles : Mercure, Vénus et Mars. Je trouve que leurs périodes de mouvement rétrograde sont les plus importantes dans notre vie quotidienne. En fait, elles sont si importantes que je dirais que tout le monde devrait les connaître. Cette connaissance pourrait nous aider à éviter de nombreuses frustrations et à rendre nos efforts beaucoup plus efficaces.
Les périodes rétrogrades de Mercure sont les plus importantes du point de vue pratique et elles se produisent assez souvent, trois à quatre fois par an. Les exemples d'événements que je vais donner ici concerneront donc principalement Mercure rétrograde.
Vénus rétrograde est un phénomène plus rare, il se produit une fois tous les deux ans. Mars rétrograde encore plus rarement. Vous pouvez voir les périodes rétrogrades les plus proches des planètes personnelles sur les pages correspondantes : Périodes rétrogrades de Mercure , Périodes rétrogrades de Vénus et Périodes rétrogrades de Mars .
DU POINT 1 AU POINT 2 : LA PÉRIODE DE LA DISPARITION DES VIEUX STÉRÉOTYPES
Durant cette période, la planète est toujours directe mais elle ralentit progressivement, jusqu'à s'arrêter complètement au Point 2.
Du point de vue astrologique, c'est la période où le vieux stéréotype devient rapidement démodé et obsolète. Au point 2, il va être complètement abandonné.
Dans la vie réelle, c'est généralement la période d'activité intense dans les domaines de la vie liés à la planète, qui est sur le point de devenir rétrograde. Par exemple, lorsque Mercure est dans cette période, on a le sentiment que même si Mercure ralentit, ses affaires avancent à toute allure. Le nombre de réunions, de messages envoyés, de lettres, de contrats signés augmente considérablement, comme si les gens cherchaient désespérément à utiliser autant que possible le vieux stéréotype, tant qu'il existe encore.
La principale particularité de cette période est que tout ce qui est fait selon l'ancien stéréotype revient souvent pour être réévalué, corrigé, reprogrammé ou peut tout simplement devenir sans intérêt. Alors que Mercure commence à reculer après le point 2, les affaires humaines qui lui sont associées ont également tendance à reculer.
Le conseil pour cette période est donc le suivant : n'essayez pas d'en faire trop lorsque la planète est dans la première partie de sa période de mouvement rétrograde, du Point 1 au Point 2. Il y a de fortes chances que tout ce que vous ferez vous revienne et nécessite des corrections importantes, voire devienne complètement inutile car cela a été fait sous la conduite d'un vieux stéréotype (qui disparaît au Point 2) .
LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU STÉRÉOTYPE (DU POINT 2 AU POINT 3)
C'est une période où le vieux stéréotype n'existe plus, mais il n'y a pas non plus de nouveau stéréotype. Dans le ciel, la planète s'est arrêtée au point 2 et a commencé à reculer, d'abord très lentement, puis plus rapidement. Nous avons l'impression d'avoir perdu quelque chose, alors nous nous arrêtons et faisons demi-tour pour tenter de le retrouver.
Mais ce que nous recherchons en réalité, c'est un nouveau stéréotype pour les domaines de la vie qui sont régis par la planète rétrograde. Nous le trouverons lorsque la planète atteindra le point 3, mais pour l'instant, il n'y a pas de stéréotype à utiliser et, de ce fait, la période de mouvement rétrograde peut nous apporter des expériences plutôt étranges.
Un conseil habituel donné par les astrologues est le suivant : n'achetez rien d'important si cela est lié à la planète actuellement rétrograde . Cela signifie que lorsque Mercure est rétrograde, il serait judicieux de ne pas acheter d'ordinateurs, de calculatrices, de téléphones, de matériel de bureau et autres choses similaires. Vénus est liée aux vêtements de mode, aux bijoux, à la gastronomie, aux cosmétiques ou à tout ce qui a une grande valeur en général. Lorsque Mars est rétrograde, il est conseillé de ne pas acheter d'outils, de machines, d'équipements sportifs, etc. Cela dit, je vous déconseille tout achat important lorsque Mercure est rétrograde, car nous sommes trop enclins à faire des erreurs de calcul à ces moments-là.
Pourquoi cela ? Une explication possible est que le mouvement rétrograde est la période où nous n'avons pas de stéréotype qui influencerait normalement nos décisions. En conséquence, notre décision d'acheter quelque chose ne peut souvent pas être basée sur quelque chose de solide, et plus tard, après avoir choisi un nouveau stéréotype au point 3, l'article nouvellement acheté peut tout simplement ne pas correspondre à ce nouveau stéréotype. Nous pourrions alors décider qu'il n'est pas aussi utile ou précieux que nous le pensions, et l'article acheté sous une planète rétrograde peut facilement être abandonné. D'une manière ou d'une autre, il arrive aussi souvent qu'un article acheté à de telles périodes présente des défauts cachés, et ces défauts ne sont généralement découverts que lorsque la planète devient directe.
Dans le même ordre d’idées, un autre conseil populaire dit que si vous avez rencontré quelqu’un pour la première fois alors que la planète associée au type de cette rencontre était rétrograde, il y a de fortes chances que vous ne rencontriez plus jamais cette personne ou ces personnes . Imaginons que quelqu’un soit venu vous voir avec une idée merveilleuse, que vous étiez tous les deux enthousiastes et que vous ayez décidé de faire quelque chose ensemble à l’avenir. Le problème est le suivant : aucun de vous n’avait une compréhension claire de ce que vous vouliez vraiment et de ce qui était bon pour vous – aucun de vous n’avait de stéréotype approprié sur lequel fonder vos décisions. Par conséquent, une fois que la planète rétrograde aura atteint le point 3, vous pourriez considérer l’accord récent comme quelque chose de totalement hors de propos.
Avec Mercure rétrograde, il s'agit d'accords commerciaux ou d'autres idées en général, tandis qu'avec Vénus rétrograde, on peut dire à peu près la même chose des relations amoureuses. En règle générale, c'est une mauvaise idée de se marier lorsque Vénus est rétrograde. Tout simplement parce que votre compréhension des raisons pour lesquelles vous vous êtes mariés peut changer considérablement très rapidement, et ce changement pourrait ne pas être très bon pour le mariage. Toute la période rétrograde de Vénus peut être difficile pour un couple existant, surtout si leurs relations sont devenues un peu ennuyeuses au fil du temps. Ils pourraient décider qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Lorsque Mars est rétrograde, une première rencontre avec un entraîneur sportif peut s'avérer vaine. En fait, Mercure est si important pour la compréhension mutuelle dans tout type de relation que Mercure rétrograde est défavorable pour rencontrer de nouvelles personnes, je dirais.
Bien qu'il soit commode de penser aux périodes rétrogrades en termes psychologiques (c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe uniquement dans notre esprit), notre monde semble être un peu plus complexe. En fait, beaucoup de choses tournent bizarrement mal quand une planète personnelle, en particulier Mercure, devient rétrograde. Les échecs de communication sont fréquents. Une fois, j'ai passé deux semaines sans connexion Internet (ce qui est très inhabituel pour moi) parce que le haut débit de Sky ne fonctionnait tout simplement pas. À une autre occasion, mais c'était pendant la rétrogradation de Mars, le système de chauffage est soudainement tombé en panne au milieu de l'hiver. Lisez les journaux lorsqu'une planète personnelle est rétrograde et vous trouverez un grand nombre d'exemples de divers échecs et troubles liés au symbolisme de cette planète.
L’un des exemples les plus frappants est celui d’une erreur presque inimaginable qui a été rapportée dans les journaux fin mars 2019. « Un avion de British Airways qui devait partir de Londres pour Düsseldorf a fait voler ses passagers à Édimbourg par erreur ». L’erreur n’a été détectée qu’à l’atterrissage, lorsque les passagers ont été accueillis à Édimbourg. Comment cela a-t-il pu se produire ? Mais c’est arrivé. Et cette année-là, Mercure était rétrograde, entre les points 2 et 3, du 6 au 29 mars.
Vous avez certainement déjà l'impression qu'une période rétrograde est quelque chose de maléfique. Mais ce n'est pas toujours le cas, et pas nécessairement. Mon avis est que si vous savez ce qui se passe, une telle période peut être extrêmement productive.
Tout d'abord, la période du point 2 au point 3 est celle où beaucoup de nouvelles idées nous viennent. Certaines d'entre elles sont merveilleuses, d'autres sont étranges, mais le fait important est que nous sommes capables de les remarquer et de les apprécier parce que notre esprit n'est lié à aucun stéréotype, il est plus ouvert que d'habitude. Une conséquence importante est que certaines des nouvelles idées peuvent vous aider à résoudre un problème très ancien, à trouver une issue à une impasse. Une autre chose importante est que vous pouvez soudainement voir une direction totalement nouvelle dans votre vie - quelque chose que vous ne pouviez même pas imaginer auparavant. Mais attendez ! Ne faites pas votre choix final dans une affaire importante maintenant, alors que la planète est encore rétrograde, attendez qu'elle atteigne le point 3, et puis un peu plus...
DU POINT 3 AU POINT 4 : LA MATURATION DU NOUVEAU STÉRÉOTYPE
Théoriquement parlant, au point 3, nous obtenons un nouveau stéréotype. Cependant, la façon de penser du genre « oh, demain Mercure va devenir direct, alors j'irai acheter ce truc » n'est pas très productive. La planète se déplace toujours le long du même morceau de l'écliptique, le nouveau stéréotype n'est pas encore bien établi et les décisions qui vous sont venues à l'esprit dans un passé récent peuvent encore avoir une influence significative sur ce qui se passe pendant cette période.
En fin de compte, si vous prévoyez quelque chose de très important et que cela peut attendre, laissez la planète dépasser le point 4 et continuez seulement ensuite.
UNE CONCLUSION
Point 1 – Point 2, la période de disparition des vieux stéréotypes
N'essayez pas d'en faire trop, ou si vous ne pouvez pas l'éviter, préparez-vous à revenir dans un avenir proche aux décisions que vous avez prises pendant cette période.
La meilleure tactique est de laisser tomber les vieilles choses et de se préparer au virage serré à venir.
Point 2 – Point 3, la recherche d’un nouveau stéréotype
Ne le faites pas :
- Commencez ou achetez quelque chose d’important si cela est associé à la planète rétrograde.
- Fiez-vous à tout ce qui est apparu pour la première fois dans votre vie pendant cette période, si cela est associé à la planète rétrograde.
- Soyez frustré si quelque chose ne se passe pas comme prévu. En fait, méfiez-vous de tout ce qui se passe extrêmement bien pendant une période rétrograde, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui ne va pas.
- Soyez surpris de voir des personnes de votre passé (amis ou proches pour Mercure, amants pour Vénus, collègues, concurrents et ennemis pour Mars). Elles pourraient vous rappeler un problème que vous n'avez pas su résoudre à l'époque.
Faire:
- Soyez attentif aux nouvelles idées qui vous viennent, même si elles vous semblent étranges. Elles peuvent vous montrer de nouvelles voies de réussite ou une façon de sortir d’une impasse.
- Essayez de revenir à un ancien problème et de le résoudre à nouveau, cette fois en utilisant une approche nouvelle et non traditionnelle.
- Soyez ouvert d’esprit et flexible.
Point 3 - Point 4, la maturation du nouveau stéréotype
Pour plus de sécurité, attendez que la planète atteigne le point 4.
Retrograde Planets 2025 - Astrology Online Calendar
| Annual Retrogradity - 2025 | |||||||||||||||||||||
| Month | MAX Rx | Detail | |||||||||||||||||||
| Jan 2025 | 4 | detail | |||||||||||||||||||
| Feb 2025 | 3 | detail | |||||||||||||||||||
| Mar 2025 | 3 | detail | |||||||||||||||||||
| Apr 2025 | 3 | detail | |||||||||||||||||||
| May 2025 | 2 | detail | |||||||||||||||||||
| Jun 2025 | 2 | detail | |||||||||||||||||||
| Jul 2025 | 6 | detail | |||||||||||||||||||
| Aug 2025 | 6 | detail | |||||||||||||||||||
| Sep 2025 | 6 | detail | |||||||||||||||||||
| Oct 2025 | 6 | detail | |||||||||||||||||||
| Nov 2025 | 7 | detail | |||||||||||||||||||
| Dec 2025 | 5 | detail | |||||||||||||||||||
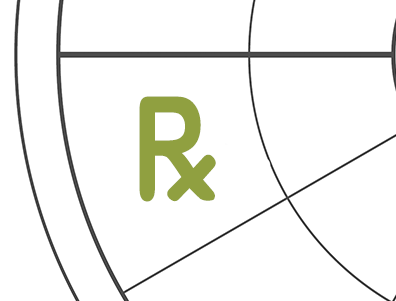
Quand les rétrogradations se produisent-elles et dans quel signe ? Les tableaux et images suivants montrent les planètes et les corps (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) et leurs cycles rétrogrades astrologiques par date et signe, de rétrograde à direct.
Une station est définie du point de vue de la Terre ; c'est le moment où une planète semble arrêter de se déplacer dans le ciel. La planète semble alors se déplacer lentement dans la direction opposée ; à ce moment-là, la planète est considérée comme stationnaire rétrograde. De même, une fois que la planète fait une station (s'arrête) et recommence à avancer, on parle de stationnaire directe.
Ce qui suit montre les cycles rétrogrades actuels et à venir des planètes. Notez que le Soleil et la Lune ne rétrogradent jamais. Les dates données révèlent non seulement les périodes rétrogrades, mais aussi les zones ou ombres rétrogrades .
Cette page indique les dates et heures auxquelles une planète entre dans la zone/ombre rétrograde, est stationnaire rétrograde, est stationnaire directe et quitte la zone/ombre rétrograde. Les zones rétrogrades sont des périodes de temps plus longues et englobent toute la période des degrés du zodiaque affectés par la rétrogradation.
Les horaires sont indiqués en heure de l'Est des USA .
Remarque : Bien que cette page présente les cycles rétrogrades de 2023 à 2026, certains cycles précédents sont inclus ici si la zone rétrograde s'étend jusqu'en 2023.
Neptune rétrograde du 2 juillet au 7 décembre 2024
- Neptune entre dans la zone rétrograde le 11 mars 2024, à 27° Poissons 08′
- Neptune stationne et devient rétrograde le 2 juillet 2024, à 29° Poissons 56′ Rx
- Neptune stationne et devient direct le 7 décembre 2024, à 27° Poissons 08′
- Neptune quitte la zone rétrograde le 28 mars 2025, à 29° Poissons 56′
Uranus rétrograde du 1er septembre 2024 au 30 janvier 2025
- Uranus entre dans la zone/ombre rétrograde le 15 mai 2024, à 23° Taureau 16′
- Uranus stationne et devient rétrograde le 1er septembre 2024, à 27° Taureau 15′ Rx
- Uranus stationne et devient direct le 30 janvier 2025, à 23° Taureau 16'
- Uranus quitte la zone/ombre rétrograde le 17 mai 2025, à 27° Taureau 15′
Jupiter rétrograde du 9 octobre 2024 au 4 février 2025
- Jupiter entre dans la zone/ombre rétrograde le 15 juillet 2024, à 11° Gémeaux 17′
- Jupiter stationne et devient rétrograde le 9 octobre 2024, à 21° Gémeaux 20′ Rx
- Jupiter stationne et devient direct le 4 février 2025, à 11° Gémeaux 17'D
- Jupiter quitte la zone/ombre rétrograde le 30 avril 2025, à 21° Gémeaux 20′
En savoir plus sur Mercure Rétrograde . Où transite Mercure Rétrograde par maison dans votre carte natale ? Est-il en conjonction avec une planète natale, votre Ascendant ou le Milieu du Ciel ? Lisez les interprétations de Mercure Rétrograde en Transit pour une signification plus personnalisée du cycle de transit.
 Qu'est-ce que Mars rétrograde ? Parfois, Mars semble reculer dans le ciel. « Apparaît » est le mot clé ici, car, techniquement parlant, aucune planète ne recule réellement sur son orbite autour du Soleil. En fait, elles ne ralentissent même pas. Les cycles rétrogrades-station-directs sont essentiellement des illusions qui résultent de notre point de vue depuis la Terre, simplement parce que la Terre orbite également autour du Soleil à une vitesse différente de celle des autres planètes. Mars est rétrograde environ 58 à 81 jours tous les 2 ans ou plus.
Qu'est-ce que Mars rétrograde ? Parfois, Mars semble reculer dans le ciel. « Apparaît » est le mot clé ici, car, techniquement parlant, aucune planète ne recule réellement sur son orbite autour du Soleil. En fait, elles ne ralentissent même pas. Les cycles rétrogrades-station-directs sont essentiellement des illusions qui résultent de notre point de vue depuis la Terre, simplement parce que la Terre orbite également autour du Soleil à une vitesse différente de celle des autres planètes. Mars est rétrograde environ 58 à 81 jours tous les 2 ans ou plus.
Mars rétrograde du 6 décembre 2024 au 23 février 2025
- Le 4 octobre 2024, Mars entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 17° Cancer 01′
- Le 6 décembre 2024, Mars stationne et devient rétrograde à 6° Lion 10'Rx
- Le 23 février 2025, Mars stationne et tourne directement à 17° Cancer 01'D
- Le 2 mai 2025, Mars quitte la zone rétrograde (zone post-rétrograde) à 6° Lion 10′
Vénus rétrograde du 1er mars au 12 avril 2025
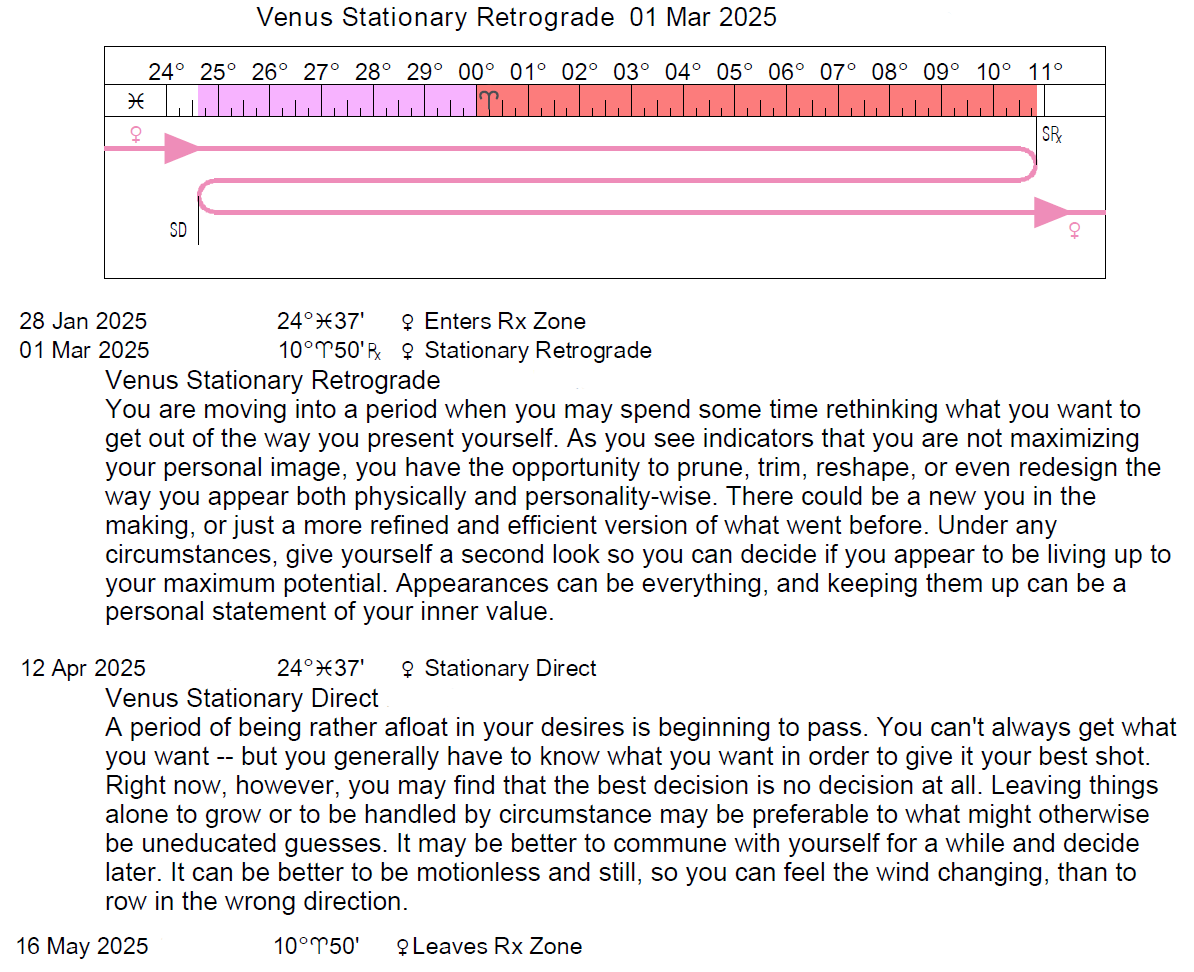
Cycle rétrograde de Vénus : de mars à avril 2025
- Le 28 janvier 2025, Vénus entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 24° Poissons 37′
- Le 1er mars 2025, Vénus stationne et devient rétrograde à 10° Bélier 50′ Rx
- Le 12 avril 2025, Vénus stationne et devient directe à 24° Poissons 38′
- Le 16 mai 2025, Vénus quitte la zone rétrograde (ombre post-rétrograde) à 10° Bélier 50′
Mercure rétrograde du 15 mars au 7 avril 2025
- Le 1er mars 2025, Mercure entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 26° Poissons 49′
- Le 15 mars 2025, Mercure stationne et devient rétrograde à 9° Bélier 36′ Rx
- Le 7 avril 2025, Mercure stationne et devient direct à 26° Poissons 49′
- Le 26 avril 2025, Mercure quitte la zone rétrograde (ombre post-rétrograde) à 9° Bélier 36′
Pluton rétrograde du 4 mai au 13 octobre 2025
- Pluton entre dans la zone/ombre rétrograde le 10 janvier 2025, à 1° Verseau 22′
- Pluton stationne et devient rétrograde le 4 mai 2025, à 3° Verseau 49′ Rx
- Pluton stationne et devient direct le 13 octobre 2025, à 1° Verseau 22′
- Pluton quitte la zone/ombre rétrograde le 4 février 2026, à 3° Verseau 49′
Neptune rétrograde du 4 juillet au 10 décembre 2025
- Neptune entre dans la zone rétrograde le 13 mars 2025, à 29° Poissons 22′
- Neptune stationne et devient rétrograde le 4 juillet 2025, à 2° Bélier 11′ Rx
- Neptune stationne et devient direct le 10 décembre 2025, à 29° Poissons 22′
- Neptune quitte la zone rétrograde le 31 mars 2026, à 2° Bélier 11′
Saturne rétrograde du 12 juillet au 27 novembre 2025
- Saturne entre dans la zone/ombre rétrograde le 6 avril 2025, à 25° Poissons 09′
- Saturne stationne et devient rétrograde le 13 juillet 2025 à 1° Bélier 56′ Rx
- Saturne stationne et devient direct le 27 novembre 2025, à 25° Poissons 09'D
- Saturne quitte la zone/ombre rétrograde le 2 mars 2026, à 1° Bélier 56′
Saturne entre dans le signe du Bélier
Saturne est en Bélier du 24 mai 2025 au 1er septembre 2025, puis du 13 février 2026 au 12 avril 2028.
- 24 mai 2025 23h35 Saturne entre en Bélier
- 1er septembre 2025 04:06 Saturn Rx entre en Poissons
- 13 février 2026 19h11 Saturne entre en Bélier
- 12 avril 2028 23h39 Saturne entre en Taureau
Pendant que Saturne est en Bélier, nous pouvons initialement ressentir de la frustration lorsque nous poursuivons nos objectifs individuels. Nous pouvons nous sentir mal à l’aise face à de grandes démonstrations d’individualité ou à un comportement centré sur nous-mêmes pendant que Saturne est en Bélier. Cependant, cette période offre également une occasion unique de croissance personnelle. En apprenant à équilibrer nos besoins individuels avec les responsabilités collectives, nous pouvons surmonter cet inconfort. En reconnaissant la nécessité de cette attention équilibrée, nous pouvons élargir notre potentiel de développement personnel. Sinon, nous risquons de nous limiter par inadvertance.
Ces dernières années, l'attention portée à soi-même a été très importante. Les énergies du Bélier ont été vénérées et célébrées. Saturne en Bélier vise à modérer cette attention là où elle a été excessive. Nous devenons plus critiques à l'égard de cette célébration, en notant les cas où une attitude de « moi d'abord » ou « d'expression de son vrai moi » à tout prix a joué contre nous. En fait, Saturne en Bélier recule devant une importance excessive de soi. Cependant, il peut aller trop loin dans cette direction alors que l'objectif devrait être de corriger les choses qui ont été immodérées ou déséquilibrées et excessives. Idéalement, nous nous efforçons d'atteindre des niveaux sains et équilibrés d'abnégation.
Pendant ce transit, nous pouvons faire preuve d'ingéniosité. C'est le moment idéal pour évaluer notre égoïsme et notre égocentrisme, en identifiant les domaines dans lesquels nous pouvons nous affirmer à notre propre détriment. Par exemple, dans notre quête de « vivre notre vérité », nous pouvons par inadvertance piétiner les libertés des autres. Le transit de Saturne en Bélier nous permet de reconnaître et de gérer ces comportements égocentriques, nous permettant ainsi de contrôler nos actions et leurs conséquences.
C'est aussi le moment d'explorer notre peur d'être perçu comme moins fort ou moins bon que la première place. Ces peurs peuvent limiter nos expériences, car nous pourrions abandonner une compétition ou éviter des activités où nous pourrions paraître moins compétents. En vérité, ces expériences pourraient être merveilleuses si nous les apprécions pour ce qu'elles sont plutôt que de nous inquiéter des résultats.
Pendant que Saturne est en Bélier en 2025 :
- il est en carré avec Jupiter en Cancer le 15 juin ( Jupiter carré Saturne )
- il sextile à Uranus le 11 août (Saturne sextile à Uranus)
Mercure rétrograde du 18 juillet au 11 août 2025
- Le 30 juin 2025, Mercure entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 4° Lion 15′
- Le 18 juillet 2025, Mercure stationne et devient rétrograde à 15° Lion 35'Rx
- Le 11 août 2025, Mercure stationne et devient direct à 4° Lion 15'D
- Le 25 août 2025, Mercure quitte la zone rétrograde (zone post-rétrograde) à 15° Lion 35′
Remarque : le début du 18 juillet 2025 est la date correcte pour la station rétrograde exacte de Mercure en utilisant EDT (l'image utilise fin du 17 juillet pour EST).
En savoir plus sur Mercure Rétrograde . Où transite Mercure Rétrograde par maison dans votre carte natale ? Est-il en conjonction avec une planète natale, votre Ascendant ou le Milieu du Ciel ? Lisez les interprétations de Mercure Rétrograde en Transit pour une signification plus personnalisée du cycle de transit.
Uranus rétrograde du 6 septembre 2025 au 3 février 2026
- Uranus entre dans la zone/ombre rétrograde le 20 mai 2025, à 27° Taureau 28'
- Uranus stationne et devient rétrograde le 6 septembre 2025, à 1° Gémeaux 28′ Rx
- Uranus stationne et devient direct le 3 février 2026, à 27° Taureau 28'
- Uranus quitte la zone/ombre rétrograde le 21 mai 2026, à 1° Gémeaux 28′
Mercure rétrograde du 9 au 29 novembre 2025
- Le 21 octobre 2025, Mercure entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 20° Scorpion 42′
- Le 9 novembre 2025, Mercure stationne et devient rétrograde à 6° Sagittaire 52'Rx
- Le 29 novembre 2025, Mercure stationne et devient direct à 20° Scorpion 42'D
- Le 16 décembre 2025, Mercure quitte la zone rétrograde (zone post-rétrograde) à 6° Sagittaire 52′
En savoir plus sur Mercure Rétrograde . Où transite Mercure Rétrograde par maison dans votre carte natale ? Est-il en conjonction avec une planète natale, votre Ascendant ou le Milieu du Ciel ? Lisez les interprétations de Mercure Rétrograde en Transit pour une signification plus personnalisée du cycle de transit.
Jupiter rétrograde du 11 novembre 2025 au 10 mars 2026
- Jupiter entre dans sa zone/ombre rétrograde le 17 août 2025, à 15° Cancer 05′
- Jupiter stationne et devient rétrograde le 11 novembre 2025, à 25° Cancer 09′ Rx
- Jupiter stationne et devient direct le 10 mars 2026, à 15° Cancer 05'D
- Jupiter quitte la zone/ombre rétrograde le 6 juin 2026, à 25° Cancer 09′
Mercure rétrograde du 26 février au 20 mars 2026
- Le 11 février 2026, Mercure entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 8° Poissons 29′
- Le 26 février 2026, Mercure stationne et devient rétrograde à 22° Poissons 34′ Rx
- Le 20 mars 2026, Mercure stationne et devient direct à 8° Poissons 29′
- Le 9 avril 2026, Mercure quitte la zone rétrograde (ombre post-rétrograde) à 22° Poissons 34′
En savoir plus sur Mercure Rétrograde . Où transite Mercure Rétrograde par maison dans votre carte natale ? Est-il en conjonction avec une planète natale, votre Ascendant ou le Milieu du Ciel ? Lisez les interprétations de Mercure Rétrograde en Transit pour une signification plus personnalisée du cycle de transit.
Pluton rétrograde du 6 mai au 15 octobre 2026
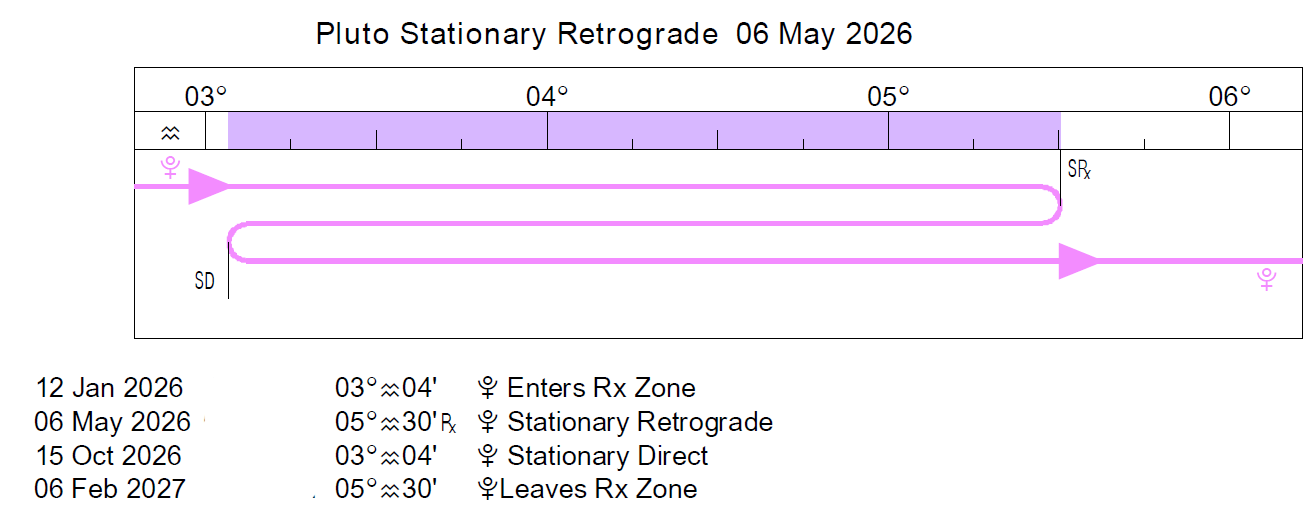
Pluton rétrograde en Verseau : du 6 mai au 15 octobre 2026
- Pluton entre dans la zone/ombre rétrograde le 12 janvier 2026, à 3° Verseau 04′
- Pluton stationne et devient rétrograde le 6 mai 2026, à 5° Verseau 30′ Rx
- Pluton stationne et devient direct le 15 octobre 2026, à 3° Verseau 04′
- Pluton quitte la zone/ombre rétrograde le 6 février 2027, à 5° Verseau 30′
Mercure rétrograde du 29 juin au 23 juillet 2026
- Le 12 juin 2026, Mercure entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 16° Cancer 19′
- Le 29 juin 2026, Mercure stationne et devient rétrograde à 26° Cancer 15'Rx
- Le 23 juillet 2026, Mercure stationne et devient direct à 16° Cancer 19'D
- Le 6 août 2026, Mercure quitte la zone rétrograde (zone post-rétrograde) à 26° Cancer 15′
En savoir plus sur Mercure Rétrograde . Où transite Mercure Rétrograde par maison dans votre carte natale ? Est-il en conjonction avec une planète natale, votre Ascendant ou le Milieu du Ciel ? Lisez les interprétations de Mercure Rétrograde en Transit pour une signification plus personnalisée du cycle de transit.
Neptune rétrograde du 7 juillet au 12 décembre 2026
- Neptune entre dans la zone rétrograde le 16 mars 2026, à 1° Bélier 37′
- Neptune stationne et devient rétrograde le 7 juillet 2026, à 4° Bélier 25′ Rx
- Neptune stationne et devient direct le 12 décembre 2026, à 1° Bélier 37′
- Neptune quitte la zone rétrograde le 2 avril 2027, à 4° Bélier 25′
Saturne rétrograde du 26 juillet au 10 décembre 2026
- Saturne entre dans la zone/ombre rétrograde le 20 avril 2026, à 7° Bélier 56′
- Saturne stationne et devient rétrograde le 26 juillet 2026 à 14° Bélier 45′ Rx
- Saturne stationne et devient direct le 10 décembre 2026, à 7° Bélier 56'D
- Saturne quitte la zone/ombre rétrograde le 15 mars 2027, à 14° Bélier 45′
Uranus rétrograde du 10 septembre 2026 au 8 février 2027
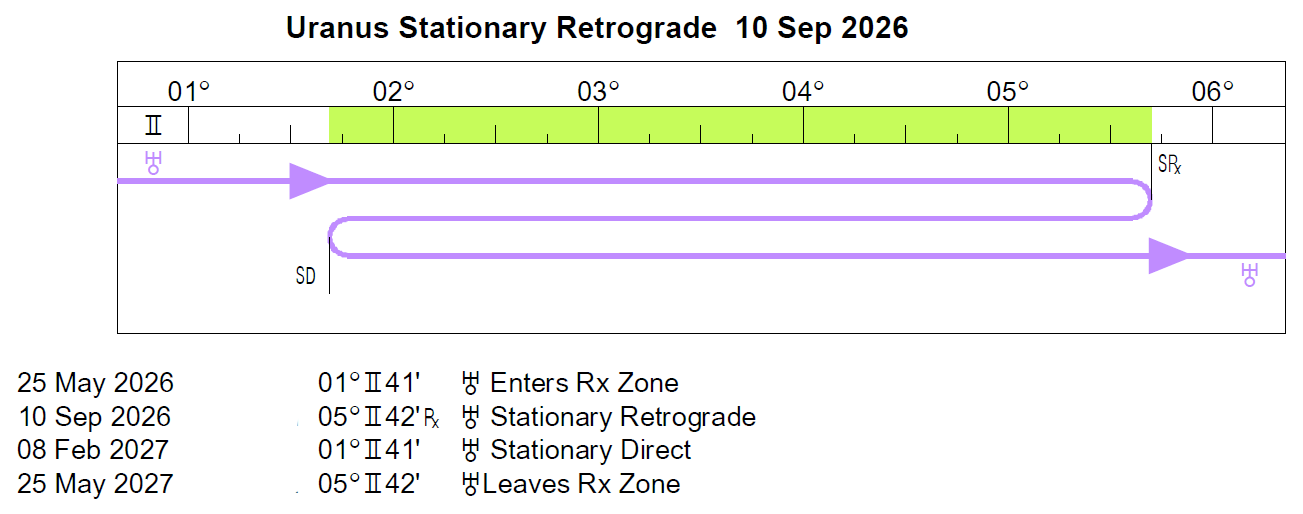
Uranus rétrograde en Gémeaux : 10 septembre 2026 – 8 février 2027
- Uranus entre dans la zone/ombre rétrograde le 25 mai 2026, à 1° Gémeaux 41′
- Uranus stationne et devient rétrograde le 10 septembre 2026, à 5° Gémeaux 42′ Rx
- Uranus stationne et devient direct le 8 février 2027, à 1° Gémeaux 41′
- Uranus quitte la zone/ombre rétrograde le 25 mai 2027, à 5° Gémeaux 42′
Vénus rétrograde du 3 octobre au 13 novembre 2026
- Le 31 août 2026, Vénus entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 22° Balance 52′
- Le 3 octobre 2026, Vénus stationne et devient rétrograde à 8° Scorpion 29′ Rx
- Le 13 novembre 2026, Vénus stationne et devient directe à 22° Balance 52′
- Le 15 décembre 2026, Vénus quitte la zone rétrograde (ombre post-rétrograde) à 8° Scorpion 29′
Mercure rétrograde du 24 octobre au 13 novembre 2026
- Le 4 octobre 2026, Mercure entre dans la zone rétrograde (ombre pré-rétrograde) à 5° Scorpion 02′
- Le 24 octobre 2026, Mercure stationne et devient rétrograde à 20° Scorpion 59'Rx
- Le 13 novembre 2026, Mercure stationne et devient direct à 5° Scorpion 02'D
- Le 30 novembre 2026, Mercure quitte la zone rétrograde (zone post-rétrograde) à 20° Scorpion 59′
En savoir plus sur Mercure Rétrograde . Où transite Mercure Rétrograde par maison dans votre carte natale ? Est-il en conjonction avec une planète natale, votre Ascendant ou le Milieu du Ciel ? Lisez les interprétations de Mercure Rétrograde en Transit pour une signification plus personnalisée du cycle de transit.
Jupiter rétrograde du 12 décembre 2026 au 12 avril 2027
- Jupiter entre dans la zone/ombre rétrograde le 16 septembre 2026, à 17° Lion 00′
- Jupiter stationne et devient rétrograde le 12 décembre 2026, à 27° Lion 01′ Rx
- Jupiter stationne et devient direct le 12 avril 2027, à 17° Lion 00'D
- Jupiter quitte la zone/ombre rétrograde le 10 juillet 2027, à 27° Lion 01′
Comparaison de magnitudes visuelles apparentes | ||
Objets | Constellations | Mag. |
Pleine Lune |
| -13 |
Quartier de Lune |
| -10 |
Vénus |
| -2,5 |
Jupiter |
| -2,5 |
Mars |
| -1,2 |
Sirius | Grand Chien | -1,45 |
Arcturus | Bouvier | -0,06 |
Véga | Lyre | +0,04 |
Capella | Cocher | +0,08 |
Rigel | Orion | +0,20 |
Altaïr | Aigle | +0,77 |
Bételgeuse | Orion | +0,80* |
Aldébaran | Taureau | +0,88 |
Epi | Vierge | +0,96 |
Antarès | Scorpion | +1** |
Pollux | Gémeaux | +1,15 |
Deneb | Cygne | +1,25 |
Régulus | Lion | +1,4 |
Castor | Gémeaux | +1,6 |
Polaris | Petite Ourse | +2 |
Note : * en moyenne (magnitude apparente variable entre 0,4 et 1,3) ** en moyenne (magnitude apparente variable entre 0,9 et 1,8) | ||
 |
Mars rétrograde en Lion :
L’orgueil peut nous pousser vers de plus hauts sommets, mais il peut aussi nous empêcher d’exprimer nos véritables sentiments, par exemple, ou nous empêcher d’apprendre véritablement de nos expériences et de celles des autres. Avec Mars rétrograde en Lion, nous pourrions voir davantage de bouderies ou de retraits pour faire valoir un point de vue. Le Lion gouverne les enfants, la créativité, les loisirs, le divertissement et la romance. En tant que tel, nous devrons peut-être réévaluer notre approche de ces questions. Nous pourrions ressentir une certaine frustration ou anxiété à ce sujet. Les projets peuvent ne pas démarrer comme prévu, peut-être en raison de l’hésitation, de la prudence et de la peur de prendre des risques. Des problèmes de santé peuvent être un facteur (en particulier dans les domaines gouvernés par le Lion – le cœur et le dos), et des accidents sont possibles tout au long de la période rétrograde de Mars.
- Le 18 décembre 1930, Mars a commencé son cycle rétrograde en Lion, à 16 Lion 49, est retourné en Cancer le 16 février 1930, puis a continué à transiter par le Cancer jusqu'à la fin de son cycle rétrograde le 8 mars 1931, à 27 Cancer 26.
- Le 4 décembre 1945, Mars a commencé sa rétrogradation en Lion à 3 Lion 14, est entré en Cancer le 26 décembre 1945, puis a continué en Cancer jusqu'à ce que Mars termine sa rétrogradation, devenant direct le 21 février 1946, à 14 Cancer 07.
- Le 8 janvier 1948, Mars a commencé son cycle rétrograde dans le signe de la Vierge, à 7 Vierge 37, est revenu dans le signe du Lion le 12 février 1948, puis a continué son transit du Lion jusqu'à ce qu'il termine sa phase rétrograde le 29 mars 1948, à 18 Lion 06.
- Mars était rétrograde entièrement dans le signe du Lion du 26 décembre 1962, à 24 Lion 48, au 16 mars 1963, à 5 Lion 20.
- Le 12 décembre 1977, Mars a commencé sa rétrogradation dans le signe du Lion à 11 Lion 34, est revenu en Cancer en mouvement rétrograde le 25 janvier 1978, puis a continué son transit du Cancer jusqu'à ce que Mars devienne direct le 2 mars 1978, à 22 Cancer 16.
- Le 16 janvier 1980, Mars a commencé sa phase rétrograde en Vierge, à 15 Vierge 21, est entré en Lion le 11 mars 1980, puis a continué en Lion jusqu'à la fin de son cycle rétrograde le 6 avril 1980, à 25 Lion 52.
- Le 2 janvier 1995, Mars a commencé son cycle rétrograde au début du signe de la Vierge, à 2 Vierge 40, est retourné en Lion le 22 janvier 1995, puis a continué en Lion jusqu'à ce que Mars devienne direct le 24 mars 1995, à 13 Lion 10.
- Mars était rétrograde entièrement dans le signe du Lion du 20 décembre 2009, à 19 Lion 42, jusqu'au 10 mars 2010, à 0 Lion 18.
- Mars commence sa rétrogradation dans le signe du Lion le 6 décembre 2024, à 6 Lion 11, revient dans le signe du Cancer le 6 janvier 2025, puis continue en Cancer jusqu'à ce que Mars termine sa rétrogradation le 23 février 2025, devenant direct à 17 Cancer 01.
- Le 10 janvier 2027, Mars commence sa phase rétrograde en Vierge, à 10 Vierge 26, revient en Lion le 21 février 2027, puis continue en Lion jusqu'à ce que Mars devienne direct le 1er avril 2027, à 20 Lion 55.
- Mars est rétrograde entièrement en Lion du 28 décembre 2041, à 27 Lion 40, au 18 mars 2042, à 8 Lion 11.
Mars est courageux, compétitif, assertif, défensif, dynamique, territorial, sexuel, passionné et égocentrique. Tant que Mars est rétrograde, agir de cette manière peut ne pas donner les résultats escomptés. Ce n'est pas tant un mauvais moment pour entreprendre de nouveaux projets que c'est une période où nous pouvons être moins courageux et plus anxieux à l'idée de faire de nouvelles choses. Ralentir est logique.
Nous ne sommes peut-être pas aussi directs dans la satisfaction de nos besoins sexuels. Lorsque nous ne parvenons pas à trouver des moyens d'exprimer nos désirs et notre colère, nous pouvons être confrontés à des sentiments de ressentiment ou de honte. Le flux d'énergie semble interrompu ou anormal et intermittent.
Retrograde Mars
| Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 |
|---|---|---|---|
| 5.10.2024 | 6.12.2024 | 24.02.2025 | 2.05.2025 |
| 5.11.2026 | 10.01.2027 | 1.04.2027 | 8.06.2027 |
| 10.12.2028 | 14.02.2029 | 5.05.2029 | 9.07.2029 |
| 25.01.2031 | 29.03.2031 | 13.06.2031 | 10.08.2031 |
| 5.04.2033 | 26.05.2033 | 1.08.2033 | 16.09.2033 |
| 3.07.2035 | 15.08.2035 | 15.10.2035 | 28.11.2035 |
| 20.08.2037 | 12.10.2037 | 23.12.2037 | 19.02.2038 |
| 24.09.2039 | 23.11.2039 | 9.02.2040 | 15.04.2040 |
| 24.10.2041 | 28.12.2041 | 18.03.2042 | 25.05.2042 |
| 26.11.2043 | 31.01.2044 | 21.04.2044 | 26.06.2044 |
| 5.01.2046 | 11.03.2046 | 28.05.2046 | 28.07.2046 |
| 4.03.2048 | 30.04.2048 | 10.07.2048 | 31.08.2048 |
| 2.06.2050 | 15.07.2050 | 13.09.2050 | 24.10.2050 |
Retrograde Venus
| Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 |
|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | 2.03.2025 | 13.04.2025 | 16.05.2025 |
| 31.08.2026 | 3.10.2026 | 14.11.2026 | 15.12.2026 |
| 7.04.2028 | 10.05.2028 | 22.06.2028 | 26.07.2028 |
| 15.11.2029 | 16.12.2029 | 26.01.2030 | 27.02.2030 |
| 16.06.2031 | 20.07.2031 | 1.09.2031 | 5.10.2031 |
| 26.01.2033 | 27.02.2033 | 10.04.2033 | 13.05.2033 |
| 29.08.2034 | 30.09.2034 | 11.11.2034 | 13.12.2034 |
| 5.04.2036 | 8.05.2036 | 20.06.2036 | 24.07.2036 |
| 12.11.2037 | 14.12.2037 | 24.01.2038 | 25.02.2038 |
| 14.06.2039 | 18.07.2039 | 30.08.2039 | 2.10.2039 |
| 23.01.2041 | 25.02.2041 | 8.04.2041 | 11.05.2041 |
| 26.08.2042 | 28.09.2042 | 9.11.2042 | 11.12.2042 |
| 3.04.2044 | 6.05.2044 | 18.06.2044 | 22.07.2044 |
| 10.11.2045 | 12.12.2045 | 21.01.2046 | 22.02.2046 |
| 12.06.2047 | 15.07.2047 | 28.08.2047 | 30.09.2047 |
| 21.01.2049 | 22.02.2049 | 5.04.2049 | 8.05.2049 |
| 24.08.2050 | 25.09.2050 | 6.11.2050 | 8.12.2050 |
Retrograde Mercury
| Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 |
|---|---|---|---|
| 1.03.2025 | 15.03.2025 | 7.04.2025 | 26.04.2025 |
| 30.06.2025 | 18.07.2025 | 11.08.2025 | 25.08.2025 |
| 21.10.2025 | 9.11.2025 | 29.11.2025 | 17.12.2025 |
| 11.02.2026 | 26.02.2026 | 20.03.2026 | 9.04.2026 |
| 13.06.2026 | 29.06.2026 | 23.07.2026 | 7.08.2026 |
| 4.10.2026 | 24.10.2026 | 13.11.2026 | 30.11.2026 |
| 25.01.2027 | 9.02.2027 | 3.03.2027 | 23.03.2027 |
| 26.05.2027 | 10.06.2027 | 4.07.2027 | 19.07.2027 |
| 17.09.2027 | 7.10.2027 | 28.10.2027 | 13.11.2027 |
| 8.01.2028 | 24.01.2028 | 14.02.2028 | 5.03.2028 |
| 6.05.2028 | 21.05.2028 | 14.06.2028 | 29.06.2028 |
| 30.08.2028 | 19.09.2028 | 11.10.2028 | 26.10.2028 |
| 21.12.2028 | 7.01.2029 | 27.01.2029 | 16.02.2029 |
| 17.04.2029 | 1.05.2029 | 25.05.2029 | 10.06.2029 |
| 13.08.2029 | 2.09.2029 | 25.09.2029 | 9.10.2029 |
| 4.12.2029 | 22.12.2029 | 11.01.2030 | 30.01.2030 |
| 30.03.2030 | 13.04.2030 | 6.05.2030 | 24.05.2030 |
| 27.07.2030 | 16.08.2030 | 8.09.2030 | 22.09.2030 |
| 17.11.2030 | 6.12.2030 | 25.12.2030 | 13.01.2031 |
| 12.03.2031 | 26.03.2031 | 18.04.2031 | 6.05.2031 |
ASTROSCIENCE François BARTHOMEUF
ASTROLOGIE PRATIQUE
FDAF
lesgazettesdesastrologues.fdaf.org/202309GazetteFDAF227.pdf
champsastrologiques.fdaf.org/N04_ChampsAstrologiques_Printemps2023.pdf
En cliquant sur ces liens (ces lignes),
vous pouvez télécharger tous les "Echo d'Hermès" gratuitement
D'autre part, si vous cliquez sur le titre de chaque numéro (Au sommaire de...),
vous n'aurez que le numéro choisi à télécharger.
Et enfin, en cliquant ici sur cette autre ligne, vous aurez juste la liste
de tous les sommaires de tous les Echo d'Hermès parus
Numéro spécial - n° 59 bis - ÉTÉ 2023 - Josette Bétaillole
Numéro spécial consacré à notre Présidente qui nous a quittés le 25 juin.
- Commentaires sur le thème astrologique de Jo, les transits et le thème de l’AAA.
- Témoignages et photos souvenir.
| 2024, Apr | 0° | chart | ||
| 2037, Sep | 0° | chart | ||
| 2038, Feb | 0° | chart | ||
| 2038, Mar | 0° | chart | ||
| 2051, Nov | 0° | chart | ||
| 2052, May | 0° | chart | ||
| 2052, May | 0° | chart |
Heures et jours planétaires
LES PLANÈTES ET LES JOURS DE LA SEMAINE
Le concept des jours et des heures planétaires est l'un des plus anciens de l'astrologie. Les noms des jours de la semaine ont une connotation planétaire évidente. N'est-il pas évident que le lundi est gouverné par la Lune, le samedi par Saturne et le dimanche par le Soleil ? En français, la domination planétaire de certains jours de la semaine est encore plus explicite : lundi pour lundi, le jour de la Lune, mardi pour mardi, le jour de Mars, mercredi pour mercredi, le jour de Mercure, jeudi pour jeudi, le jour de Jupiter, vendredi pour vendredi, le jour de Vénus. En fait, les noms des jours de la semaine en anglais ont la même signification, mais sous une forme moins explicite. Par exemple, mardi est ainsi nommé parce que c'est un "jour de Tiw", et Tiw est un dieu de la mythologie nordique qui est assez similaire au dieu romain Mars. Vous pouvez en savoir plus sur les associations planétaires des jours de la semaine dans différentes langues dans cet excellent article .
Lorsque le calendrier grégorien fut adopté il y a plusieurs siècles dans de nombreux pays d'Europe, on veilla particulièrement à ce que la séquence des jours de la semaine et celle des planètes qui les gouvernent restent inchangées. On peut donc dire que cette séquence nous vient de temps immémoriaux.
Voici un tableau qui présente les règles des jours de la semaine et leurs symboles dans un format consize :
| Dimanche | Soleil | |
|---|---|---|
| Lundi | Lune | |
| Mardi | Mars | |
| Mercredi | Mercure | |
| Jeudi | Jupiter | |
| Vendredi | Vénus | |
| Samedi | Saturne |
Cette séquence des maîtres planétaires des jours de la semaine suit les rayons de l'étoile à sept branches, ou heptagramme, également connue sous le nom d'étoile des mages :

En fait, la séquence des maîtres planétaires des jours de la semaine est le résultat d’une autre séquence encore plus fondamentale : la séquence des Heures Planétaires.
HEURES PLANÉTAIRES
A première vue, les heures planétaires ressemblent aux heures ordinaires auxquelles nous sommes tous habitués. Un jour planétaire se compose de 24 heures planétaires et un jour ordinaire de 24 heures. Mais ici s'arrête la similitude.
Un jour planétaire commence au moment du lever du soleil à un endroit donné, tandis qu'un jour ordinaire commence à minuit. Comme le moment du lever du soleil est généralement différent selon les endroits, chaque endroit sur Terre a son propre jour planétaire, tandis que le jour ordinaire est le même pour tous les endroits du même fuseau horaire.
Les heures ordinaires ont toujours la même continuité (60 minutes), tandis que la durée des heures planétaires varie au cours de l'année, et une heure de jour n'est généralement pas égale à une heure de nuit (celles-ci sont égales entre elles, ainsi que l'heure ordinaire, seulement deux fois par an — à l'équinoxe de printemps, vers le 21 mars, et à l'équinoxe d'automne, vers le 22 septembre).
COMMENT CALCULER LES HEURES PLANÉTAIRES
Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de calculer les heures planétaires à la main. Il existe un calculateur d'heures planétaires qui effectuera le calcul pour presque n'importe quel endroit et pour pratiquement n'importe quelle date. Les explications qui suivent sont écrites pour ceux qui sont curieux de connaître l'algorithme et qui n'hésitent pas à faire quelques calculs.
Les heures planétaires dépendent de la date et du lieu. Supposons que la date soit le 28 juin et le lieu — Glasgow, Royaume-Uni. Les chiffres seront différents pour d'autres lieux et dates.
À cette date, le lever du soleil à Glasgow était à 4h37 et le coucher du soleil à 22h01.
La durée du jour (le temps écoulé entre le lever et le coucher du soleil) est de 17 heures 24 minutes, soit 1044 minutes. Divisons ce nombre par 12. Le résultat est de 87 minutes, ce qui correspond à la durée d'une heure de jour à Glasgow le 28 juin .
Pour définir la durée d'une heure de nuit, nous pourrions prendre la période de temps entre le coucher du soleil et le lever du soleil suivant et la diviser par 12. Mais il serait plus efficace d'utiliser cette règle simple : une heure de jour et une heure de nuit additionnées devraient toujours donner 120 minutes. Ainsi, la durée d'une heure de nuit dans notre cas est de 33 minutes.
Vous pouvez constater que la durée d'une heure de jour dépasse largement celle d'une heure de nuit. Vous pouvez facilement deviner que c'est typique de l'été. En hiver, ce sera l'inverse. Aux équinoxes, les heures de jour et de nuit durent toutes deux 60 minutes.
Maintenant que nous connaissons la durée d'une heure diurne et d'une heure nocturne pour la date et le lieu donnés, nous pouvons dessiner le tableau des heures planétaires ci-dessous. Quant aux maîtres planétaires des heures, ils seront expliqués dans un instant.
| Jour | Nuit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Règle | Durée | Nombre | Règle | Durée |
| 1 | Mercure | 4h37 – 6h04 | 1 | Soleil | 22h01 – 22h34 |
| 2 | Lune | 6h04 – 7h31 | 2 | Vénus | 22h34 – 23h07 |
| 3 | Saturne | 7h31 – 8h58 | 3 | Mercure | 23h07 – 23h40 |
| 4 | Jupiter | 8h58 – 10h25 | 4 | Lune | 23h40 – 00h13 |
| 5 | Mars | 10h25 – 11h52 | 5 | Saturne | 00h13 – 00h46 |
| 6 | Soleil | 11h52 – 13h19 | 6 | Jupiter | 00h46 – 01h19 |
| 7 | Vénus | 13h19 – 14h46 | 7 | Mars | 1h19 – 1h52 |
| 8 | Mercure | 14h46 – 16h13 | 8 | Soleil | 1h52 – 2h25 |
| 9 | Lune | 16h13 – 17h40 | 9 | Vénus | 2h25 – 2h58 |
| 10 | Saturne | 17h40 – 19h07 | 10 | Mercure | 2h58 – 3h31 |
| 11 | Jupiter | 19h07 – 20h34 | 11 | Lune | 3h31 – 4h04 |
| 12 | Mars | 20h34 – 22h01 | 12 | Saturne | 4h04 – 4h37 |
Il n'est pas difficile de déterminer quelle planète gouverne l'heure. La première heure d'un jour est toujours gouvernée par la planète qui gouverne ce jour planétaire. Le 28 juin était un mercredi, le jour de Mercure, donc la première heure planétaire de ce jour était gouvernée par Mercure.
Et après cela, la séquence cyclique des planètes est toujours la même : ... — Saturne — Jupiter — Mars — Soleil — Vénus — Mercure — Saturne — ... Cette séquence est appelée la séquence chaldéenne et elle est profondément enracinée dans la philosophie antique. Vous remarquerez peut-être que dans cette séquence, les planètes sont classées selon leur vitesse relative telle qu'observée depuis la Terre, la Lune étant la plus rapide et Saturne la plus lente. Le moyen le plus simple de se souvenir de cette séquence est d'avoir l'Étoile des Mages à portée de main : c'est la séquence dans laquelle les planètes se suivent autour de l'étoile.
COMMENT LES UTILISER
Dans l'astrologie contemporaine, les jours et les heures planétaires ont été presque oubliés, et seuls quelques praticiens les utilisent encore dans l'astrologie horaire et les élections. Mais dans d'autres arts ésotériques comme la magie et l'alchimie, ainsi que dans l'herboristerie, connaître le jour et l'heure appropriés peut être d'une importance cruciale.
Le célèbre astrologue et herboriste britannique Nicholas Culpeper a conseillé de cueillir les herbes à l'heure planétaire appropriée, correspondant à la planète maîtresse de l'herbe. En effet, l'énergie de la planète maîtresse est plus forte à son heure, de sorte que les propriétés curatives de l'herbe récoltée seront également plus fortes.
Mark Stavish, l'auteur du merveilleux livre « Le chemin de l'alchimie » écrit que « les heures planétaires sont une partie essentielle de la magie naturelle et de l'alchimie » et tout au long du livre, il demande au lecteur d'effectuer chaque opération au jour et à l'heure appropriés, pour pouvoir concentrer l'énergie subtile de la planète désirée.
De même, dans toutes les écoles de magie, les heures et les jours planétaires sont absolument pris en compte lors de la fabrication de talismans ou de l'exécution d'un rituel. Par exemple, un talisman solaire sera nécessairement fabriqué au jour et à l'heure du Soleil.
Vous pouvez également utiliser cette connaissance ancestrale lorsque vous planifiez quelque chose d'important dans votre vie. La règle principale est assez simple : la planète qui gouverne le jour et l'heure favorise les activités qui sont en harmonie avec son principe et peut entraver celles qui sont de nature opposée.
Ceux qui recherchent l'amour bénéficieront du Jour et de l'Heure de Vénus, les chercheurs de sagesse pourraient choisir d'avoir le patronage de Jupiter à leurs côtés, ou si vous voulez communiquer vos idées le plus efficacement possible, pourquoi ne pas sélectionner l'heure de Mercure pour votre présentation ? Si vous connaissez les associations symboliques des planètes, vous serez en mesure de trouver un jour et une heure appropriés pour vos décisions et actions importantes.
Je vous propose ici quelques interprétations possibles des jours et des heures planétaires du point de vue de la vie quotidienne. Ces interprétations ne sont ni idéales ni universelles, mais j'espère qu'elles constitueront pour vous un bon point de départ.
INTERPRÉTATIONS POUR LA VIE QUOTIDIENNE
Soleil : Bénéfique pour les activités qui visent à gagner en influence dans la société, en renommée, en prestige, ainsi qu'à acquérir de la confiance et de l'autonomie. C'est le bon moment pour s'adresser à ses supérieurs ou à des personnes importantes, par exemple pour parler d'une évolution de carrière. C'est aussi le moment approprié pour faire de la publicité, faire une présentation, parler à un large public.
Vénus : Une période propice aux rencontres et aux connaissances, mais surtout aux rendez-vous galants ou aux invitations à sortir. Heure propice aux divertissements, aux divertissements, aux fêtes, aux sorties au cinéma ou au théâtre, à l'achat de vêtements ou de bijoux à la mode. La sympathie mutuelle entre les personnes est renforcée, ce qui aide à trouver un compromis, à restaurer une relation brisée. Les artistes, les peintres, les musiciens peuvent ressentir une inspiration à cette heure.
Mercure : Période favorable à toute activité intellectuelle, notamment l'étude, l'enseignement, la recherche, la passation d'examens, ainsi que tout ce qui est lié à la réception, au transfert ou à l'utilisation de toute sorte d'informations. Mercure renforce la dextérité et la débrouillardise, patronne les commerçants, mais aussi les voleurs. C'est un bon moment pour commencer un petit voyage, pour écrire une lettre ou un rapport, pour programmer, pour discuter, pour envoyer du courrier.
Lune : C'est une période propice pour cuisiner, prendre un repas, mais aussi pour se laver, nettoyer et effectuer d'autres tâches ménagères. C'est un bon moment pour traiter avec les femmes, les réunions de famille, l'allaitement des bébés. Les activités qui ont été commencées pendant l'Heure de la Lune seront sujettes à des changements, en fonction de l'humeur et des émotions des gens, il est donc généralement déconseillé de commencer quoi que ce soit d'important à ce moment-là.
Saturne : C'est le temps des occupations et des débuts qui demandent beaucoup de temps, de patience, de concentration et de persévérance, comme aussi tout ce qui touche à la terre et aux biens immobiliers. Il est déconseillé de se lancer dans un voyage à cette époque, ni d'emprunter de l'argent, car dans les deux cas, retards et déceptions peuvent gâcher l'affaire. C'est le moment de demander conseil aux anciens, de calmer les passions, de jeter un regard lucide sur l'état des choses, de se débarrasser d'une mauvaise habitude.
Jupiter : Heure favorable à la plupart des affaires, en particulier celles qui favorisent la richesse, le succès et la prospérité. Jupiter aide à accélérer le développement, à élargir l'horizon, à augmenter le niveau de compréhension. C'est une période propice aux rencontres sociales, aux demandes d'avantages sociaux, de parrainage, aux relations avec des personnes riches et influentes, au début d'un voyage, aux discussions philosophiques et aux cérémonies religieuses.
Mars : C'est le moment d'une activité accrue, de ces activités qui demandent de la détermination, du courage, des efforts physiques, du sport, du travail avec le feu ou des instruments tranchants. La sexualité est renforcée, mais la probabilité d'un conflit est également plus élevée que d'habitude. Une bonne heure pour attaquer les ennemis ou défier les concurrents.
Planetary Hours and Days | Lunarium
 LUNARIUM
LUNARIUM
LA CONNAISSANCE DES TEMPS 2025VIENT DE PARAÎTRE
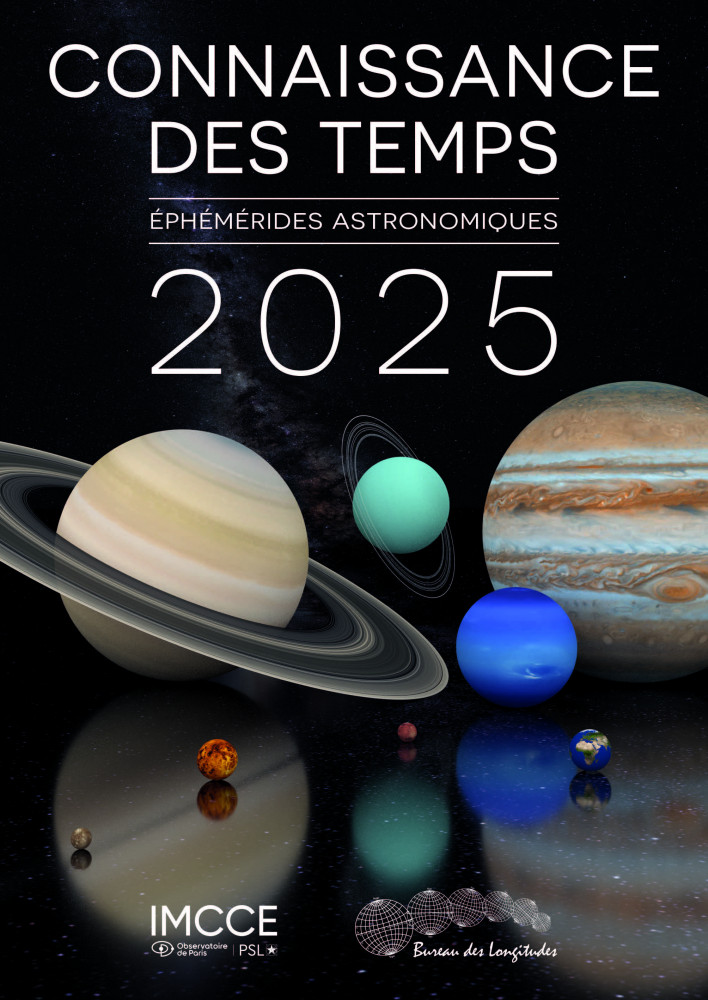
Cet ouvrage d’éphémérides est destiné aux astronomes, aux enseignants et aux étudiants.
- Le cœur de cet ouvrage présente, pour l’année en cours, les éphémérides tabulées du Temps sidéral, des variables liées aux nouveaux paradigmes de l’Union astronomique internationale sur les systèmes de référence et les coordonnées du Soleil, de la Lune et des planètes, de Pluton, Cérès, Pallas, Junon et Vesta ; il fournit également les quantités nécessaires au calcul des positions des satellites de Mars, des satellites galiléens de Jupiter, des huit premiers satellites de Saturne et des cinq principaux satellites d’Uranus.
- Un chapitre explicatif fournit les informations théoriques permettant de faire les calculs par soi-même ou d’utiliser le logiciel accompagnant l’ouvrage.
- Ce volume est le 347e d’une éphéméride créée en 1679 qui a paru sans interruption depuis sa création. Ancienne par sa conception, mais toujours moderne dans sa réalisation, la version actuelle s’appuie sur une partie des récents développements méthodologiques menés à l’IMCCE.
Consulter la table des matières.
- Format : 17 × 24 cm – 186 pages
- Éditeur : IMCCE
- ISSN : 2259-4191
- ISBN : 978-2-910015-89-3
Cet ouvrage est disponible gratuitement en version pdf : télécharger l’ouvrage.
Il sera bientôt disponible en version papier à la demande sur le site de la librairie BoD.
La signification des nombres de base en numérologie :

Le Un est le leader. Le chiffre un indique la capacité à se débrouiller seul et possède une vibration puissante. Il est gouverné par le Soleil.
Mots-clés : indépendant, créatif, original, ambitieux, déterminé, sûr de lui. Exprimé négativement : arrogant, têtu, impatient, égocentrique.
En amour : les numéros un prennent les devants en amour. L'amour et/ou la quête sont d'une importance capitale pour ces amoureux. Il peut cependant y avoir un certain égocentrisme. Ces amoureux sont prêts à expérimenter et peuvent être très excitants – ils peuvent aussi en avoir besoin car ils s'ennuient facilement.
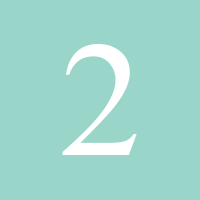
C'est le médiateur et l'amoureux de la paix. Le chiffre deux indique le désir d'harmonie. C'est une vibration douce, attentionnée et sensible. Gouvernée par la Lune.
Mots-clés : diplomate, chaleureux, pacifique, sensible. Exprimé négativement : trop dépendant, manipulateur, passif-agressif.
En tant qu'amoureux : les numéros deux se plient en quatre pour assurer le bon déroulement d'une relation. Ils offrent une sécurité émotionnelle à leurs partenaires. Le numéro deux est associé à la Lune et, comme la Lune gouverne le Cancer en astrologie, sa vibration est similaire à celle du Cancer.

Le numéro Trois est une vibration sociable, amicale et extravertie. Bienveillants, positifs et optimistes, les Trois apprécient la vie et ont un bon sens de l'humour. Gouvernés par Jupiter.
Mots-clés : jovial, amical, positif, aventureux, expressif. Exprimé négativement : extravagant, dispersé, superficiel.
En amour : Les Numéros Trois sont amusants, énergiques et ouverts à l'expérimentation. Ces amoureux ont besoin d'espace et de contact pour se sentir épanouis. S'ils se sentent confinés, ils seront malheureux et agités. S'ils ont la liberté de socialiser et de se dépenser, ils sont des amoureux passionnants et heureux.

C'est le travailleur. Pragmatique, soucieux du détail, le Quatre est digne de confiance, travailleur et serviable. Gouverné par Uranus.
Mots-clés : digne de confiance, serviable, constant, logique, discipliné, capable de résoudre les problèmes. Exprimé négativement : contraire, têtu, borné.
En amour : Bien que stables et généralement dignes de confiance, les Quatre peuvent être très émotifs et frustrés s'ils se sentent enfermés. Ils ont tendance à avoir besoin d'un certain degré de confrontation dans leur vie amoureuse. Une relation qui stagne fera ressortir leur nature contradictoire. Ils aiment résoudre les problèmes et, s'ils sont autorisés à « assumer » et à affronter les difficultés, ils sont des amants très fidèles.

C'est l'amoureux de la liberté. Le chiffre cinq représente une vibration intellectuelle. Ce sont des personnes créatives, aimant la variété et capables de s'adapter à la plupart des situations. Gouverné par Mercure.
Mots-clés : adaptable, épris de liberté, romantique, débrouillard, spirituel, amusant, curieux, flexible, conciliant. Exprimé négativement, il est indifférent, irresponsable, incohérent.
En tant qu'amoureux : Ces amoureux sont généralement attirants, car ils sont adaptables, curieux et amicaux. Leur esprit vif et leur goût pour l'humour sont indéniables. Pour être heureux en amour, ils ont besoin de changement et de variété. Ils ont également besoin de stimulation mentale. Ils s'adaptent rapidement aux hauts et aux bas, mais sous-stimulés, ils peuvent être incohérents et réticents à prendre des engagements.

C'est l'amoureux de la paix. Le chiffre six est une vibration aimante, stable et harmonieuse. Régi par Vénus.
Mots-clés : compatissant, stable, aimant la famille, digne de confiance, domestiqué. Exprimé négativement, superficiel, jaloux, possessif, peu enclin au changement.
En amour : Les Numéros Six détestent profondément la discorde et s'efforcent généralement de maintenir la paix. Ils sont très attachés à leur foyer et à leur famille. Au mieux, ce sont des partenaires dévoués et stables qui font tout leur possible pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. Au pire, ils poussent leur nature pacifique à l'excès et deviennent léthargiques, diplomates jusqu'à la superficialité, et jaloux.

C'est le penseur profond . Le chiffre sept représente une vibration spirituelle. Ces personnes sont peu attachées aux choses matérielles, introspectives et généralement calmes. Gouvernées par Neptune.
Mots-clés : inhabituel, introspectif, intuitif, psychique, sage, réservé. Exprimé négativement : mélancolique, étrange, laisse trop de place au hasard, difficile à atteindre.
En tant qu'amoureux : Ces amants sont un peu distants et parfois difficiles à atteindre et à comprendre. Cependant, leur désintérêt pour les biens matériels et leur focalisation sur la spiritualité en font des partenaires intéressants, quoique un peu excentriques. Intuitifs, certains sont médiums, et bien qu'ils puissent être solitaires à différents moments de leur vie, ils sont souvent des partenaires dévoués. Ils peuvent atteindre des niveaux d'intimité et de romance dépassant l'imagination de beaucoup. Cependant, leurs objectifs amoureux peuvent être trop ambitieux et ils peuvent donc être sujets à la déception lorsque leurs relations ne sont pas toujours idéales.

C'est le manager. Le numéro huit est une vibration forte, réussie et matérielle. Gouverné par Saturne.
Mots-clés : ambitieux, pragmatique, pragmatique, dirigeant, autoritaire, performant, courageux, accompli, organisé. Exprimé négativement : tendu, borné, matérialiste, énergique.
En tant qu'amoureux : Ces amants s'engagent avec responsabilité et courage. Cependant, lorsqu'ils traitent les relations comme des affaires, ils peuvent facilement aliéner leur partenaire et ne pas parvenir à créer une atmosphère tolérante et romantique. Les Huit sont généralement pragmatiques et sûrs d'eux, et offrent à leur partenaire stabilité et sécurité.

Voici le professeur. Le nombre neuf est une vibration tolérante, quelque peu impraticable et bienveillante. Régi par Mars.
Mots-clés : touche-à-tout, humanitaire, sympathique, serviable, émotif, tolérant, actif, déterminé. En cas d'expression négative : insouciant en matière financière, lunatique, intimidateur, excessivement émotif, maussade, agité.
En tant qu'amoureux : Ces amoureux sont impliqués et serviables. Leur compassion peut facilement les rendre insupportables. Ils témoignent leur amour en aidant leur partenaire et en assumant ses problèmes. Si on les irrite, leurs émotions peuvent devenir explosives, et une personnalité apparemment docile peut recourir à des tactiques d'intimidation lorsqu'elle est malheureuse.
Nombres maîtres
Dans le premier exemple ci-dessus, où les calculs du nombre du chemin de vie ont été démontrés, le nombre final a été réduit de 11 à 2. En numérologie, on note des nombres maîtres, à savoir 11 et 22. En substance, le nombre 11 est un 2, mais sa vibration est considérée comme supérieure à celle du nombre 2. De même, le nombre 22 est un 4, mais sa vibration est supérieure à celle du nombre 4.
Voici le donateur. Numéro Onze est un innovateur doté d'un sens indéniable de l'humanitarisme.
Mots-clés : idéaliste, intuitif, attentionné, tolérant, tolérant, inébranlable. Exprimé négativement : trop dépendant, hypersensible, manipulateur.
En tant qu'amoureux : Ces amoureux sont romantiques au sens idéal du terme. Ils recherchent le bien chez les autres et le trouvent. Les Onze sont les amoureux les moins égoïstes et extrêmement attentionnés. Ils ne vous pousseront pas à faire quoi que ce soit. Ils s'accrochent à leur partenaire (et à leurs amis) et sont passés maîtres dans l'art du compromis. Les Onze sont tolérants et acceptants.
C'est le maître d'œuvre. Bien qu'idéalistes et visionnaires, les Numéro Vingt-Deux parviennent à garder les pieds sur terre.
Mots-clés : ambitieux, sage, intense, idéaliste, débrouillard, passionné. Exprimé négativement : trop émotif, destructeur, dramatique.
En tant qu'amoureux : c'est tout ou rien avec ces amoureux. Ils ne semblent pas capables de faire les choses à moitié, y compris dans leurs relations. Ils sont généralement déterminés à réussir dans la vie, et leur intensité pure est quelque chose que l'on apprécie ou déteste.
 |
| Bête rouge et monstre a 10 têtes 27 ans durera sa guerre |
Les bébés miracles qui ont survécu à Ravensbruck
15 avril 2025

Photos du survivant de Ravensbruck Mikolaj Sklodowski avec sa mère
Paris (AFP) - Ils sont nés dans un enfer sur Terre et n'étaient pas censés survivre. Mais par miracle, une poignée de bébés nés dans le camp de concentration de Ravensbrück, dans le nord de l'Allemagne, en sont sortis vivants.
Guy Poirot, né là-bas le 11 mars 1945, a déclaré qu'ils devaient leur vie à « la volonté collective des femmes » qui ont risqué leur vie pour les cacher et les nourrir alors qu'ils n'avaient presque rien pour eux-mêmes.
« Nous sommes les enfants de toutes ces femmes », a déclaré à l'AFP la survivante française de 80 ans.
L'Allemande Ingelore Prochnow, née à Ravensbruck près d'un an avant lui, les appelle « mes mères du camp », qui les ont sauvés de l'extermination et de la faim dans le deuxième plus grand camp nazi après Auschwitz-Birkenau.
Jusqu'en 1943, la plupart des nouveau-nés étaient étouffés, noyés ou brûlés et les femmes enceintes jusqu'à huit mois recevaient généralement des injections mortelles pour avorter.
Les femmes cachaient donc leurs bosses de peur d’être envoyées au « Revier », l’infirmerie du camp, tristement célèbre pour ses expériences médicales et ses sélections en vue d’une exécution.
Comme les 130 000 autres détenus du plus grand camp nazi pour femmes et enfants, ils travaillaient 12 à 14 heures par jour à transporter des briques, à pousser des chariots, à recoudre des uniformes ou à travailler dans une usine Siemens.
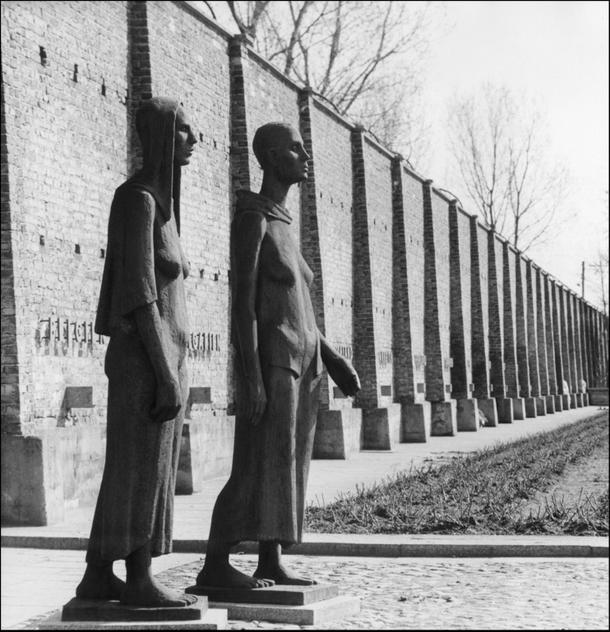
Un monument aux morts devant le camp de concentration de Ravensbruck, dans le nord de l'Allemagne
« Les gardes m’ont battue et m’ont donné des coups de pied à de nombreuses reprises », a écrit la prisonnière polonaise Waleria Peitsch malgré « mon état avancé » après son arrivée dans les plus grands convois transportant des femmes enceintes après l’insurrection de Varsovie en août 1944.
Elle survit néanmoins aux violences et aux épidémies qui ravagent le camp et donne naissance à son fils Mikolaj le 25 mars 1945.
- 'Chambre d'enfant' -
Après l'arrivée d'un nouveau médecin à l'automne 1943, les naissances furent tolérées si elles avaient lieu hors de vue.

Sylvie Aylmer, née dans le camp, avec une photo de sa mère, résistante française
La résistante française Madeleine Aylmer-Roubenne a donné naissance à sa fille Sylvie le 21 mars 1945, dans « une sorte de couloir, sans eau, sans toilettes à proximité ni électricité, juste une bougie par terre ».
Sa sage-femme allemande, une criminelle de droit commun, a risqué sa vie pour obtenir les forceps et le chloroforme à l’infirmerie qui disposait d’une salle d’accouchement à la pointe de la technologie avec « tous les instruments obstétricaux » imaginables, a écrit Aylmer-Roubenne dans ses mémoires du camp.
La même solidarité a vu des femmes voler de la nourriture et des chiffons pour les nouvelles mères afin qu’elles puissent fabriquer des couches et des gants médicaux pour fabriquer des tétines pour les biberons.
« Les femmes lavaient les bébés avec la boisson tiède qu'elles recevaient le matin, les réchauffaient et les protégeaient des gardes », a déclaré Prochnow.
« Seule, ma mère n’aurait jamais pu me maintenir en vie. »
Les nouveau-nés étaient rassemblés dans la « Kinderzimmer » ou chambre d'enfants à partir de septembre 1944 où leur espérance de vie ne dépassait pas trois mois, écrit Marie-José Chombart de Lauwe, étudiante en médecine et résistante française qui tenta de les maintenir en vie.
Les rats leur mordaient les doigts la nuit. Presque tous étaient emportés par la faim, la dysenterie, le typhus et le froid glacial, avec des températures descendant jusqu'à moins 15 degrés Celsius (cinq degrés Fahrenheit).
Les mères travaillant jusqu'à l'épuisement, la plupart n'avaient plus de lait. Il y avait peu de lait en poudre pour remplir les deux biberons partagés par 20 à 40 bébés.
« Maman n'avait plus de lait », se souvient Jean-Claude Passerat-Palmbach, un survivant français. « Alors, une Rom roumaine et une Russe, qui avaient perdu leurs bébés, m'ont allaité. »
Né en novembre 1944, il n'a survécu que grâce à la générosité des autres prisonniers de la ferme où sa mère a été envoyée par la suite.
- Les bébés sont comme des « petits vieux » -
Les bébés ressemblaient à de « petits vieux », racontait Chombart de Lauwe, avec une peau ridée, des ventres gonflés et des visages triangulaires. Ils souffraient d'abcès et de diarrhée verte.
La situation s'aggrava encore en 1945. Environ 6 000 prisonniers furent gazés et des milliers de femmes et d'enfants furent envoyés dans d'autres camps face à l'avancée des Russes. Au total, entre 20 000 et 30 000 personnes périrent à Ravensbruck.

Le survivant Guy Poirot avec une photo de sa mère, Pierrette, membre de la Résistance française
Sylvie Aylmer et son « frère » de camp Guy Poirot ont été sauvés en étant cachés sous les jupes de certains des 7 500 prisonniers évacués par la Croix-Rouge suédoise entre le 23 et le 25 avril après que le chef SS Heinrich Himmler eut accepté de les libérer dans l'espoir de sauver sa propre peau.
Ingelore Prochnow et sa mère furent cependant contraintes de participer à une « marche de la mort » de 60 kilomètres vers le sous-camp de Malchow lorsque les troupes soviétiques en progression les libérèrent.
Les bébés qui ont survécu à Ravensbruck sont pour la plupart nés juste avant sa libération par l'Armée rouge dans la nuit du 29 au 30 avril.
Les nazis brûlèrent leurs archives, mais un registre tenu par une évadée tchèque fit état de 522 naissances dans le camp entre septembre 1944 et avril 1945. Seuls 30 d'entre eux ne furent pas marqués comme morts. Certains furent transférés à Bergen-Belsen où « seuls quelques nouveau-nés survécurent », selon Valentine Devulder, qui rédige une thèse sur les femmes enceintes dans les camps.
- Traumatisme transgénérationnel -
En grandissant, beaucoup de jeunes survivants, comme Sylvie Aylmer, ignoraient qu'ils étaient nés dans un camp de concentration. Pour elle, Ravensbruck était « un village français ».
« Je l'ai découvert à 13 ans, lorsque ma sœur et moi sommes allées à une exposition à Ravensbruck et que les anciens prisonniers qui s'y trouvaient nous ont accueillies dans leurs bras. Ce fut un choc », se souvient-elle. Elle n'y est jamais retournée. Cet endroit « me donne la chair de poule », dit-elle.
Son père, lui aussi résistant, est mort dans les camps.

Le survivant polonais Mikolaj Sklodowski regarde un document du camp sur sa mère Waleria Peitsch
Le Polonais Mikolaj Sklodowski, aujourd'hui prêtre, y célèbre la messe et emmène souvent des jeunes en visite. « Parler des souffrances dans les camps de concentration est un devoir envers ceux qui y restent à jamais », a-t-il déclaré.
Les camps les ont tous marqués d’une manière ou d’une autre.
Guy Poirot, qui raconte son expérience aux jeunes « pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré être encore « très marqué psychologiquement » par ce qui s'est passé. L'ancien fonctionnaire, père d'un fils, a confié que sa « santé a été fragile » toute sa vie.
Sylvie Aylmer a souffert d'anorexie lorsqu'elle était petite et a suivi une thérapie pendant plusieurs années. « Ce n'était pas facile avec ma mère. Quand elle me voyait, elle voyait le camp », a-t-elle dit.
Ingelore Prochnow a été abandonnée par sa mère dans un camp de réfugiés à l'âge de trois ans, après y avoir survécu. Elle n'a découvert son passé qu'à 42 ans.
Elle se disait « résiliente et rarement malade », mais sa plus jeune fille était anorexique. « Elle ne pesait que 30 kilos à sa mort. Elle ressemblait à une détenue de camp de concentration et avait l'impression de porter mon poids sur ses épaules », a déclaré cette mère de deux enfants.
« Elle est décédée en 2019 à l'âge de 50 ans. Le diagnostic final était qu'elle souffrait d'un « traumatisme transgénérationnel ». »
Agence France-Presse
Les journalistes de l'AFP couvrent les guerres, les conflits, la politique, la science, la santé, l'environnement, la technologie, la mode, le divertissement, l'insolite, le sport et bien plus encore, sous forme de textes, de photographies, de vidéos, de graphiques et en ligne.
© 2025 AFP

Le président chinois Xi Jinping entame sa visite en Malaisie malgré les tarifs douaniers imposés par Trump
AFP - il y a 22 minutes
Le président chinois Xi Jinping est arrivé mardi en Malaisie pour une visite d'État très attendue qui intervient alors que Pékin…
Histoire complète »

Le Soudan célèbre deux ans de guerre sans fin en vue
AFP - il y a 1 h
Le Soudan a célébré mardi les deux ans d'une guerre qui a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé 13 millions de personnes et déclenché la …
Histoire complète »

Les négociations sur un traité sur la pandémie se rapprochent d'un accord
AFP - il y a 3 heures
Les pays espérant mettre fin à plus de trois ans de négociations sur la lutte contre les futures pandémies se sont réunis mardi pour des discussions, …
Histoire complète »

Harvard voit son financement gelé de 2,2 milliards de dollars après avoir défié Trump
AFP - il y a 4 h
L'université américaine d'élite Harvard a été frappée lundi par un gel de son financement fédéral de 2,2 milliards de dollars après avoir rejeté une liste de...
Histoire complète »

La Chine accuse des espions américains d'avoir mené des cyberattaques contre les Jeux asiatiques d'hiver
AFP - il y a 5 h
Des responsables de la sécurité chinoise ont déclaré mardi avoir impliqué trois « agents secrets » américains dans des cyberattaques au cours de la…
Histoire complète »

Un brasseur danois ajoute des « collègues » IA à son équipe humaine
AFP - il y a 6 h
Ils ont des noms, des visages et des adresses e-mail, mais les cinq nouveaux collègues de la brasserie danoise Royal Unibrew n'existent que dans le...
Histoire complète »

Mbappé mène la remontée du Real Madrid contre Arsenal
AFP - il y a 8 heures
Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en quête de gloire en Ligue des champions, espérant être du bon côté de ce genre de …
Histoire complète »

Le voyage de Xi Jinping au Vietnam vise à « escroquer » les États-Unis, selon Trump
AFP - il y a 8 heures
Le président chinois Xi Jinping a rendu hommage au défunt dirigeant révolutionnaire vietnamien Ho Chi Minh mardi, son dernier jour de mandat.
Histoire complète »

Les bébés miracles qui ont survécu à Ravensbruck
AFP - il y a 6 h
Ils sont nés dans un enfer sur Terre et n'étaient pas censés survivre. Mais par miracle, une poignée de bébés nés dans…
Histoire complète »

L'interdiction des méta-informations renforce la rupture médiatique traditionnelle au Canada
AFP - il y a 10 heures
Alors que le Canada se dirige vers des élections ce mois-ci, les électeurs à la recherche de nouvelles de campagne sur Facebook ou Instagram trouveront…
Histoire complète »

Les États-Unis ouvrent la porte à des tarifs douaniers sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs
AFP - il y a 10 heures
Les États-Unis ont ouvert la porte lundi à des tarifs douaniers visant les technologies de pointe et les produits pharmaceutiques, alimentant ainsi…
Histoire complète »

Le nouveau procès de Harvey Weinstein pour crimes sexuels va commencer à New York
AFP - il y a 7 h
Le magnat d'Hollywood en disgrâce Harvey Weinstein fait face à un nouveau procès à partir de mardi, pour des accusations de viol et d'agression sexuelle pour lesquelles un...
Histoire complète »

Harvard voit son financement de 2,2 milliards de dollars gelé après avoir défié Trump
AFP - il y a 7 h
L'université américaine d'élite Harvard a été frappée lundi par un gel de 2,2 milliards de dollars de financement fédéral après avoir rejeté une liste de...
Histoire complète »

Israël exige la libération des otages pour le cessez-le-feu à Gaza, selon le Hamas
AFP - il y a 13 heures
Le Hamas a déclaré lundi qu'Israël avait proposé un cessez-le-feu de 45 jours s'il libérait la moitié des otages restants détenus à Gaza, …
Histoire complète »

Alvarez marque un doublé sur penalty et l'Atlético bat Valladolid
AFP - il y a 4 h
Julian Alvarez a inscrit deux penaltys lors de la victoire de l'Atlético Madrid sur le Real Valladolid, dernier du classement, 4-2 lundi en Liga.
Histoire complète »

Le pape ouvre la voie à la sainteté de Gaudi, « l'architecte de Dieu »
AFP - il y a 6 h
L'Église catholique a surnommé Antoni Gaudi, le concepteur de la basilique Sagrada Familia de Barcelone, « l'homme de Dieu »…
Histoire complète »

Israël exige la libération d'otages pour un cessez-le-feu à Gaza, selon le Hamas
14 avril 2025
Le Hamas a déclaré lundi qu'Israël avait proposé un cessez-le-feu de 45 jours s'il libérait la moitié des otages restants détenus à Gaza, …
Histoire complète »

Bukele, président du Salvador, exclut le retour des migrants, en proie à une crise d'amour avec Trump
14 avril 2025
Le président du Salvador, Nayib Bukele, a exclu lundi le renvoi d'un homme expulsé à tort des États-Unis, car il...
Histoire complète »

Les Ukrainiens pleurent les victimes de la frappe de Soumy, la Russie niant avoir ciblé des civils
14 avril 2025
Les habitants de la ville ukrainienne de Soumy ont pleuré lundi les victimes de l'une des attaques les plus meurtrières de la guerre…
Histoire complète »

Les exemptions tarifaires de Trump soulagent les marchés, mais l'incertitude domine
14 avril 2025
Les exemptions tarifaires américaines pour l'électronique ont provoqué des rallyes sur les marchés lundi, de l'Asie à Wall Street, mais l'incertitude a dominé...
Histoire complète »

L'ONU met en garde contre la crise humanitaire à Gaza alors que la France et Abbas appellent à une trêve
14 avril 2025
Les Nations Unies ont averti lundi que Gaza était confrontée à sa crise humanitaire la plus grave depuis le début de la guerre, sans …
Histoire complète »

Noboa remporte le second tour de la présidentielle en Équateur, son rival dénonce une fraude
14 avril 2025
Le président réélu de l'Équateur, Daniel Noboa, a dû faire face à la tâche herculéenne d'unir sa nation frappée par la violence lundi, après…
Histoire complète »

13 millions de personnes déplacées alors que la guerre au Soudan entre dans sa troisième année, selon l'ONU
14 avril 2025
La guerre civile au Soudan a déplacé 13 millions de personnes, a rapporté lundi l'ONU, alors que le conflit entre l'armée…
Histoire complète »

L'ONU met en garde contre la crise humanitaire à Gaza alors que la France et Abbas appellent à une trêve
14 avril 2025
Les Nations Unies ont averti lundi que Gaza était confrontée à sa crise humanitaire la plus grave depuis le début de la guerre, sans …
Histoire complète »

Macron appelle à une « réforme » de l'Autorité palestinienne pour gérer Gaza sans le Hamas
14 avril 2025
Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi à une « réforme » de l'Autorité palestinienne dans le cadre d'un plan pour l'Occident…
Histoire complète »

Les exemptions tarifaires de Trump soulagent les marchés, mais des tensions planent
14 avril 2025
Les exemptions tarifaires américaines pour l'électronique ont provoqué des rallyes sur les marchés lundi, de l'Asie à Wall Street, mais n'ont pas réussi à régler...
Histoire complète »

La Russie affirme que la frappe meurtrière de Soumy a touché une réunion de l'armée
14 avril 2025
La Russie a déclaré lundi que ses missiles avaient touché une réunion de commandants de l'armée ukrainienne à Soumy, accusant l'Ukraine d'utiliser...
Histoire complète »

Les législateurs hongrois soutiennent les restrictions constitutionnelles imposées aux personnes LGBTQ et aux binationaux
14 avril 2025
Les législateurs hongrois ont massivement soutenu lundi les changements constitutionnels visant la communauté LGBTQ du pays et…
Histoire complète »

Les législateurs hongrois soutiennent les restrictions imposées aux personnes LGBTQ et aux binationaux
14 avril 2025
Les législateurs hongrois ont massivement soutenu lundi les changements constitutionnels visant la communauté LGBTQ du pays et…
Histoire complète »

Trump reçoit Bukele, le « dictateur le plus cool », pour des discussions sur la répression des migrants
14 avril 2025
Le président Donald Trump a accueilli lundi le président du Salvador, Nayib Bukele, qui se décrit lui-même comme « l'homme le plus cool du monde...
Histoire complète »

Xi Jinping appelle la Chine et le Vietnam à « s'opposer à l'intimidation unilatérale » lors de sa tournée régionale
14 avril 2025
Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé lundi son pays et le Vietnam à « s'opposer à l'intimidation unilatérale », a déclaré l'État de Pékin.
Histoire complète »

Katy Perry s'envole dans l'espace à bord d'un vol entièrement féminin
14 avril 2025
La pop star Katy Perry a effectué une brève incursion dans l'espace lundi, rugissant jusqu'au bord du cosmos avec un équipage entièrement féminin...
Histoire complète »

La Hongrie s'apprête à restreindre les droits constitutionnels dans le cadre du « nettoyage de Pâques »
14 avril 2025
Le parlement hongrois devrait approuver lundi des modifications constitutionnelles restreignant encore davantage les droits des personnes LGBTQ…
Histoire complète »

La Chine et le Vietnam signent des accords après que Xi Jinping a averti que le protectionnisme « ne mène nulle part »
14 avril 2025
La Chine et le Vietnam ont signé lundi des dizaines d'accords de coopération, renforçant les liens entre les pays communistes…
Histoire complète »

Trump affirme que personne n'est « tiré d'affaire » face aux tarifs douaniers, mais les marchés sont en hausse
14 avril 2025
Les marchés boursiers ont salué lundi les exemptions tarifaires américaines pour l'électronique, mais le président Donald Trump a signalé le sursis...
Histoire complète »

Katy Perry s'apprête à s'envoler dans l'espace à bord d'un vol entièrement féminin
14 avril 2025
La pop star Katy Perry sera le plus grand nom d'un groupe entièrement féminin qui s'apprête à toucher le bord de l'espace lundi, rugissant dans...
Histoire complète »

Décès au Pérou du lauréat du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa
14 avril 2025
L'écrivain péruvien et lauréat du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa est décédé dimanche à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille, …
Histoire complète »











 Download chart
Download chart Print chart
Print chart Add into my DB
Add into my DB
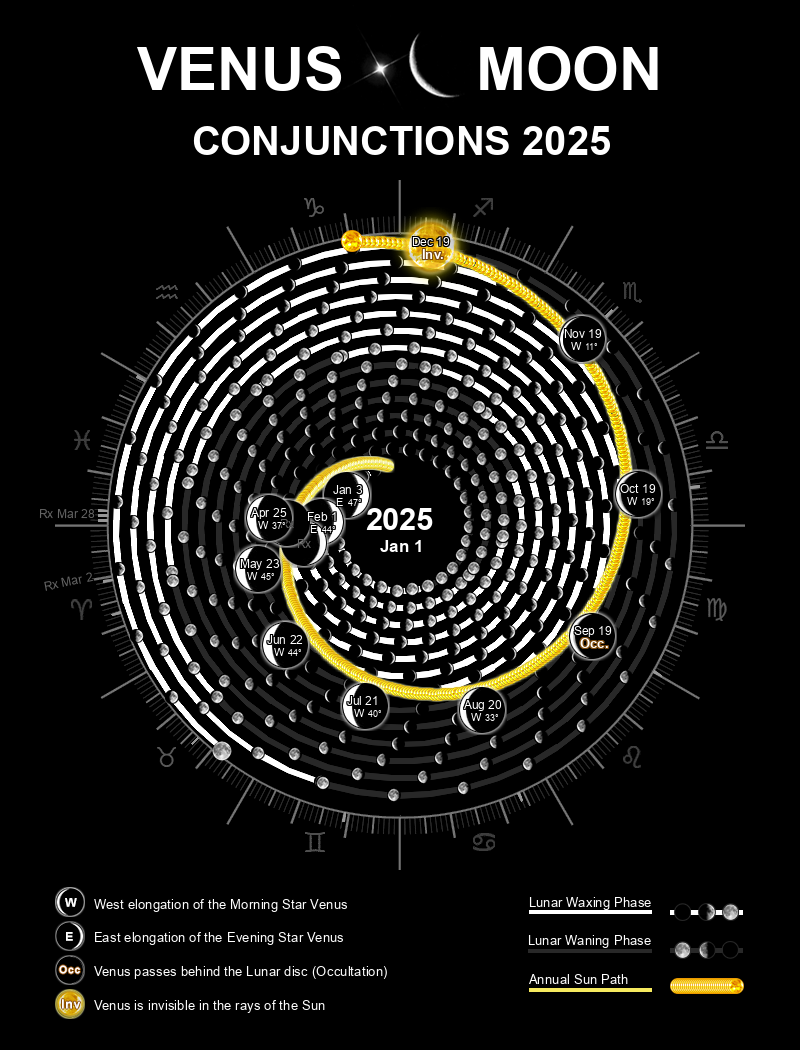
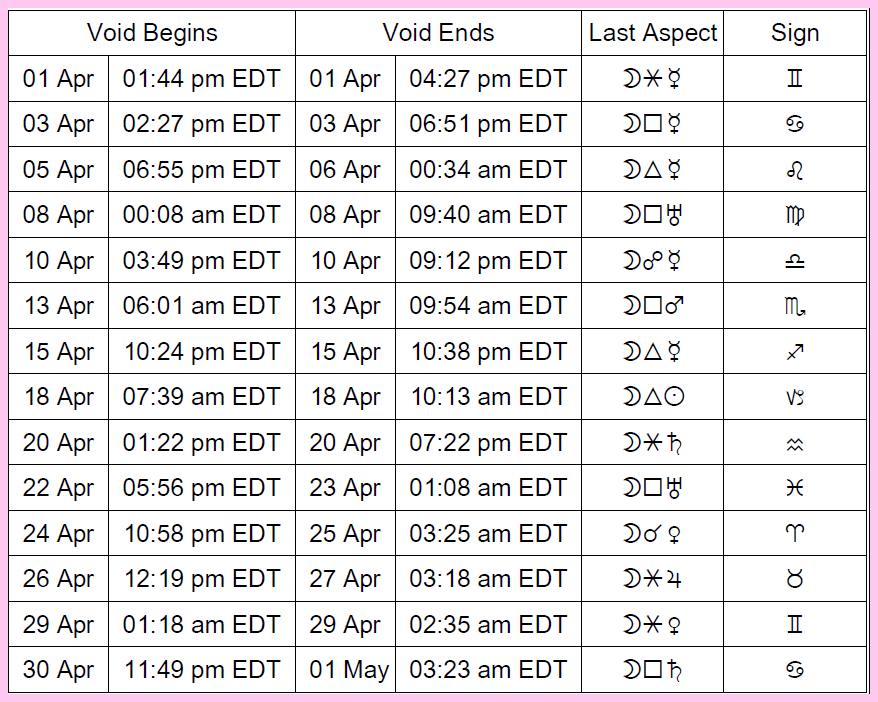


















































































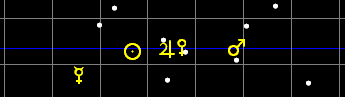

 (FR) Timezone |
(FR) Timezone | 
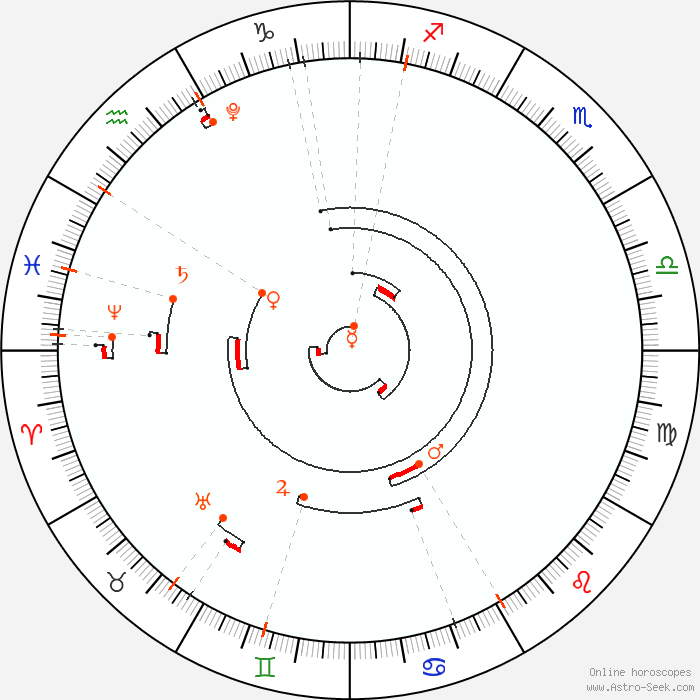
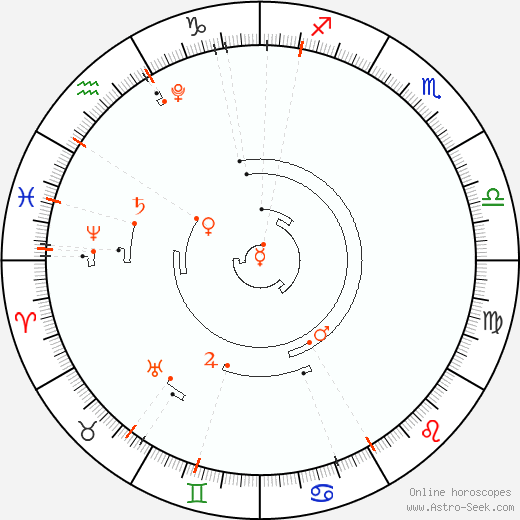
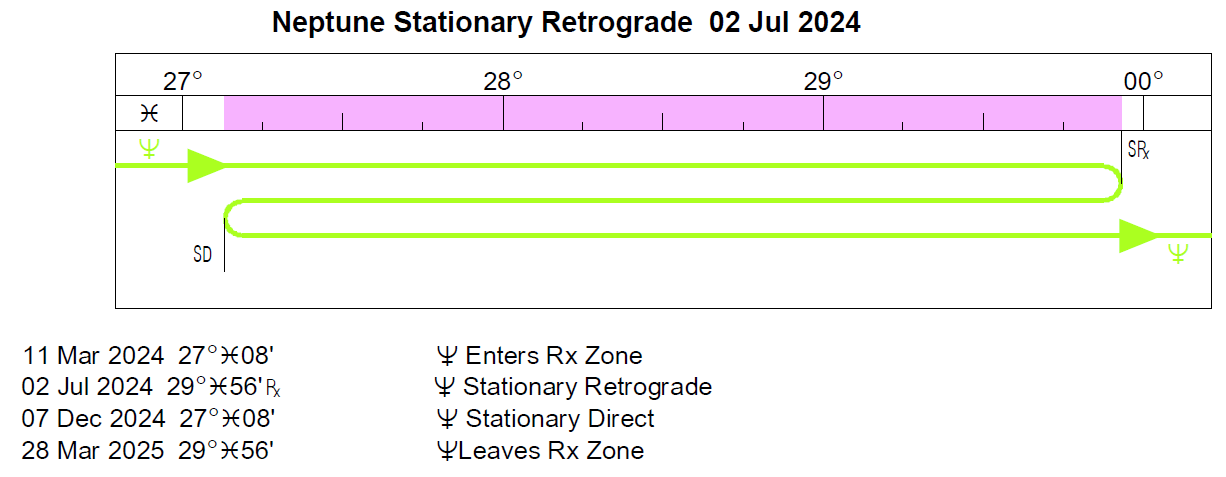
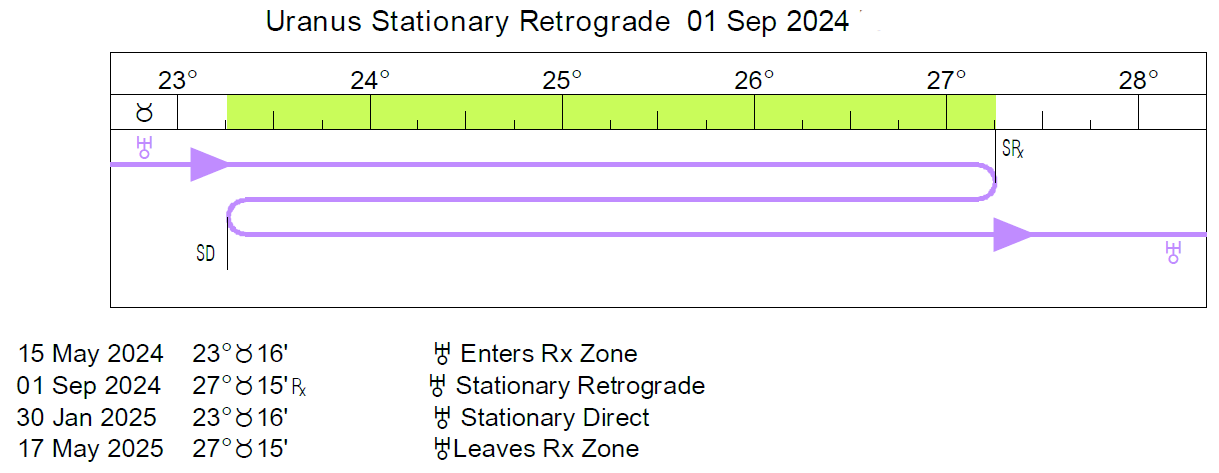
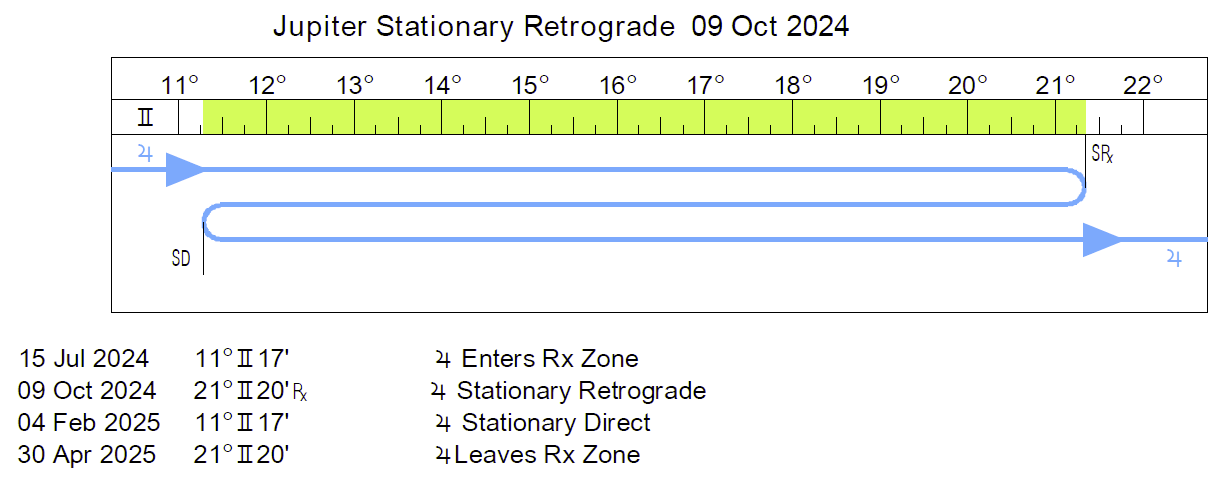
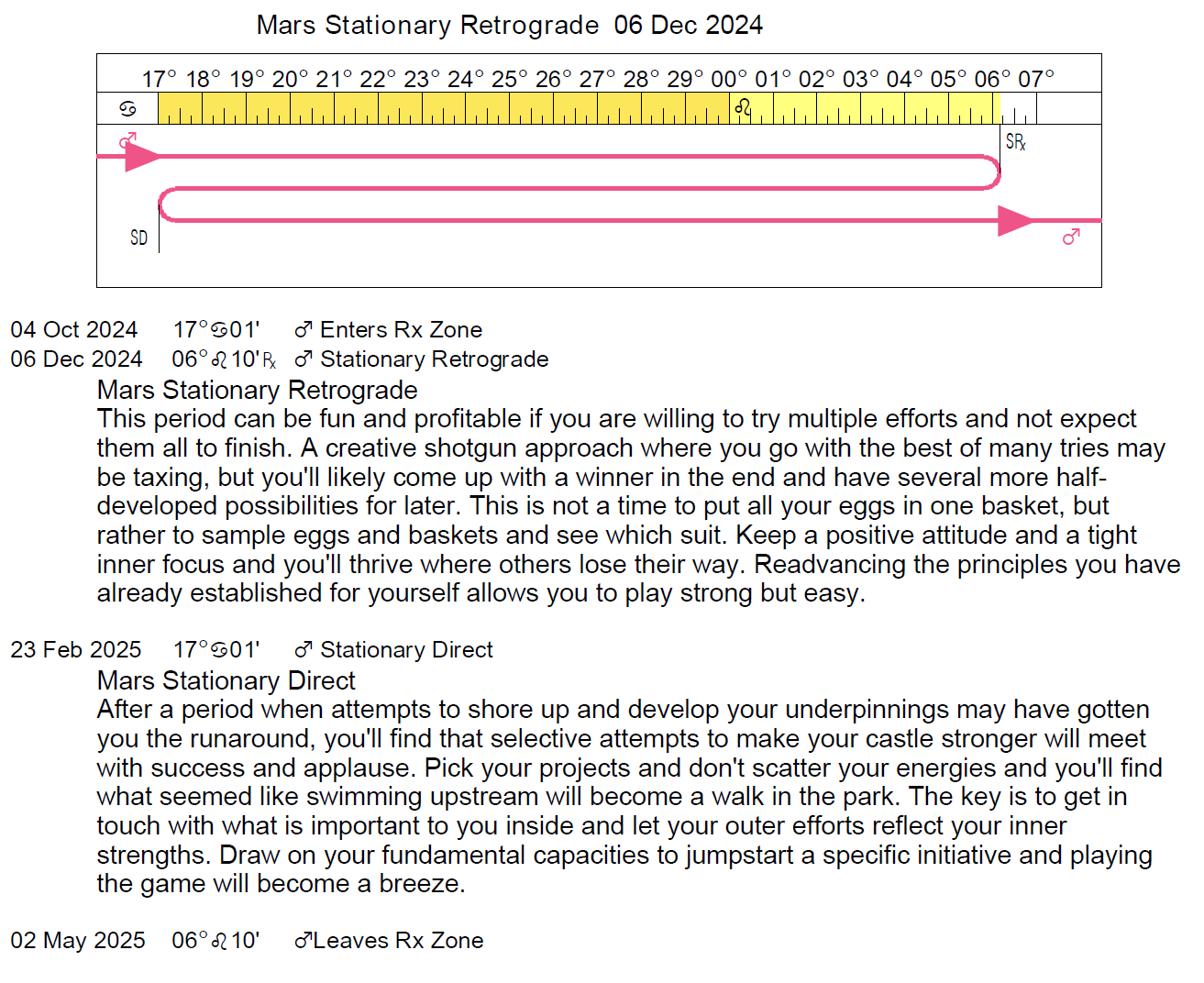
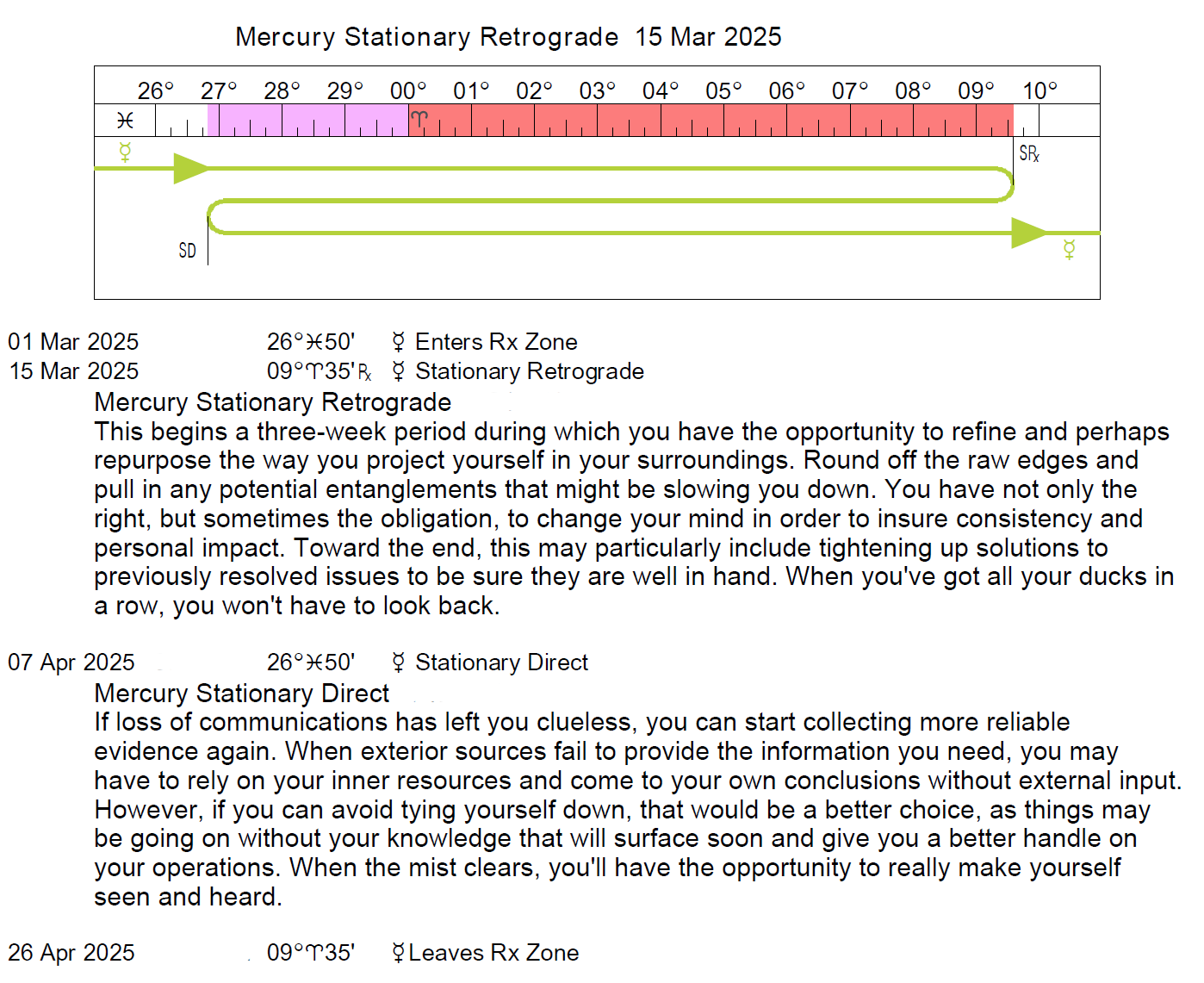
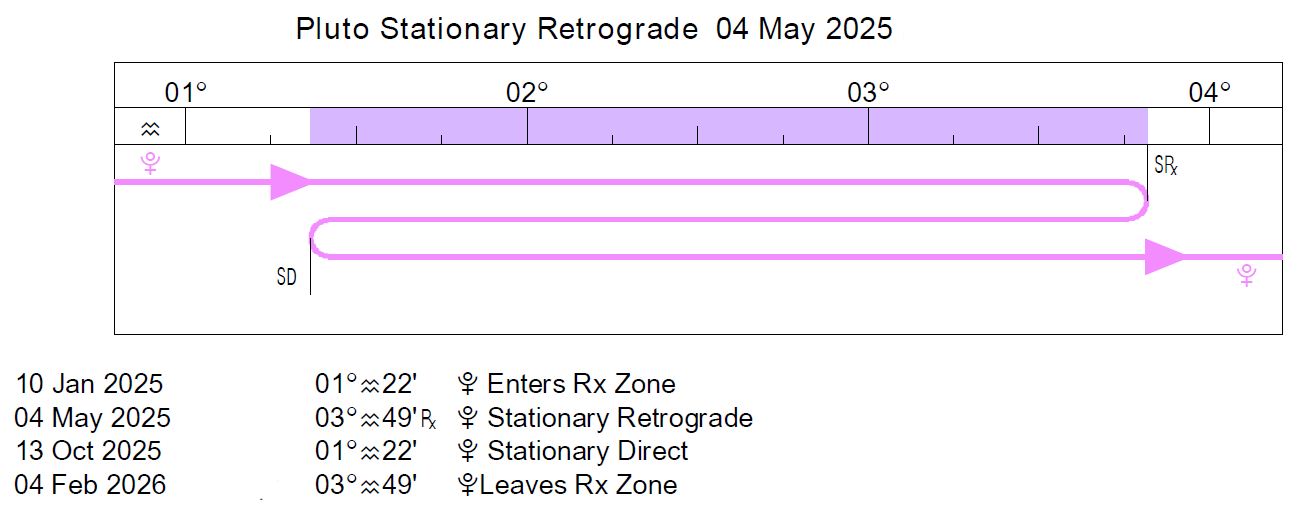
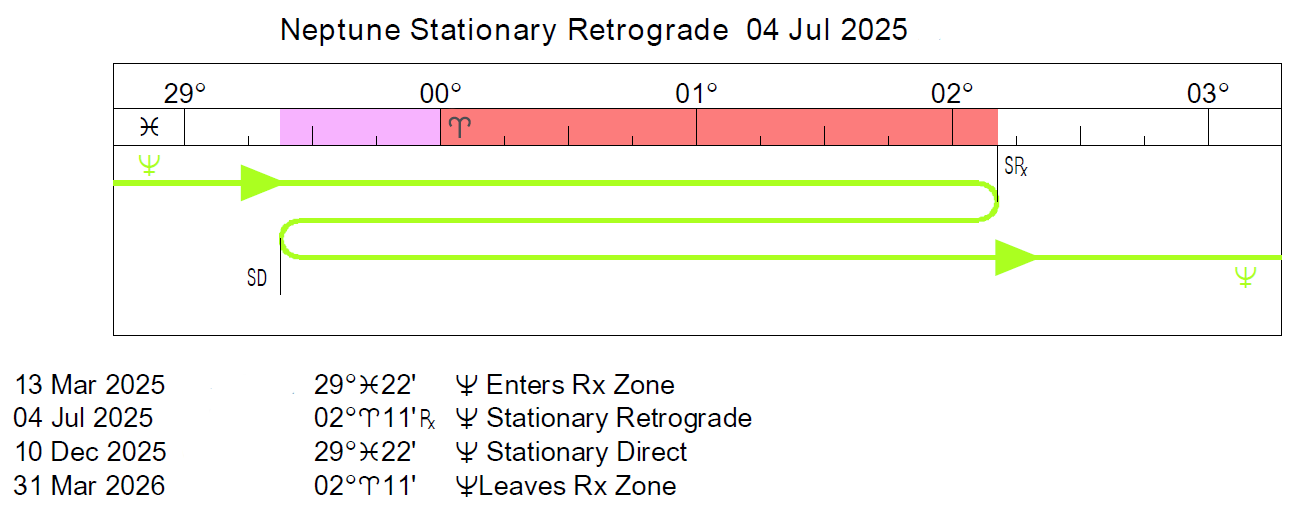
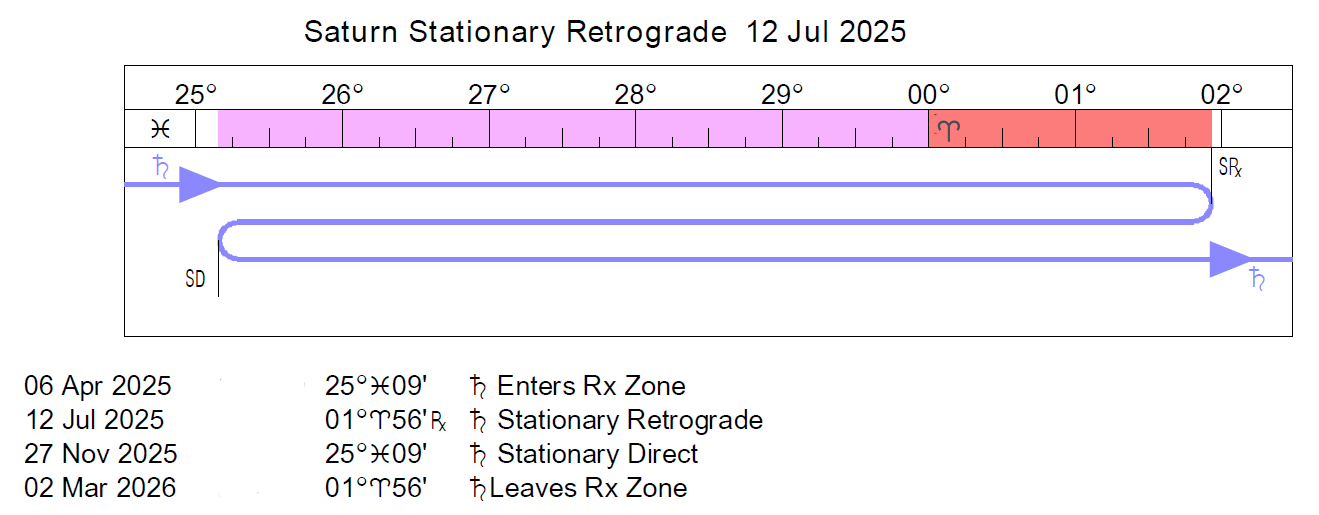
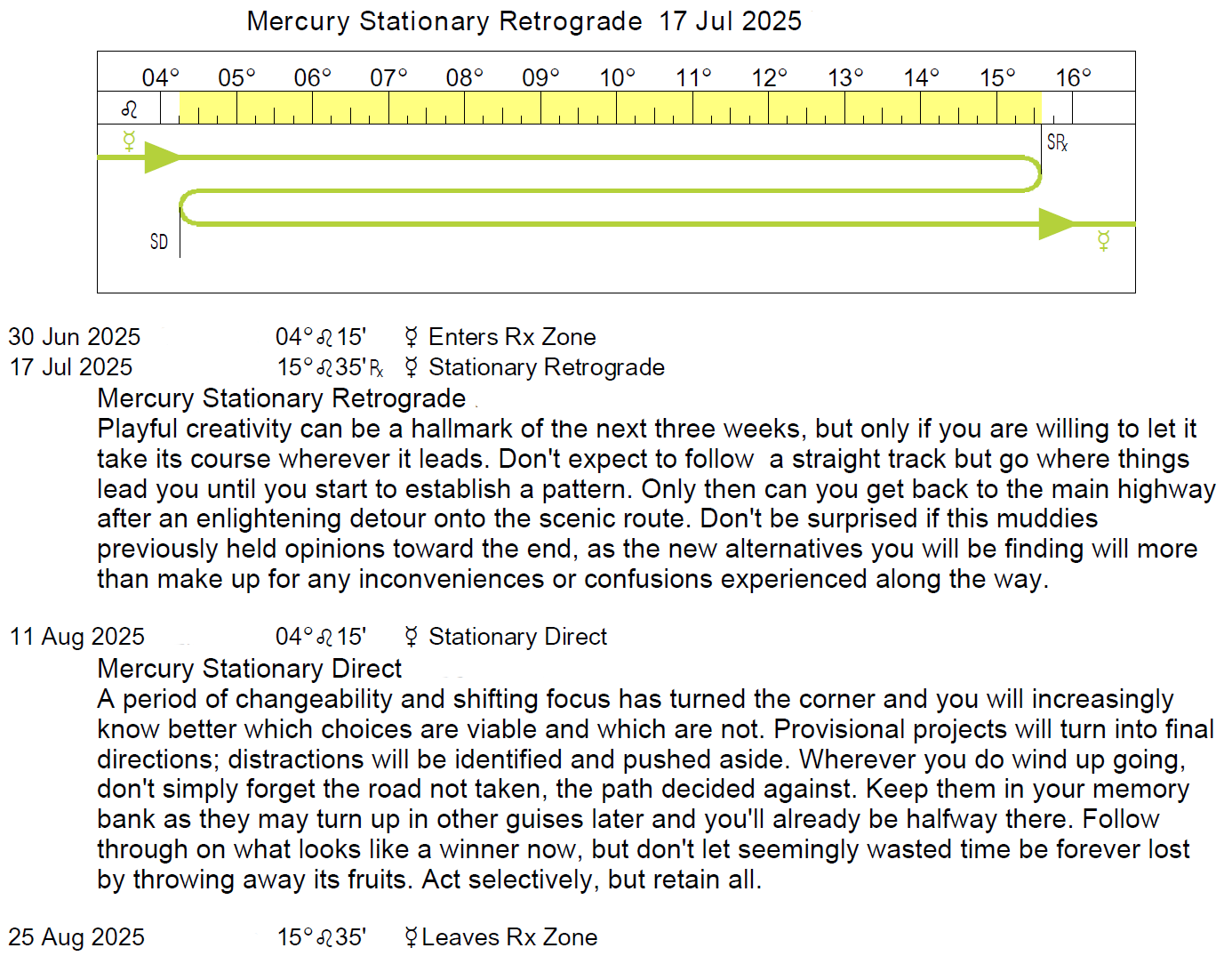
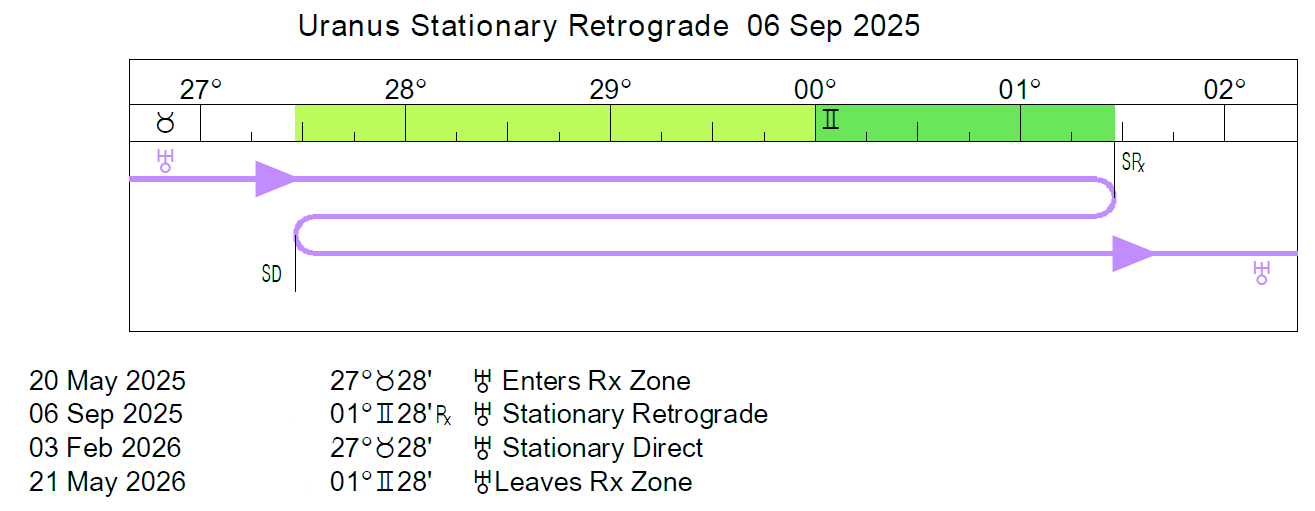
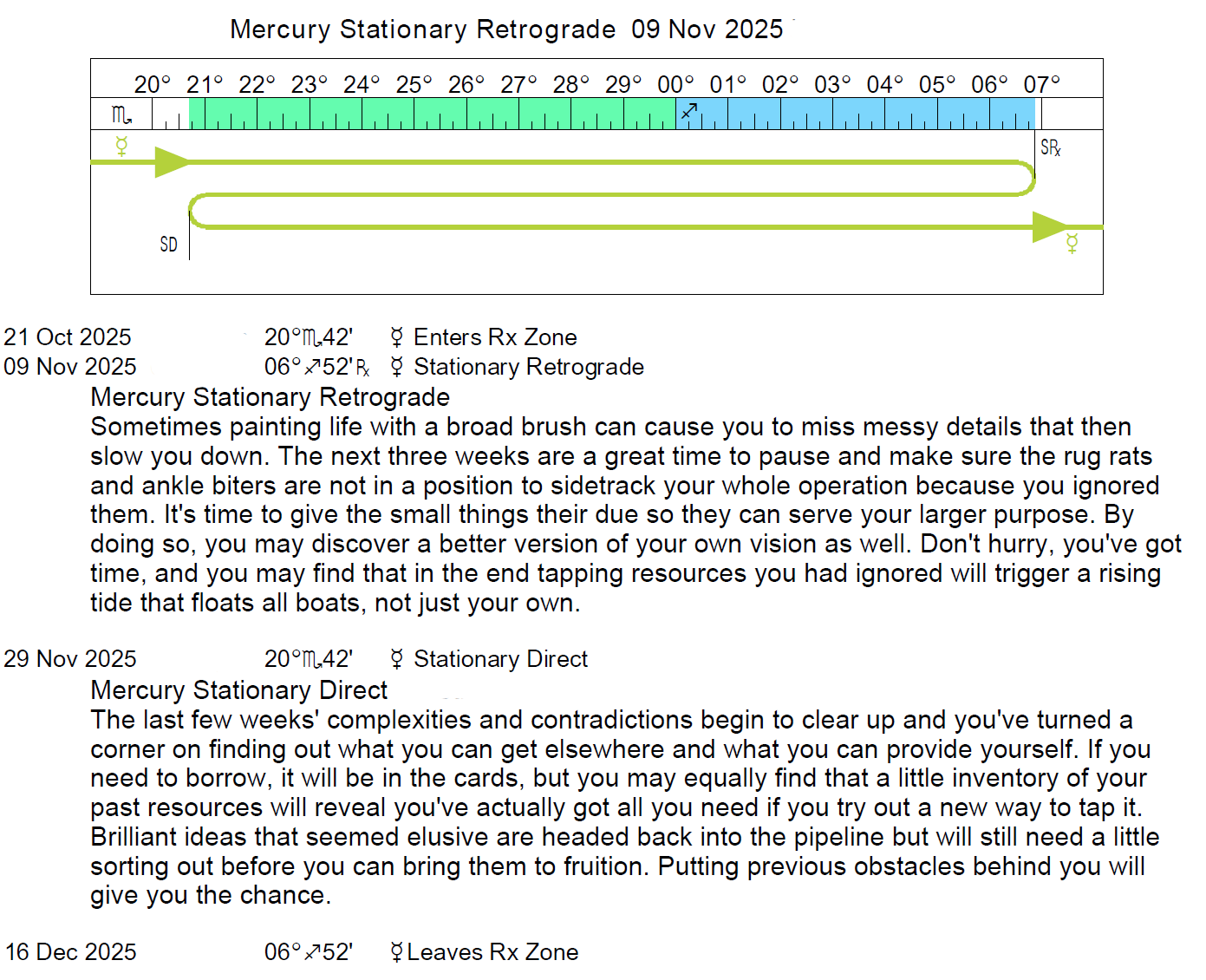
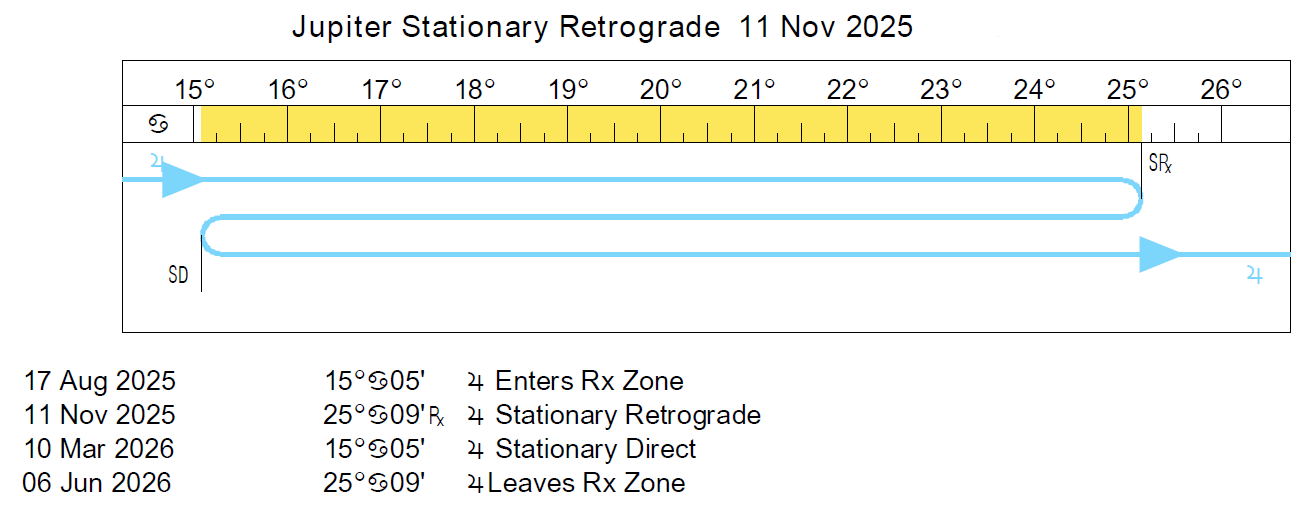
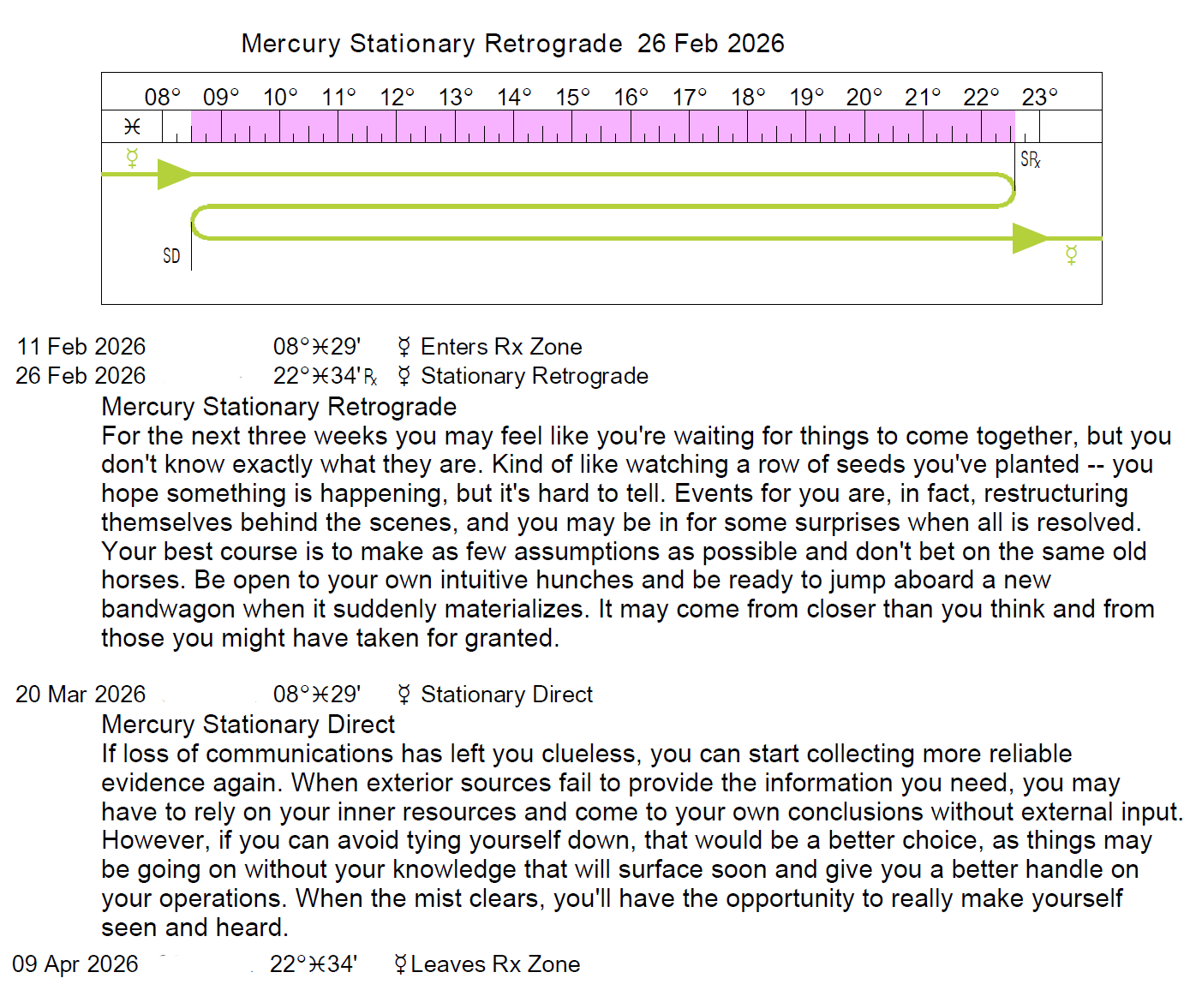
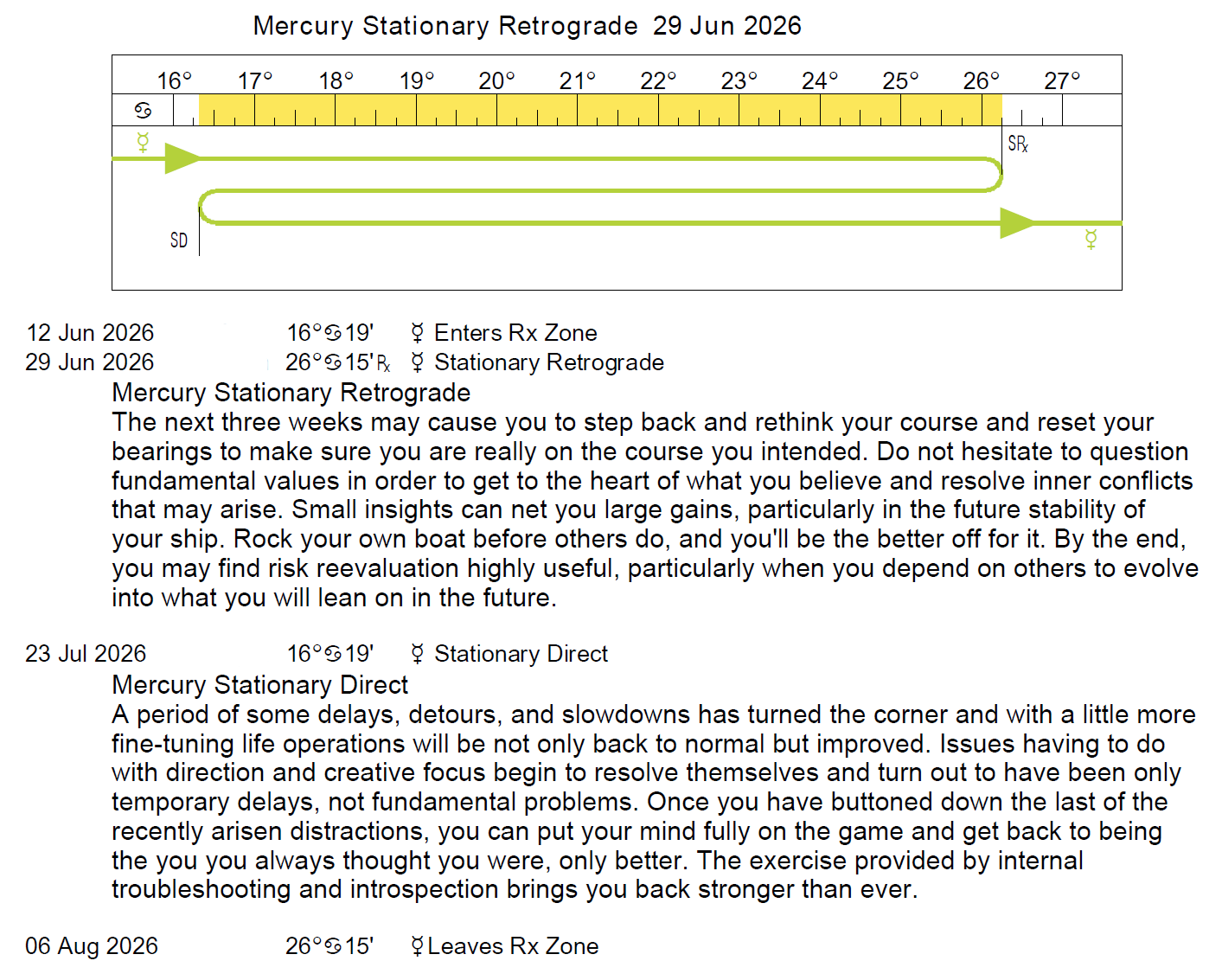
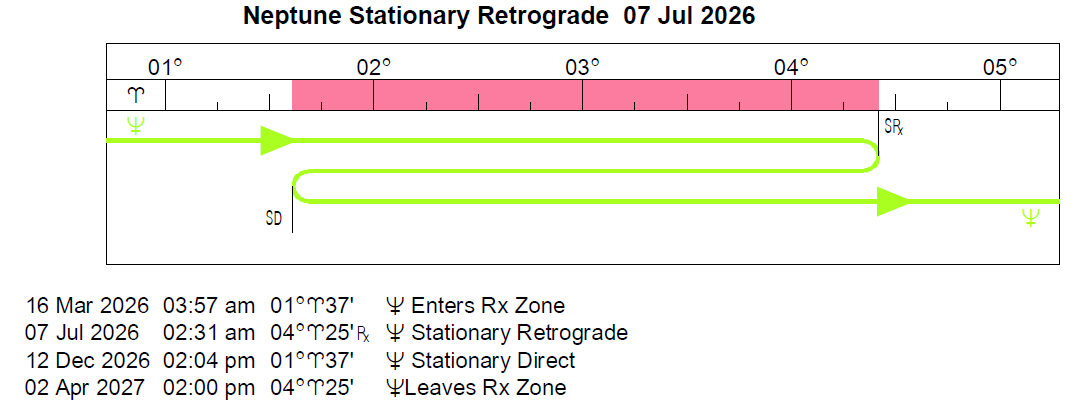
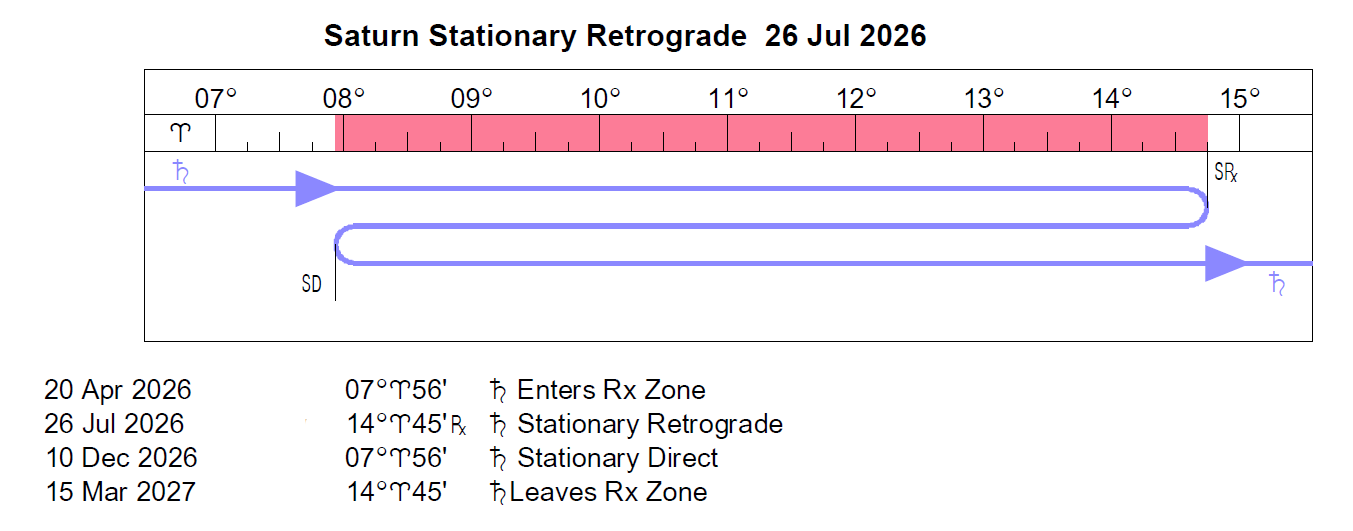
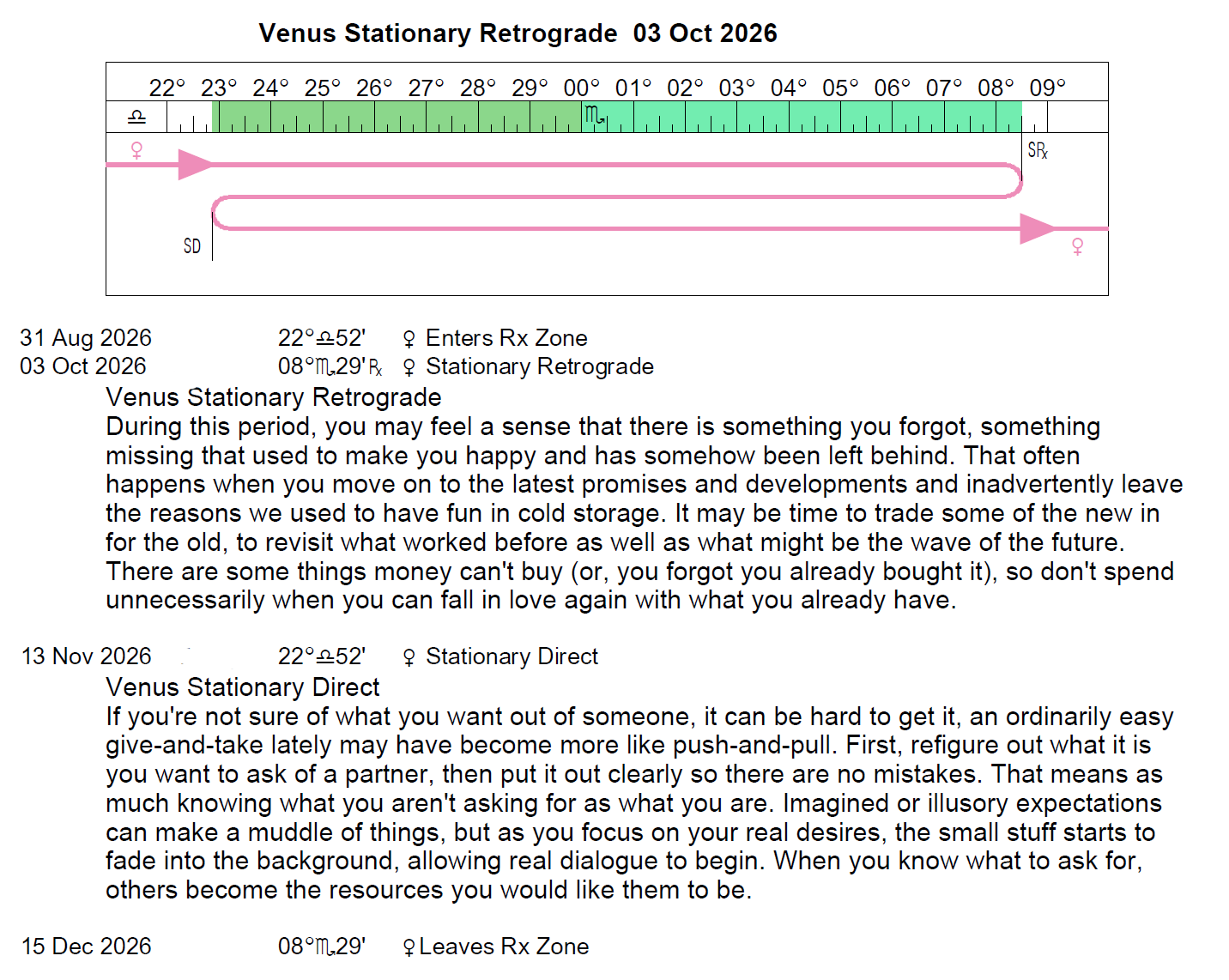
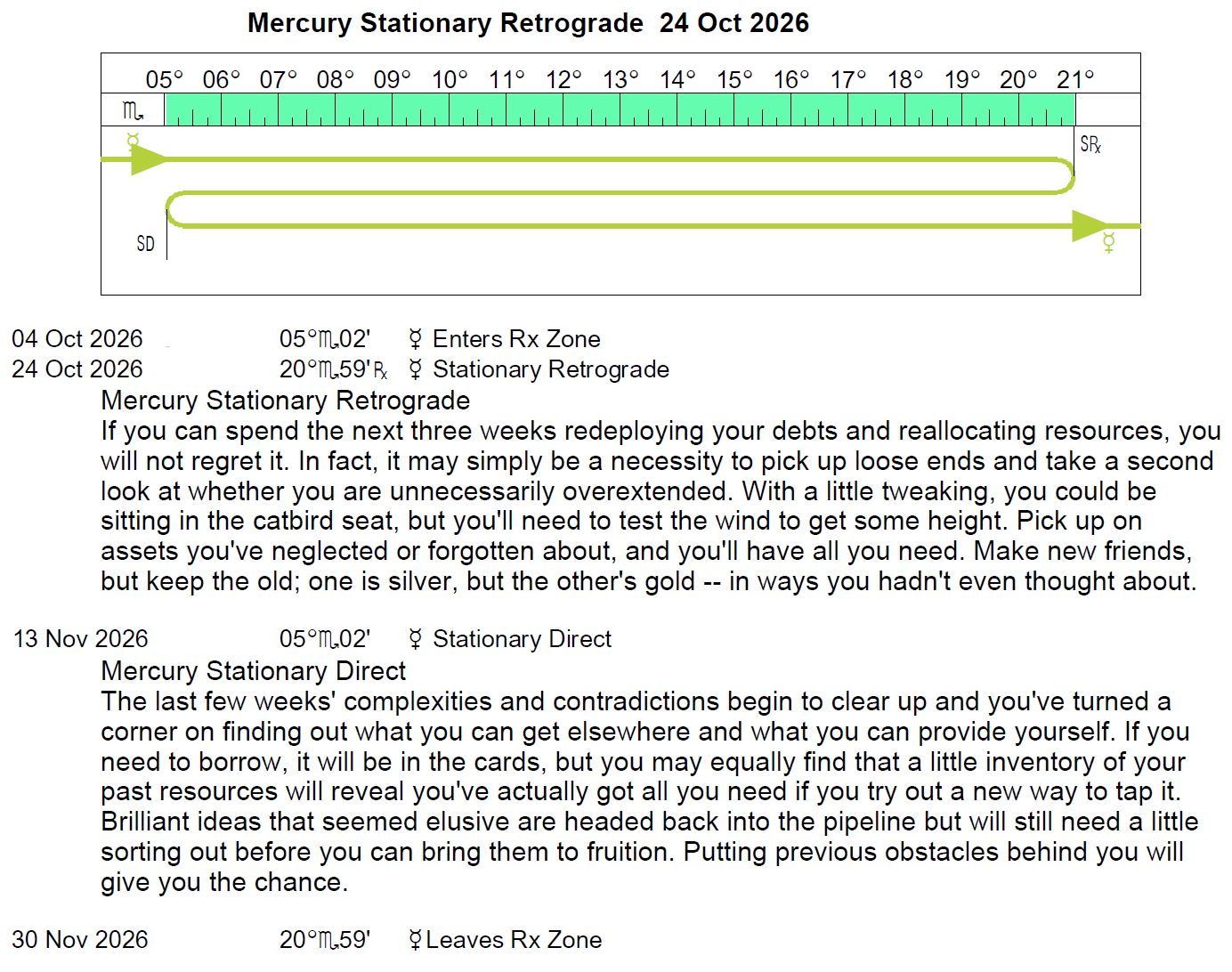
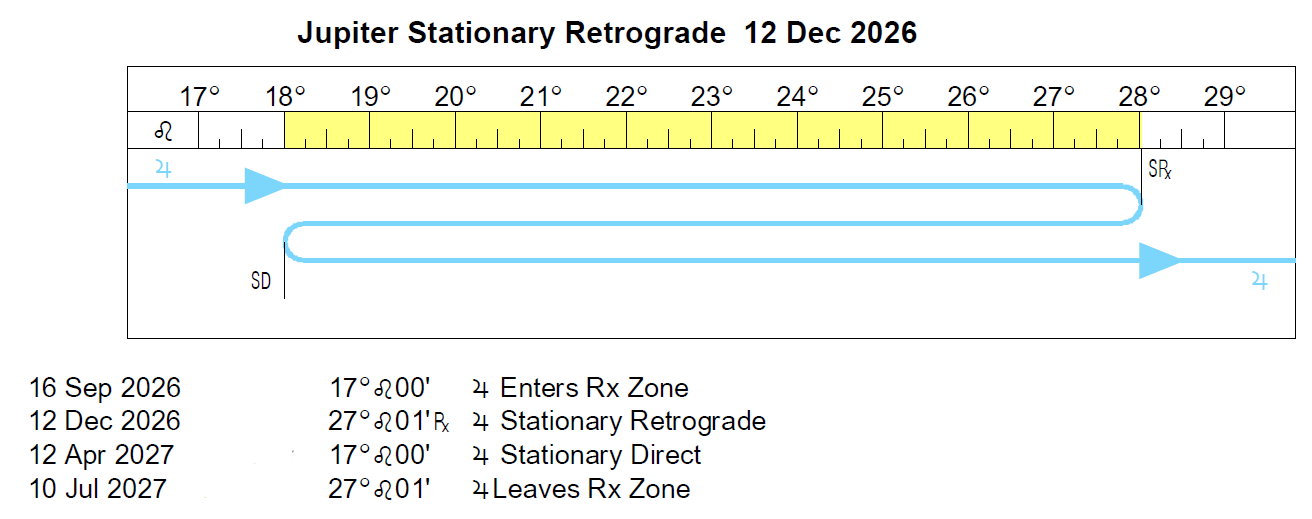






 Print chart
Print chart